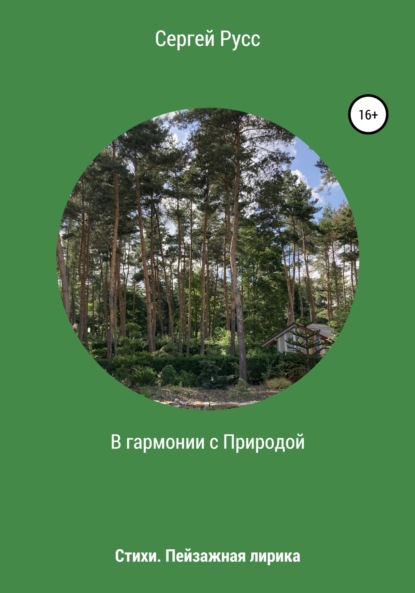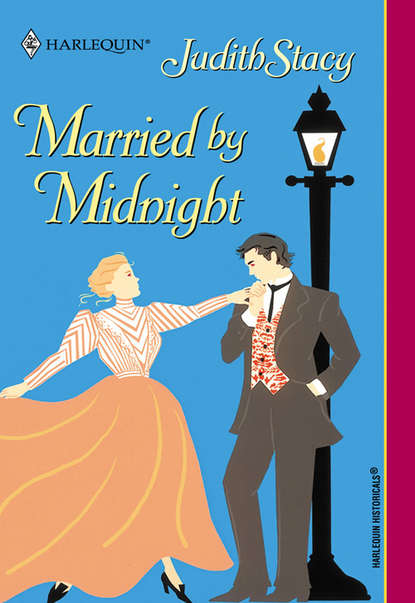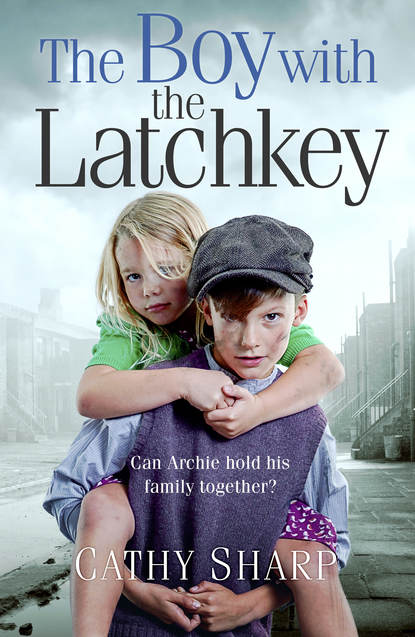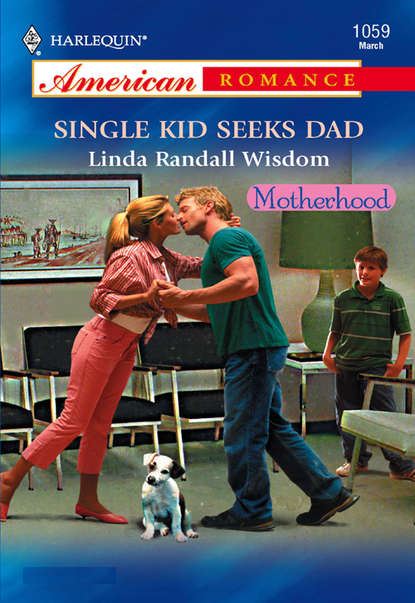Curiosa
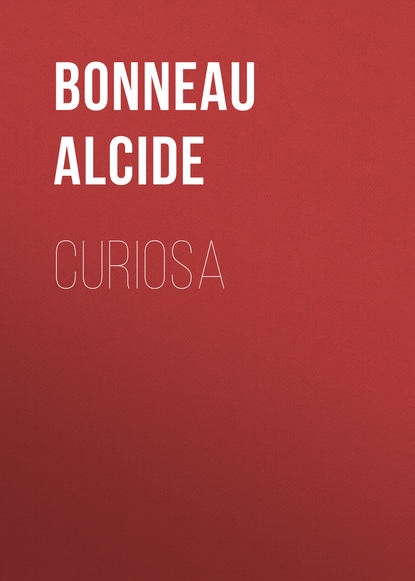
- -
- 100%
- +
Pogge manifeste les mêmes sentiments dans son dialogue: An seni sit uxor ducenda; mais il les reproduit cette fois sous la forme démonstrative. On voit qu’il veut se rendre compte de son bonheur, l’expliquer théoriquement, démontrer que ce ne fut pas un effet du hasard, mais que cela devait être, et du même coup pallier sa conduite et convier tous les célibataires endurcis à suivre son exemple. Les interlocuteurs sont au nombre de trois: Pogge, qui du reste joue un rôle assez effacé, son ami le savant Niccolo Niccoli, celui précisément auquel est adressée la charmante relation des Bains de Bade5, et Carlo Aretino, chancelier de Florence, beaucoup plus jeune alors que les deux autres. Niccolo, avec sa verve railleuse, expose que Pogge, en se mariant si tard avec une jeune fille de dix-huit ans, a peut-être fait par hasard une bonne affaire, mais qu’il en pourra cuire à ceux qui seraient tentés de l’imiter, et il énumère spirituellement toutes les tribulations d’un pareil ménage. C’est un tableau très réussi, et il offre cette particularité qu’il n’est pas chargé le moins du monde. Avec un art consommé, l’auteur se garde bien des exagérations que le sujet comportait naturellement, mais qui auraient rendu la réfutation trop facile. Niccolo paraît avoir tout à fait raison, jusqu’à ce qu’il cède la parole à Carlo Aretino, dont la réplique en faveur des mariages tardifs n’en est que plus piquante. Par une autre délicatesse, Pogge n’a pas voulu plaider pour lui-même, il a préféré placer ce qu’il avait à dire dans la bouche de son jeune ami. Carlo, après avoir démoli pièce à pièce toute l’argumentation de son adversaire, en fait une contrepartie si exacte qu’il semble qu’on voie clair pour la première fois dans une question embrouillée à plaisir; évidemment le vrai bonheur est de se marier aux environs de la soixantaine et de prendre sa femme la plus jeune possible. Le porte-parole de Pogge accumule avec tant d’esprit tant de bonnes raisons, qu’on arrive à se faire la réflexion formulée ironiquement à la fin par Niccolo: Hâtons-nous de vieillir, mettons les années doubles, pour arriver au plus tôt à cet état de parfaite béatitude.
Voilà qui est bien; mais l’ancienne maîtresse, la femme aux quatorze enfants? Le souvenir de son abandon et de celui des quatre enfants qui avaient survécu, dans le nombre, ne fait-il pas quelque ombre au tableau? Pogge ne semble pas s’être laissé importuner outre mesure par les remords; à partir de son mariage, son ancienne femme et ses enfants semblent avoir été pour lui comme s’ils n’existaient pas. Que devinrent cependant ces malheureux? Laurent Valla prétend que Pogge les laissa tranquillement mourir de faim, qu’il alla même jusqu’à déchirer une donation par laquelle il leur avait antérieurement assuré une petite aisance. Valla était un ennemi acharné de Pogge, et il a inventé contre lui de si odieuses et si absurdes calomnies, qu’il ne devait pas lui en coûter beaucoup de mentir une fois de plus; Tommaso Tonelli, le traducteur Italien de la Vie de Pogge, par Shepherd, met à découvert toute sa mauvaise foi. Il paraît que les enfants naturels de Pogge avaient acquis la légitimation par deux actes authentiques, dont le premier est une bulle pontificale, et le second un décret de la Seigneurie de Florence qui, en considération du retour de Pogge dans son pays natal, de son savoir et de ses occupations littéraires, l’exempta, lui et ses fils, de tout impôt. Ce décret fut rendu en 1532, trois ans avant son mariage. Ces fils légitimés conservaient donc tous leurs droits, même dans le cas où leur père aurait d’autres enfants. Quant à la donation soustraite et déchirée, c’est bien probablement une fable puisque Pogge, sans se donner tant de peine, pouvait la révoquer d’un trait de plume, en faisant d’autres dispositions testamentaires. Rien n’empêche donc de croire que Pogge assura, de façon ou d’autre, l’avenir de la femme qu’il quittait et des enfants qu’il avait eus d’elle; que s’il n’en a plus jamais parlé, cette absence de toute préoccupation et la sérénité de son esprit à leur égard témoignent précisément en faveur des dispositions qu’il avait dû prendre. Un homme tel que lui ne s’avilit pas de gaîté de cœur.
Quoi qu’il en soit, Pogge fut parfaitement heureux avec Vaggia de’ Buondelmonti; sa félicité conjugale résista au temps et dépassa de beaucoup les limites de la lune de miel, au cours de laquelle il écrivait ce dialogue. Pogge y prétend qu’il n’y a rien de tel que le fruit vert pour ragaillardir un vieillard et réveiller en lui le jeune homme: il le prouva bien6. Lui qui nous a conté tant de bons tours joués aux vieux maris, et qui peut-être leur en avait joué plus d’un, il eut la chance de démentir le mot de Plutarque: Qu’un barbon se marie autant pour ses voisins que pour soi. On prétend même qu’il mourut un peu prématurément, à soixante-dix-neuf ans sonnés, pour avoir été trop aimé par sa femme7. Son mariage, en somme, est d’un bon exemple pour les célibataires arrivés à la cinquantaine: à eux d’en faire leur profit.
Juin 1877.
IV
LA CIVILITÉ PUÉRILE8
La Civilité puérile évoque de lointains souvenirs d’école. Il y a peu d’hommes de trente à quarante ans qui n’aient eu pour premier livre, comme syllabaire et comme rudiment, cette petite plaquette cartonnée, de quinze ou vingt pages, commençant par un alphabet, continuant par un tableau des voyelles et des consonnes (on lisait consonnantes dans les exemplaires un peu anciens), et terminée par des préceptes de savoir-vivre. Dès qu’on pouvait épeler, on y apprenait à ne pas se moucher sur sa manche. Le tout était imprimé en gros caractères, qui passaient insensiblement de la lettre capitale au Romain et dont l’œil diminuait en proportion des progrès présumés de l’élève. Les générations précédentes avaient eu entre les mains à peu près le même livre, imprimé en caractères bizarres, qui étaient censés représenter l’écriture cursive: peut-être était-ce l’écriture du temps d’Alain Chartier ou de Jeanne d’Arc; il faut aujourd’hui, pour la déchiffrer, de forts paléographes, et elle devait constituer pour les enfants un supplice des plus raffinés.
«Je crois qu’il faut attribuer l’usage persistant de ce caractère,» dit M. Jérôme Pichon (Du caractère dit de Civilité, dans les Mélanges de littérature et d’histoire de la Société des Bibliophiles François, 1850), «à l’utilité qu’il présente pour familiariser les jeunes enfants avec les anciennes écritures, et les mettre ensuite à même de lire dans ce que les maîtres d’école appellent les contrats.» C’est possible; mais la mauvaise impression d’un livre laisse toujours dans l’esprit un préjugé fâcheux qui a beaucoup de peine à se dissiper, et cela dut aider considérablement au discrédit dans lequel finit par tomber la Civilité puérile. Il a fallu longtemps, près de deux siècles. Telle était l’autorité de ces petits manuels, qu’ils se perpétuaient d’âge en âge, sous leur atroce forme Gothique, sans qu’on osât y rien changer. On disait d’un homme qui commettait quelque balourdise: Il n’a pas lu la Civilité puérile! La seule innovation que l’on tenta, vers 1820, et encore pas dans toutes les villes, ce fut de substituer aux caractères de Civilité, reconnus enfin illisibles, des caractères ordinaires; le fond resta le même. Enfin on s’aperçut que les préceptes de savoir-vivre qu’ils contenaient étaient ou surannés ou absurdes, et on les proscrivit de l’enseignement scolaire. A peine aujourd’hui trouverait-on une Civilité puérile dans quelque école de village, tenue par les Frères des Écoles Chrétiennes, qui la conservent encore par une sorte de fétichisme pour leur fondateur, J. – B. de La Salle, l’auteur le plus répandu des manuels de ce genre.
Le véritable auteur de la Civilité puérile, c’est Érasme. Cet esprit si caustique et si fin a été la mère Gigogne de ces ineptes petits livres qui, durant deux siècles ont pullulé dans les écoles. Ils procèdent tous de lui, malgré leurs innombrables variétés, mais comme alfana venait d’equus dans l’épigramme du chevalier de Cailly, après avoir subi tant de métamorphoses en route, qu’il n’en restait pas une seule lettre.
Une chose assez surprenante, c’est que personne, à notre connaissance du moins, ne se soit préoccupé de cette filiation, qui est cependant facile à établir. Cela tient à ce que J. – B. de La Salle, qui emprunta beaucoup à Érasme, sans doute par l’intermédiaire d’un autre prêtre, Mathurin Cordier, et de vieilles traductions ou imitations Françaises, n’indiqua jamais le nom de l’auteur primitif, quoiqu’il ne l’ignorât pas; d’autre part, la Civilitas morum puerilium ne tient pas la première place dans l’œuvre du grand écrivain, et elle a toujours été un peu négligée. Ceux mêmes qui se sont le plus scrupuleusement occupés de la vie et des travaux d’Érasme, comme Désiré Nisard dans ses Études sur la Renaissance, l’ont tout à fait passée sous silence; d’autres se sont bornés à la citer, sans songer à la rapprocher des livres similaires infiniment plus connus et à déterminer les emprunts qui pouvaient lui avoir été faits. C’est un manque de curiosité dont il y a lieu d’être surpris; essayons d’y suppléer de notre mieux.
Érasme composa ce traité vers la fin de sa carrière, en 1530, pour un jeune enfant qu’il affectionnait9. Son ton est paternel, avec une pointe de bonne humeur et d’enjouement que ses plagiaires ont lourdement émoussée. Ce qui dut séduire le clergé, qui de bonne heure adopta son livre, sans en nommer ni en remercier l’auteur, c’est qu’il s’y montre dévot, un peu bigot même; aux génuflexions qu’il exige quand passe un Religieux, on a peine à reconnaître le satirique hardi du Repas maigre et de tant de bonnes plaisanteries sur les Franciscains. Mais ses deux principaux imitateurs, Mathurin Cordier et J. – B. de La Salle, ont tellement abusé de ces menus suffrages de dévotion, que, par comparaison, Érasme en semble sobre. Telle qu’elle est, sauf quelques prescriptions que les changements d’usages ont fait tomber en désuétude, sa Civilité puérile pourrait encore servir aujourd’hui; c’est l’œuvre d’un esprit délicat, et son seul tort est d’avoir été le point de départ des autres.
En revanche, Érasme avait-il eu des modèles? Évidemment, il n’inventait pas le savoir-vivre et bien avant lui on en avait posé les règles générales. Cette sorte de littérature pédagogique était cultivée depuis l’antiquité Grecque; mais le premier il a traité la matière d’une façon spéciale et complète: personne avant lui n’avait envisagé la civilité ou, si l’on veut, la bienséance, comme pouvant faire l’objet d’une étude distincte. Aussi croit-il devoir s’excuser, s’il traite à fond cette partie infime et négligée de la philosophie, en disant que les bonnes mœurs se reflètent dans la politesse des manières, que la rectitude appliquée aux gestes, aux actes usuels, aux façons d’être avec ses égaux ou ses supérieurs, manifeste aussi l’équilibre des facultés, la netteté du jugement et que, par conséquent, il n’est pas indigne d’un philosophe de s’occuper de ces détails en apparence indifférents. Il ne s’appuie sur aucune autorité antérieure et ne prend guère conseil que de son propre goût et du bon sens.
On pourrait même aller plus loin et dire que, non content de ne presque rien devoir à ses devanciers, il a moins mis en maxime les règles du savoir-vivre de son temps, que spirituellement critiqué ses contemporains, en prescrivant tout le contraire de ce qu’il voyait faire autour de lui. Il suffirait, pour s’en convaincre, de comparer l’un de ses colloques, celui qui est intitulé Diversoria (Auberges), avec les règles qu’il donne dans sa Civilité. On y voit que sa délicatesse était fort en avance sur les mœurs de son époque, grâce à une sensibilité toute particulière qu’on devait alors trouver excessive. Lui qui était souffreteux de sa nature, qui ne pouvait supporter une mauvaise odeur, la saleté d’un voisin mal vêtu, une haleine un peu forte, que la vue d’un crachat étalé par terre indisposait sérieusement, il consigne avec désespoir, dans ses notes de voyage, tous les déboires qu’il éprouve dès qu’il est obligé de vivre en dehors de chez lui. On lui parle dans la figure en lui envoyant au nez des bouffées d’ail, on crache partout, on fait sécher au poêle des vêtements mouillés et toute la salle en est empuantie; il y en a qui nettoient leurs bottes à table, tout le monde trempe son pain dans le plat, mord à belles dents et recommence le manége jusqu’à épuisement de la sauce; si un plat circule, chacun se jette sur le meilleur morceau, sans se soucier de son voisin; les uns se grattent la tête, d’autres épongent leur front ruisselant de sueur; la nappe est si sale, qu’on dirait une voile de navire fatiguée de longs voyages. Érasme en a mal au cœur et l’appétit coupé pour huit jours.
Sans doute, ce qu’il retrace là ce sont des mœurs d’auberge, des mœurs de table d’hôte, comme on dirait maintenant; raison de plus pour y chercher le niveau moyen de la politesse à son époque, et ce niveau ne paraît pas élevé. La Civilité puérile, quoique écrite beaucoup plus tard que ce dialogue, semble une critique calculée de ces grossiers usages dont Érasme avait eu à se plaindre toute sa vie; il y formule ses desiderata10, bien modestes après tout, et nombre de gens pensaient probablement comme lui, sans en rien dire, car à peine son petit livre eut-il paru qu’il se répandit rapidement dans toute l’Europe et jouit d’une vogue prodigieuse.
Deux ans ne s’étaient pas écoulés depuis l’apparition de l’ouvrage à Bâle en 1530, qu’il était déjà réimprimé à Londres avec une traduction Anglaise en regard (W. de Worde, 1532, in-16); la traduction est de Robert Whytington. Mais c’est en France que la Civilitas morum puerilium fut surtout goûtée; elle y devint rapidement, dans son texte Latin, un livre familier aux élèves des colléges et, dans ses traductions ou imitations Françaises, un manuel d’écolier destiné aux tout petits enfants. A partir de 1537, les traductions se succédèrent pour ainsi dire sans interruption: le Petit traité de la Civilité puérile et honneste, de P. Saliat (Paris, Simon de Colines, 1537); La Civilité puérile, distribuée par petitz chapitres et sommaires, de Jehan Louveau (Anvers, 1559); la Civile honnesteté pour les enfans, de Mathurin Cordier (Paris, 1559), si souvent réimprimée, et quelques autres encore.
Mathurin Cordier s’est évidemment inspiré d’Érasme; la division en sept chapitres est la même, les préceptes sont identiques, et cependant c’est plutôt un travestissement qu’une traduction d’Érasme. A peine y retrouve-t-on de temps en temps une phrase qui ait conservé l’empreinte du texte Latin, de ce style savoureux et pittoresque à l’aide duquel Érasme donne de l’intérêt à des détails infimes.
Au commencement du XVIIIe siècle parut la Civilité de J. – B. de La Salle. Elle était intitulée: Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne; divisé en deux parties; à l’usage des Écoles Chrestiennes. L’auteur, selon toute vraisemblance, ne s’est aucunement préoccupé du texte d’Érasme; il a fait un ouvrage nouveau, qui est bien de lui. Entre ses mains, l’opuscule de Mathurin Cordier est devenu un gros volume de trois cents pages, farci de toutes sortes de choses. L’esprit d’Érasme se trouve à peu près évaporé dans ce fatras; toutefois le mordant écrivain avait donné à ses préceptes un tour si ingénieux, si rapide, qu’il était difficile de mieux dire, et quelques-unes de ses idées transparaissent encore, sous ces épaisses couches d’alluvions.
D’autres Civilités couraient encore les écoles; celle de J. – B. de La Salle s’éditait surtout à Paris; les autres sortirent principalement de Toul, Troyes, Châtellerault et Orléans. Les Civilités de Châtellerault étaient renommées entre toutes pour leur mauvaise exécution typographique: le papier est plus rance et plus grenu que du papier à chandelle; les caractères, empâtés et effacés par des tirages séculaires, ne produisent que des maculatures illisibles. Celles d’Orléans, imprimées chez Rouzeau-Montaut, sont au contraire irréprochables; elles procèdent, pour la pureté et la finesse des caractères, des belles éditions de Granjon et de Danfrie. Pour le fond, ces Civilités provinciales sont tirées d’Érasme, soit d’après le texte Latin, qui était toujours en usage dans les collèges, soit par l’intermédiaire d’anciennes traductions ou de l’imitation libre de Mathurin Cordier. On croit généralement qu’elles sont toutes copiées les unes sur les autres; c’est une erreur. Chacune d’elles était réimprimée à foison, le plus souvent dans la même ville; mais chaque ville, outre Paris qui approvisionnait une grande partie de la France, avait pour ainsi dire la sienne: de là une foule de variétés qui n’ont entre elles que peu de rapports. Les auteurs de ces manuels étaient des éclectiques; ils prenaient de côté et d’autre et arrangeaient à leur guise ce qui leur convenait, ajoutant ou retranchant, selon leurs tendances particulières, et masquant habilement ce qu’ils empruntaient11.
Avec le XVIIIe siècle disparurent ces diverses Civilités; elles firent place à l’abrégé de J. – B. de La Salle, réimprimé partout à profusion, d’abord sous le titre primitif de Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne, puis sous celui de Civilité puérile et honnête. Cet abrégé, composé un siècle après la mort de l’auteur, ne possède guère de J. – B. de La Salle que le nom.
Après toute cette série d’imitations et de travestissements, le traité d’Érasme, rétabli dans son intégrité par une traduction littérale, peut presque passer pour une nouveauté. Le texte Latin n’avait cependant pas cessé, durant deux siècles, de rester en honneur; avant la Révolution, on le faisait encore apprendre par cœur dans les collèges. On le réimprimait, à l’usage des classes d’humanités, avec le De officiis scholarum, de Nicolas Mercier, dont le troisième livre: De Civilitate morum, sive de ratione proficiendi in moribus, n’est, du reste, qu’une élégante versification des principaux préceptes d’Érasme. Un autre poète Latin du XVIIe siècle, François Hœm, de Lille (Franciscus Hœmus Insulanus), a même accompli, avec beaucoup d’adresse, le tour de force de mettre en vers, chapitre par chapitre, toute la Civilitas morum puerilium, et ce petit poème était aussi, sous Louis XV, un livre classique. La tradition n’en a pas moins fini par se perdre, et de tant d’enfants qui ont appris à lire dans une Civilité puérile, pas un peut-être, devenu homme, ne s’est douté qu’il avait eu Érasme pour premier maître.
Octobre 1877.
V
LES FACÉTIES DE POGGE12
Les Facéties restent l’œuvre la plus populaire de Pogge, et, si bizarre que ce rapprochement paraisse, la moins connue. Il n’en existe pas en Français de traduction complète; celle-ci est la première qui présente Pogge tel qu’il est, sans le mutiler ou le travestir. L’ancienne imitation attribuée à Guillaume Tardif, Lecteur du Roi Charles VIII, et imprimée vers la fin du XVe siècle, n’est qu’une paraphrase. Elle ne contient d’ailleurs que cent douze contes sur deux cent soixante-treize, et le choix n’est pas très judicieux, car l’auteur a éloigné, non ce qui pouvait paraître un peu gaillard (les gens du XVe et du XVIe siècle n’étaient pas si pudibonds), mais ce qui regardait les vices du Clergé, matière inépuisable aux railleries, dans ce temps-là; pour ce qu’il a conservé, il change le lieu de la scène, invente des noms aux personnages et fait tout un roman13. Il goûtait Pogge, cependant, ce bon Guillaume Tardif; il l’appelle, dans son Épitre au Roi, «le bien litéré et facétieus homme, Pogge Florentin», et il le loue d’avoir usé, «selon la matière subjecte, de termes Latins fort élégamment exquis et rhétoricques;» mais, en ne voulant donner que «la substance et l’intention de ses joyeux devis», il les a étrangement défigurés. Les éditions qui suivirent, celles de Jehan Bonnefons (1549)14, de Nicolas Bonnefons (vers 1575), de Cousturier (1606), et de Jean-Frédéric Bernard (Amsterdam, 1712), ne sont que des reproductions ou des rajeunissements de la première. Celle d’Amsterdam, où les contes sont réduits à soixante-treize, est la plus commune, et, quoiqu’elle se vende cher, la moins estimable; chaque anecdote y est accompagnée de remarques insipides. L’anonyme qui s’est avisé de faire ce petit travail (David Durand, ou, selon Barbier, l’éditeur Jean-Frédéric Bernard), a voulu tirer, de contes pour rire ou de libres reparties, des sentences morales, des déductions philosophiques! Lenfant, dans son Poggiana, s’est préoccupé de leur côté historique, et n’a pas été beaucoup plus heureux; il a extrait du recueil une centaine d’anecdotes, pour les accommoder à sa guise, les abréger, leur donner du trait, et les mêler à d’autres, de provenances étrangères. Ils auraient tous entrepris de prouver que Pogge n’était ni un homme d’esprit, ni une fine plume, qu’ils n’eussent pas fait autrement. Mais la renommée du vieux conteur était bien assise: ceux qui autrefois, du temps que le Latin était la langue courante des érudits, lisaient les Facéties dans l’original, leur avaient fait une réputation qui a résisté aux efforts inconscients des traducteurs pour la ruiner.
Tout récemment, deux estimables érudits, M. P. Ristelhuber, de Strasbourg, et M. Gustave Brunet, de Bordeaux, ont pris à cœur de faire juger les Facéties plus équitablement que sur ces pauvres échantillons. L’ouvrage de M. Ristelhuber, intitulé les Contes de Pogge15, n’est en réalité qu’un Choix des Contes de Pogge, car il n’en contient que cent douze, juste le même nombre que l’imitation du Lecteur de Charles VIII; presque tous sont écourtés, quelques-uns outre mesure. Par exemple, le LXXVIe, D’un pauvre Batelier (c’est le CLXXVe de notre édition), est coupé à la moitié; M. Ristelhuber s’arrête à la première partie de la réponse du mauvais plaisant au batelier: «Ne passe jamais personne sans te faire payer d’avance», comme si le conte était fini: ce n’est pas là traduire; il est vrai que le reste est un peu léger, mais le plus souvent les suppressions portent, sans qu’on sache pourquoi, sur des détails qui n’offrent rien de scabreux. Ce petit livre rachète heureusement ce qu’il a de défectueux, comme traduction, par des notes historiques et des commentaires d’une certaine valeur. M. Gustave Brunet16 a voulu compléter le travail de M. Ristelhuber, et il a encore trouvé cent trois contes dignes d’être mis en Français; c’était un joli regain, mais tous ne sont pas de Pogge, il s’en faut d’un bon tiers au moins.
Les Facéties méritent cependant d’être considérées mieux que comme un ensemble de matériaux bruts à rogner, tailler et polir. Pogge a donné lui-même à ces Menus Propos ou Joyeux Devis, comme il les appelait, une forme excellente, à laquelle il est parfaitement inutile d’en substituer une autre; aussi avons-nous fait une version littérale. Le soin qu’ont pris constamment ses prétendus traducteurs de l’élaguer, de le raccourcir ou de le paraphraser, ferait croire qu’il abonde en détails oiseux ou d’une licence exorbitante: il n’en est rien. Son récit, quoi qu’on dise, est bref, bien conduit, d’un tour ingénieux et piquant, et ce qui domine, c’est la bonne humeur, la bonne grosse gaieté, beaucoup plus que la licence. Pogge est de son temps; il ne recule pas devant les mots, mais c’est pour assaisonner la plaisanterie; il est sans gêne à la manière de Rabelais, mais il ne recherche pas les équivoques comme Béroalde de Verville; et Brantôme, par exemple, a bien plus de raffinements. D’ailleurs, au lieu d’employer, suivant l’ancienne coutume, des périphrases souvent pires que le mot propre, nous avons laissé en Latin les passages et les expressions qui pouvaient «scandalizer les foibles», comme disait le bon Abbé de Marolles en traduisant Martial, et nous prendrions volontiers pour épigraphe la vieille devise: Si non caste, saltem caute.
Le texte que nous avons principalement suivi est celui de l’édition de Bâle17, in-fol., 1538, donné, dit-on, par Henri Bebel, érudit Allemand, auteur lui-même de Facéties. Celui de François Noël (Trajecti ad Rhenum, 1797, ou Londini, 1798, 2 vol. in-18), est aussi défectueux que le livre est mal imprimé. Noël a voulu faire parler Pogge en Cicéronien, comme un auteur du XVIe siècle, et il a omis, sans aucune raison, bon nombre de mots ou même de phrases qui lui paraissaient inutiles. Sa manie réformatrice a été jusqu’à remplacer les titres des contes, tels qu’ils sont libellés dans les anciennes éditions, par d’autres de son invention, plus courts sans doute et plus piquants, mais qui ont le tort d’enlever au vieux conteur son cachet de bonhomie. Non que les titres anciens soient sûrement de Pogge: il est possible qu’ils aient été rédigés par ses premiers éditeurs, mais, en tous cas, ils sont tels qu’on les comprenait à son époque.