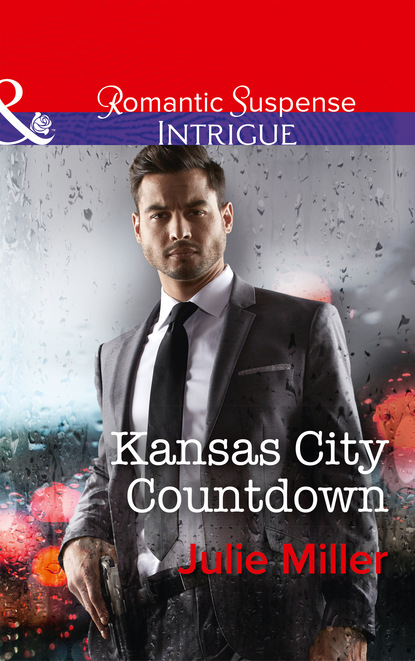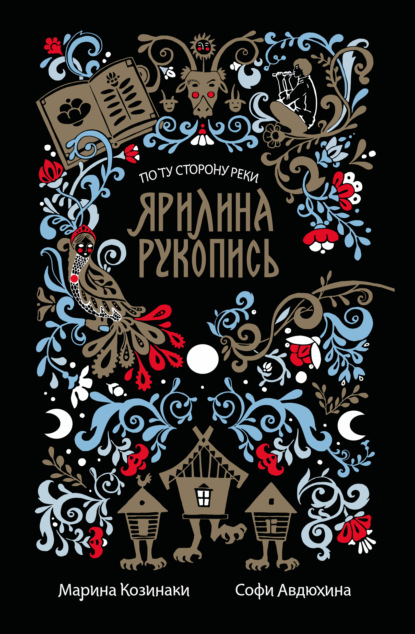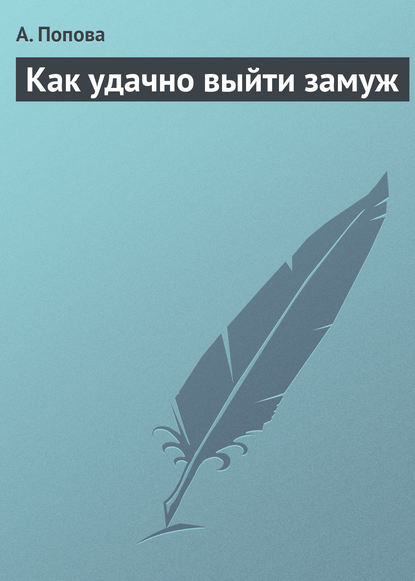Création et rédemption, deuxième partie: La fille du marquis
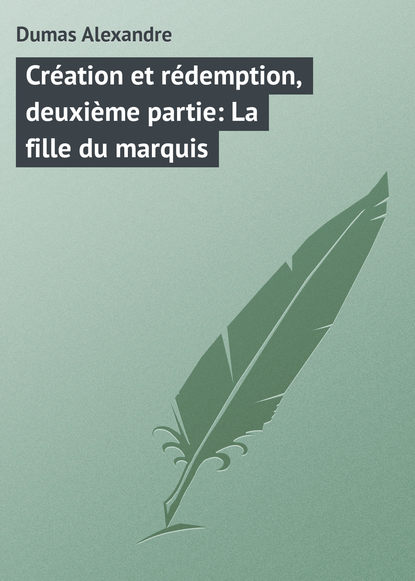
- -
- 100%
- +
– Prenez garde, monsieur, dit-il, Thor est méchant.
Thor était le nom du chien.
– Pas avec moi, dit le volontaire. Tu vois?
Il fit un signe à Thor et Thor vint le caresser.
– Qui es-tu? demanda le petit garçon au volontaire.
– Je n'ai pas besoin de te demander qui tu es, toi: tu es le petit-fils de Hans Rivers.
– Oui.
– Où est ton grand-père?
– Dans la ferme.
– Conduis-moi à lui.
– Venez.
Il prit la main de l'enfant et s'avança avec lui vers un perron au haut duquel parut un vieillard d'une soixantaine d'années.
– Grand-papa, dit l'enfant qui courut à lui, voici un monsieur qui nous connaît.
Le vieillard leva son bonnet de laine, saluant de la main, interrogeant des yeux.
– Monsieur, lui dit Jacques, j'avais l'âge de cet enfant quand je vins, et c'est la seule et unique fois que j'y vins. J'étais avec mon père, Daniel Mérey; vous signâtes avec lui le bail de cette ferme, que je vous ai renouvelé, il y a, je crois, trois ans.
– Dieu me bénisse! s'écria Hans, seriez-vous notre maître Jacques Mérey?
Jacques se mit à rire.
– Je ne suis le maître de personne, dit-il, car, à mon avis, l'homme n'a d'autre maître que lui-même. Je suis tout simplement votre propriétaire.
– Jeanne, Marie, Thibaud, accourez tous, s'écria le vieillard, un jour heureux nous arrive! Venez, venez, venez!
Et au fur et à mesure qu'il appelait, les appelés accouraient et se rangeaient autour de lui.
– Regardez bien monsieur, dit-il, vous tous, tant que vous êtes, et vous aussi, dit-il, étendant l'invitation à deux garçons de charrue, à un berger et à une gardeuse de dindons, c'est à lui que nous devons tout, monsieur, c'est notre bienfaiteur, Jacques Mérey.
Un cri s'échappa de toutes les bouches, les têtes se découvrirent.
– Entrez chez vous! dit le vieillard. Du moment où vous avez mis le pied dans la maison, nous ne sommes plus que vos serviteurs.
Tous se rangèrent.
Jacques Mérey entra.
– Allez chercher à la charrue Bernard et aux vaches Rosine… Bah! c'est aujourd'hui fête, on ne travaille pas.
Bernard et Rosine étaient le fils aîné et la belle-fille du vieillard, le père et la mère de l'enfant blond.
Une heure après, tout le monde était réuni autour de la table du dîner. Il était midi.
Hans était le grand-père, Jeanne était la grand-mère, Bernard était le fils aîné, Rosine était sa femme, Thibaud était un second fils de vingt-deux ans, Marie était une fille de dix-huit, Richard était l'enfant blond de dix ans, le fils de Bernard et de Rosine. C'était toute la famille.
L'aïeul avait cédé son fauteuil à Jacques qui présidait la table.
On en était arrivé au dessert.
– Hans Rivers, dit Jacques, combien y a-t-il de temps que vous êtes fermier dans notre famille?
– Il y a, monsieur Jacques, attendez donc! c'était entre la naissance de Thibaud et celle de Marie… il y a vingt et un ans, monsieur Jacques.
– Pendant combien d'années avez-vous payé vos redevances?
– Tant que votre digne père, M. Daniel, a vécu, c'est-à-dire quinze ans.
– Il y a donc sept ans que vous ne m'avez rien payé?
– C'est vrai, monsieur Jacques; mais d'après votre ordre.
– Je vous ai dit: Vous êtes d'honnêtes gens, gardez vos redevances, achetez du bien avec; plus vous serez riches, plus je le serai.
– Vous nous avez dit cela, monsieur Jacques, mot pour mot, et, en nous disant cela, vous avez commencé notre fortune.
– Et quand on a mis en vente les biens des émigrés, c'est-à-dire de ceux qui se battent contre la France, je vous ai dit: Vous devez avoir de l'argent de côté, à moi ou à vous, peu importe; achetez du bien d'émigré, c'est du bon bien qui ne se vendra pas plus de deux ou trois cents francs l'arpent, et qui vaudra celui qui se vend six et huit.
– Nous avons fait comme vous avez dit, monsieur Jacques, de sorte qu'aujourd'hui nous avons trois cents arpents de terre à nous. Ça nous fait, Dieu nous pardonne! presque aussi riches que notre maître. Il est vrai que là-dessus nous vous devons, avec les intérêts composés, près de quarante mille francs. Mais nous sommes prêts à vous les rendre, non pas en mauvais papier, mais en bon argent, comme nous vous le devons.
– Il n'est pas question de cela, mes amis. Je n'ai pas besoin de cet argent maintenant; mais peut-être en aurai-je besoin plus tard.
– Vous savez, à ce moment-là vous le direz, monsieur Jacques, et huit jours après, foi de Hans Rivers! vous serez payé.
Jacques se mit à rire.
– Vous auriez un moyen de me payer plus rapide et plus simple, dit-il; ce serait d'aller me dénoncer. Je suis proscrit. On me couperait le cou, et vous ne me devriez plus rien.
Le père et les enfants, à ces mots, jetèrent un cri et se levèrent debout.
Puis le père leva les bras au ciel.
– Ils vous ont proscrit, vous, dit-il, vous le droit, vous la justice, vous la représentation de Dieu sur la terre; mais que veulent-ils donc?
– Ils veulent le bien; ils croient le vouloir du moins. Alors, comme je suis obligé de quitter la France à mon tour et que je pourrais être arrêté à la frontière, j'ai pensé à vous, Hans Rivers.
– Ah! voilà qui est bien! monsieur Jacques.
– J'ai dit, Hans Rivers tient une ferme de mon père sur la Moselle, à deux kilomètres de la frontière, il doit être chasseur.
– Je ne le suis plus, mais mes deux fils Bernard et Thibaud le sont.
– Cela revient au même; ils doivent avoir un bateau sur la rivière?
– Ah! oui, dit Thibaud, et un joli bateau; c'est moi qui le soigne. Vous verrez, monsieur Jacques.
– Eh bien, je mettrai les habits du père Hans ou d'un de ses enfants; nous monterons dans le bateau, comme des chasseurs de gibier d'eau. La chasse est toujours ouverte sur la rivière. Nous nous laisserons aller à la dérive jusqu'à Trèves, et, une fois là, une fois hors de France, je serai sauvé.
– Ce sera à votre loisir, monsieur Jacques, dit le père Hans. Tout de suite si vous voulez.
– Ma foi, non! mon brave ami, répliqua Jacques Mérey; il sera temps demain matin. Vous croiriez que j'ai eu peur de passer une nuit sous votre toit.
Le lendemain, au point du jour, trois hommes vêtus de costumes de chasseur et accompagnés de deux chiens nageurs, détachaient une barque retenue par une chaîne au pied d'un saule, dans une petite anse de la Moselle, et descendaient dans la barque.
Deux de ces trois hommes allaient se mettre aux rames, lorsque le troisième, qui était assis au gouvernail, leur fit signe de les laisser en repos.
Puis, avec un triste sourire:
– Elle ira toujours assez vite, dit-il.
Ces trois hommes, c'étaient les deux fils de Hans Rivers et Jacques Mérey.
Jacques Mérey avait recommandé avec grand soin aux deux jeunes gens de lui dire exactement où finissait la frontière de France.
Au bout d'un quart d'heure de navigation, ils lui montrèrent un poteau: c'était la frontière. D'un côté, le Luxembourg; de l'autre, le Palatinat. En deçà du poteau, la patrie; au delà, la terre étrangère.
La barque s'arrêta au pied du poteau. Jacques Mérey voulait une fois encore toucher du pied le sol sacré de la France.
Il enveloppa le poteau de son bras, comme si ce morceau de bois inerte était un homme, un concitoyen, un frère.
Il appuya sa tête contre lui, comme il eût fait sur l'épaule d'un ami.
Sa douleur était double, quitter la France, et la laisser dans l'état où elle était.
Toute une armée assiégée dans Mayence, presque prisonnière. L'ennemi à Valenciennes, notre dernière barrière. L'armée du Midi en retraite; l'Espagnol débordant sur la France; la Savoie, notre fille d'adoption, retournée contre nous à la voix des prêtres; notre armée des Alpes affamée; Lyon en pleine révolte tirant à mitraille sur les commissaires de la Convention, qui, hélas! le lui rendront bien; enfin les Vendéens victorieux à Fontenay et prêts à marcher sur Paris.
Jamais nation sans se perdre ne fut si près de sa perte. Pas même Athènes se jetant à la mer pour fuir Xercès et gagnant à la nage son radeau de Salamine.
Jacques Mérey, tout matérialiste que la science l'eût rendu, sentit cependant que les événements qui se succédaient sur la terre devaient obéir à une mystérieuse puissance cachée dans les profondeurs de l'éternité et devant avoir, au point de vue de notre monde, un but intelligent et humanitaire.
Il leva les yeux au ciel, et murmura ces paroles:
– Toi qui me sers à nommer le mot que je cherche: Zeus, Uranus, Jéhova, – Dieu, – créateur invisible et inconnu des mondes, essence céleste ou matière immortelle, je ne crois pas que l'homme individuellement ait droit à un de tes regards; mais je crois que tu couvres toute l'espèce de ta protection toute-puissante, et que de même que les flottes subissent les vents, les grands événements des peuples se courbent sous ta puissante impulsion. De quelque façon qu'il ait été créé, l'homme vient de toi; et si tu l'as créé seul, pauvre et nu, c'était pour lui laisser le mérite et lui donner l'expérience de créer à son tour la famille d'abord, la tribu ensuite, et enfin la société. La société constituée, restait à l'enrichir matériellement par le travail, à l'éclairer par l'intelligence. Depuis six mille ans chacun coopère à ce but selon sa force et selon son génie. Or, quel est le résultat que tu as dû espérer de tant d'efforts? la plus grande somme de bonheur possible répandue sur le plus grand nombre d'individus. Qui a le plus fait pour accomplir cette œuvre immense, ou des monarchies de toute espèce qui se succèdent depuis mille ans à partir de la monarchie féodale de Hugues Capet jusqu'à la monarchie constitutionnelle de Louis XVI, ou des cinq années de révolution qui viennent de s'écouler? qui a donné des droits égaux à l'homme? qui lui a donné le pain de l'esprit par l'éducation, le pain du corps par le partage des terres? C'est notre sainte révolution, c'est notre bien-aimée République. La France est ton élue, ô mon Dieu! puisque tu l'as choisie en quelque sorte comme victime et offerte comme exemple au genre humain. Eh bien! que son sang coule et le mien tout le premier; qu'elle soit le Christ des nations comme Jésus a été le Christ des hommes, et que ces trois mots: LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ, prononcés par lui et adoptés par lui, deviennent le lumineux soleil de l'avenir!
Adieu, patrie! adieu, patrie! adieu, patrie!
– Et maintenant, dit Jacques Mérey en se laissant tomber dans la barque plutôt qu'il n'y descendit, jetez-moi où vous voudrez; tout lieu m'est indifférent, puisque ce n'est plus la France.
III
HUIT JOURS TROP TARD
Les deux frères Rivers déposèrent Jacques Mérey sur la berge de la Moselle, à un kilomètre à peu près de la ville de Trèves.
Jacques les embrassa tendrement; c'étaient les deux bras de la France qui le déposaient sur la terre étrangère.
Jacques, debout, appuyé sur son fusil, les regarda s'éloigner tristement; puis, au premier détour de la Moselle, ils le saluèrent de leurs avirons, lui de son chapeau, la barque disparut et tout fut dit.
Jacques remit son chapeau sur sa tête, salua la France d'un long et dernier adieu, jeta son fusil sur son épaule, et suivit tête basse le petit chemin tracé par les piétons qui longe les rives de la Moselle, ce petit chemin qui conduit à Trèves.
Jacques Mérey parlait allemand comme un Allemand. Il avait à son carnier, suspendus par le col, quelques petits oiseaux de marais qu'avaient eu la précaution d'y suspendre ses deux compagnons de route. Il ne lui fut fait aucune question. Aux portes, il fut pris pour un bourgeois de la ville revenant de faire une promenade cynégétique.
Mais, la porte franchie, il s'empressa de demander qu'on lui indiquât la demeure du bourgmestre.
Arrivé chez le magistrat, Jacques Mérey se nomma; on savait la catastrophe du 31 mai. Sans avoir le temps de devenir célèbre, le nom de Jacques Mérey avait eu celui de ne pas demeurer inconnu. Le bourgmestre s'inclina, comme tout homme de cœur s'incline devant un proscrit. Dans tous les pays du monde civilisé, à l'honneur de l'humanité et du progrès, à la honte des gouvernements, la proscription est une majesté.
Le bourgmestre demanda, en entourant sa question de toutes les délicatesses de l'homme du monde, s'il avait besoin de ces secours que les gouvernements étrangers avaient mis à la disposition des autorités pour aider à la fuite des émigrés. Mais Jacques Mérey déclara que, étant proscrit et non pas émigré, ses biens n'étaient pas saisis, et que, outre les dix ou douze mille francs qu'il avait sur lui, il laissait une fortune en France.
Ce qu'il désirait, c'était donc tout simplement un passe-port pour Vienne.
Seulement, à cause des circonstances, il fut obligé de tracer le chemin qu'il voulait suivre pour aller à Vienne.
– C'était le plus direct: Carlsruhe, Stuttgart, Augsbourg, Munich et Vienne.
Une fois hors de France, et lorsqu'il ne resta plus dans le cœur de Jacques Mérey que le spectre de la patrie, la vivante image d'Éva reprit peu à peu sa puissance; le souvenir momentanément effacé par les événements, ces événements du passé redeviennent une aurore, et, de même que l'aube se lève derrière les montagnes, ils se lèvent derrière la silhouette aride et décharnée du passé, pour éclairer un nouvel avenir.
Maintenant qu'il était sur le sol étranger, maintenant qu'il ne marchait plus sur cette terre de France sur laquelle Danton voulut mourir, ne pouvant l'emporter à la semelle de ses souliers, il sentit sa pensée s'imprégner de nouveau de son amour, et cet amour, comme une séve réparatrice, ruisseler par tout son corps.
Il n'avait point reçu de lettre d'Éva; mais ce silence ne l'inquiétait aucunement, il savait que les lettres d'Éva étaient confisquées au passage.
Mais ce qui l'inquiétait, c'est qu'Éva, sans soupçon contre sa femme de chambre, devait s'étonner de son silence à lui. Sans doute dans les lettres qu'elle lui écrivait et qu'Éva croyait lui être parvenues, elle lui donnait l'adresse à laquelle il devait répondre.
Comment ne lui répondait-il pas?
Ne se croirait-elle pas oubliée et se croyant oubliée…?
Mais le cœur d'Éva n'était pas un cœur vulgaire; elle connaissait l'amour immense que Jacques Mérey ressentait pour elle; elle l'avait vu renoncer pour elle à toute ambition politique, refuser cette députation qu'il avait accepté ensuite comme une vengeance, et dont les divisions intestines l'avaient empêché de se faire l'arme qu'il espérait pour défendre la République et frapper ses ennemis. Éva aurait meilleure pensée de son ami et d'elle-même; elle n'avait pas pu se croire oubliée.
Jacques avait constamment porté la lettre d'Éva, qui, extraite du dossier du marquis de Chazelay, lui avait été donnée par le jeune aide de camp du général de Custine.
Cette lettre, il la savait par cœur, mais ce n'était point assez de se la redire, la parole est impalpable, et les objets matériels ont, par la vue et par le toucher, une puissance qu'elle n'aura jamais.
Cette lettre il la tirait de la poche la plus secrète de son portefeuille; il la regardait, il la touchait, il la baisait. À trente ans, Jacques, par la façon dont il avait vécu, avait retrouvé toutes les illusions d'un jeune homme; il n'avait jamais eu que deux amours: la science et Éva, et encore avait-il consacré le premier au second.
Rien au reste n'est favorable à la rêverie comme le mouvement d'une voiture. Le bruit monotone des roues vous isole des autres bruits, et tandis que vous avancez toujours, vous enferme avec votre pensée.
Et alors Jacques repassait dans son esprit cette suite d'événements à laquelle il allait devoir le bonheur de retrouver Éva et de la retrouver libre.
Non, Dieu n'était point un Dieu personnel se mêlant à la vie de l'homme et influent sur l'homme. Mais Jacques croyait, nous l'avons dit, à l'influence et même à la volonté de Dieu sur la conduite des grands événements des nations, se dégageant des petits événements de la vie humaine; et c'était ainsi que, par un fil invisible qui le rapprochait des croyances communes, il ramenait en réalité tout à Dieu, mais sans imposer à cette suprême majesté qu'elle s'appelât Dieu, Nature, Providence, la responsabilité des petits accidents de mort et de vie, qu'elle jette en pâture à ces deux divinités qui se disputent l'homme: la fatalité et le hasard.
Ainsi, quelque service qu'ait rendus Jacques à Éva et par contre-coup au marquis de Chazelay, en faisant retrouver la santé, l'intelligence et la raison à sa fille, il ne pouvait combler l'abîme qui, dans cette époque de préjugés sociaux, le séparait de celle qu'il aimait, même en jetant le service rendu dans l'abîme.
Mais si Jacques eût été un de ces chrétiens égoïstes qui rapportent tout à eux, se font le centre de tout et croient que Dieu est prêt à faire choir une étoile du ciel pour qu'ils y allument leur lampe, il se fût dit:
La France a fait une révolution pour que le marquis de Chazelay m'enlevât sa fille, que sans indélicatesse je ne pouvais prendre mystérieusement pour ma maîtresse ou pour ma femme; pour qu'il émigrât avec elle, en la laissant sous la direction de sa tante; pour qu'il se fît tuer en servant contre son pays, ce qui prive non-seulement Éva d'un père, mais lui fait perdre toute sa fortune, puisque la confiscation des biens suit immédiatement la mort de l'émigré pris les armes à la main, et pour que sans père et sans fortune, échappant à toute tutelle, redevenant maîtresse d'elle-même, elle retrouve en moi l'appui et la fortune qu'elle a perdus.
Et, sans faire ces réflexions à ce point de vue, Jacques Mérey n'en suivait pas moins avec cet étonnement croissant de l'homme de génie qui, sans voir l'arbre, ramasse les fruits, toutes ces ramifications étranges qui servent de trame à la vie de l'homme.
Et il ne sortait de son rêve, remontant éternellement du connu à l'inconnu et redescendant sans cesse du matériel à l'idéal, que pour crier au postillon:
– Vite, plus vite!
Une fois en voiture, Jacques avait juré de n'en plus descendre, et de faire sans s'arrêter les cent soixante lieues qui le séparaient de Vienne; mais il avait compté sans les difficultés que les événements politiques mettaient au voyage des Français en Allemagne. Pour tous les princes allemands, en opposition complète avec nos principes, tout Français était un incendiaire prêt à mettre le feu à ses États.
Or, à chaque frontière de principauté, si invisible qu'elle fût sur la carte, il fallait descendre de voiture, subir un interrogatoire et justifier de son identité.
C'est ce que faisait Jacques, et il perdait trois ou quatre heures par jour à ces formalités. Il est vrai que, une fois arrivé à Salzbourg, tout fut dit pour le reste de l'Autriche. La frontière franchie, la route était libre jusqu'à Vienne.
Enfin, toujours pressant de la voix chevaux et postillon, on arriva aux portes de Vienne vers cinq heures de l'après-midi.
Là le voyageur eut à subir un nouvel interrogatoire, une nouvelle visite des papiers.
On lui donna ensuite un permis de séjour d'une semaine, après laquelle il devait faire renouveler sa carte et dire combien de temps il comptait rester dans la capitale de l'Autriche.
Comme il remontait en voiture, le postillon lui demanda où il le devait conduire.
Jacques était décidé à tout brusquer. Il répondit donc:
– Josephplatz, nº 11.
Le postillon s'engagea dans un réseau de petites rues et déboucha enfin en face de la statue de l'empereur qui a fait donner son nom à cette place.
Jacques, la tête passée par la portière, cherchait des yeux laquelle de toutes ces maisons qui forment la place pouvait être celle qu'occupait Éva.
Une seule parmi toutes avait ses portes, ses fenêtres, ses contrevents fermés comme un tombeau.
Il vit avec une angoisse qui dégénéra bientôt en terreur, que le postillon dirigeait la voiture de ce côté.
Enfin il s'arrêta à la porte de cette maison aveugle et muette.
– Eh bien? lui cria Jacques.
– Eh bien! monsieur, répondit le postillon, c'est ici.
– Ici le nº 11?
– Oui.
Jacques sauta hors de la voiture, se recula pour bien voir si c'était en effet la maison désignée, fouilla dans sa poche, rouvrit pour la centième fois le billet de Danton.
Le billet disait bien:
Josephplatz, maison nº 11.
Jacques se jeta comme un fou sur le marteau et la sonnette, et tout à la fois sonna et frappa.
Personne ne répondit.
Le son revenant mat et sourd indiquait que tout était fermé au dedans comme au dehors.
– Ah! mon Dieu, mon Dieu! murmurait Jacques, qu'est-il donc arrivé?
Et il tirait le cordon de la sonnette plus violemment et frappait plus fort. On commençait à s'arrêter.
Enfin un craquement se fit entendre à la maison à côté, une fenêtre s'ouvrit, une tête passa.
C'était celle d'un homme d'une soixantaine d'années.
– Pardon, monsieur, dit-il en bon français avec la politesse viennoise; mais pourquoi vous acharnez-vous à frapper à cette maison où il n'y a personne?
– Comment, personne? s'écria Jacques.
– Non, monsieur, depuis huit jours, du moins.
– Cette maison n'était-elle pas habitée par deux dames?
– Oui, monsieur.
– Deux dames françaises?
– Oui.
– Une vieille et une jeune.
– Une vieille et une jeune! C'est bien cela à ce que je crois, du moins, ne sortant pas de ma bibliothèque et ne m'occupant pas de mes voisins.
– Pardon, pardon, excusez-moi si j'abuse de votre bonté, dit Jacques d'une voix éperdue, mais… mais ces dames, que sont-elles devenues?
– Je crois avoir entendu dire que l'une des deux était morte; oui, c'était même une catholique. Je me rappelle avoir entendu le chant des prêtres, qui m'a dérangé dans mes recherches.
– Laquelle, monsieur? dit Jacques Mérey en joignant les mains; pour l'amour de Dieu, laquelle?
– Comment, laquelle?
– Oui, laquelle, laquelle des deux est morte? la jeune ou la vieille?
– Oh! cela, dit le vieillard, je ne sais pas.
– Mon Dieu! mon Dieu! sanglota Jacques Mérey.
– Mais, reprit le vieillard, si cela vous intéresse, je vais le demander à ma femme; elle se mêle de tout ce qui ne la regarde pas… elle doit le savoir.
– Allez, allez, monsieur, cria Jacques Mérey; allez; je vous en supplie.
Un instant après, le vieillard reparut, Jacques n'avait point respiré pendant son absence.
– Eh bien?
– C'était la vieille.
Jacques chercha un appui contre la voiture et respira lentement.
– Et l'autre, et l'autre? demanda-t-il d'une voix à peine intelligible.
– L'autre?
– Oui, l'autre femme, celle qui n'est pas morte, la jeune, qu'est-elle devenue?
– Je ne sais pas. Il faut que je demande à ma femme.
Et le vieillard s'apprêta à faire un nouveau voyage à la source.
– Monsieur! monsieur! lui cria Jacques. Ne pourrais-je parler directement à votre femme? Il me semble que ce serait plus court.
– Ce serait plus court, en effet, dit le vieillard; mais allez à la troisième fenêtre à partir de celle-ci, c'est celle de la chambre de madame Haal. Je ne lui permets pas de venir dans mon cabinet.
Il disparut, et Jacques alla à la troisième fenêtre.
Pendant ce temps un grand cercle de curieux s'était amassé autour du voyageur, et, comme les deux interlocuteurs avaient constamment parlé français, ceux des auditeurs qui comprenaient le français expliquaient la situation à ceux qui ne le comprenaient pas.
La fenêtre s'ouvrit et madame Haal paru:
C'était une petite vieille, toute coquette et toute bichonnée, qui commença par renvoyer son mari à son cabinet, et de l'air le plus aimable se mit à la disposition de Jacques.
Ceux qui connaissent l'admirable bonhomie des Viennois ne s'étonneront point de ces détails. Ils sont dans les mœurs de cette population, l'une des meilleures et des plus obligeantes qu'il y ait au monde.
Jacques ne laissa point à la petite vieille le temps de parler, et en excellent allemand:
– Madame, lui dit-il, j'ai le plus grand intérêt à savoir le plus tôt possible ce qu'est devenue la plus jeune des deux dames françaises qui habitaient dans la maison qui touche à la vôtre.
– Monsieur, répondit madame Haal, je puis vous le dire pertinemment; la plus jeune des deux dames, qui s'appelait mademoiselle Éva de Chazelay, est partie après les derniers devoirs rendus à sa tante, pour tâcher de retrouver en France un homme qu'elle aimait.
– Oh! murmura Jacques Mérey, pourquoi ne suis-je pas resté avec mes amis pour mourir comme eux et avec eux!