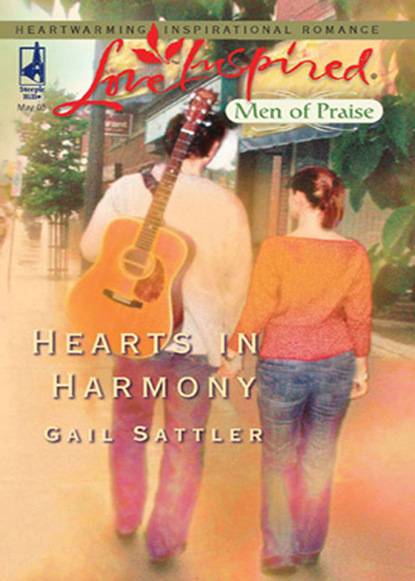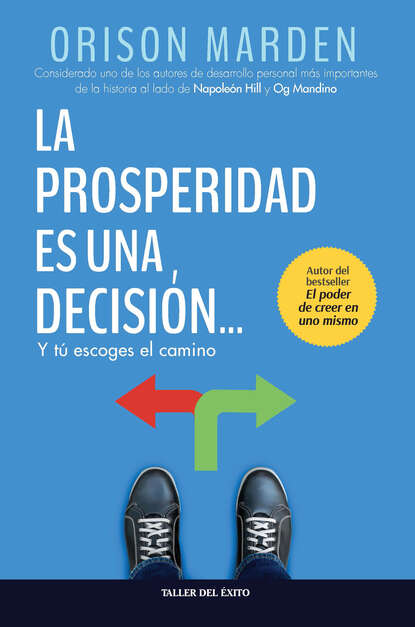Création et rédemption, deuxième partie: La fille du marquis

- -
- 100%
- +
Et elle pressa le pas.
Quoique la nuit fût noire, elle vit comme une masse plus noire se dresser dans la nuit la maison du docteur terminée par son laboratoire.
Le laboratoire était sombre, les volets des autres fenêtres étaient fermés, aucun filet de lumière ne passait par une fenêtre quelconque.
Elle s'arrêta, une main sur son cœur, la tête renversée en arrière.
Le commissionnaire, n'entendant plus son pas derrière le sien, s'arrêta aussi.
– Vous êtes fatiguée, mademoiselle, dit-il, ce n'est pas un beau temps pour s'arrêter en route. Je vous en préviens, une pleurésie est bientôt prise.
Ce n'était pas la fatigue qui retenait Éva en arrière, c'était la masse de souvenirs qui l'écrasait.
Puis, plus elle approchait, plus la maison lui apparaissait morne, sombre et solitaire.
Enfin on atteignit les quelques marches qui conduisaient à la porte.
Le commissionnaire déposa sa malle sur la première marche.
– Faut-il frapper ou sonner? demanda-t-il.
Éva se rappela qu'elle avait l'habitude de frapper d'une certaine façon.
– Non, dit-elle, restez là, je frapperai moi-même.
En montant l'escalier, ses genoux tremblaient; en mettant la main sur le marteau, sa main était aussi froide que le marteau.
Elle frappa deux coups rapprochés, puis un coup un peu plus espacé, et elle attendit.
Un hibou qui avait son refuge dans le grenier au-dessus du laboratoire de Jacques, répondit seul par son ululement.
– Ô mon Dieu! murmura-t-elle.
Elle frappa une seconde fois; pour mieux voir, en même temps, le commissionnaire levait sa lanterne.
En ce moment, le hibou, attiré par la lumière, passa entre la lanterne et Éva.
Éva sentit le vent de son aile.
Elle poussa un faible cri.
Le commissionnaire eut peur, il laissa tomber la lanterne, qui s'éteignit.
Il la ramassa; une lumière brillait à travers une petite fenêtre étroite et basse.
– Je vais aller rallumer ma lanterne, dit-il.
– Non, restez, fit Éva en lui mettant la main sur l'épaule; il me semble que j'entends du bruit dans la maison.
En effet, on venait d'entendre le bruit d'une porte qui se refermait; puis un pas lourd qui descendait lentement l'escalier.
Ce pas s'approcha de la porte. Éva était muette et tremblante comme s'il s'agissait de sa vie.
– Qui est là? demanda une voix tremblante.
– Moi, Marthe, moi! répondit Éva d'une voix joyeuse.
– Ô mon Dieu, notre chère demoiselle! s'écria la vieille femme, qui avait reconnu la voix d'Éva après trois ans d'absence.
Et elle ouvrit vivement la porte.
– Et le docteur? demanda-t-elle.
– Il vit, répondit Éva; il se porte bien. Dans quelques jours il sera ici.
– Qu'il revienne! Que je le revoie et que je meure! dit la vieille Marthe. Voilà tout ce que je demande à Dieu.
** *En quittant la petite maison de la rue de Provence, Jacques Mérey était rentré à l'hôtel de Nantes qu'il avait trouvé vide.
Il avait poussé un soupir.
Peut-être était-il triste d'avoir été si vite et si bien obéi.
Il fit venir une marchande à la toilette, lui donna tous les vêtements qu'Éva portait sur elle lorsqu'elle s'était jetée à la Seine, jusqu'aux bas et aux souliers, et lui ordonna en échange de donner 10 francs au premier pauvre qu'elle rencontrerait.
Mais il remit et renferma dans son portefeuille la lettre du marquis de Chazelay.
Puis il s'enferma dans la chambre d'Éva, où il s'était fait servir d'avance son souper, déroula le manuscrit et commença de lire.
Le titre du premier chapitre était: En France.
IX
LE MANUSCRIT
I
Ce fut le 14 août 1792, jour de cruelle mémoire, que je fus séparée de mon bien-aimé Jacques, près duquel j'étais depuis sept ans, et que j'adorais depuis le jour où j'eus la connaissance de moi-même.
Je lui dois tout. Avant lui je ne voyais pas, je n'entendais pas, je ne pensais pas; j'étais comme ces âmes que Jésus a tirées des limbes, c'est-à-dire des lieux bas, pour les conduire au soleil.
Aussi, malheur à moi si j'oubliais jamais, ne fût-ce qu'une seconde, celui à qui je dois tout!
(Arrivé là de sa lecture, Jacques poussa un soupir, laissa tomber sa tête sur sa main, et une larme glissa de ses paupières sur le manuscrit. Il l'essuya avec son mouchoir, s'essuya les yeux et se remit à lire.)
Le coup était d'autant plus violent qu'il était plus inattendu.
Une heure avant l'arrivée du marquis de Chazelay, – je n'ai pas encore le courage d'appeler mon père cet homme que je ne connais que par la douleur, – il n'y avait pas d'être plus heureux que moi. Une heure après qu'il m'eût séparée de mon Jacques, il n'y eut pas de créature plus malheureuse.
J'étais folle de douleur, plus que folle, idiote. On eût dit que Jacques avait gardé avec lui toutes les idées que, avec si grand'peine, pendant sept ans, il m'avait fait entrer dans le cerveau.
On m'emmena au château de Chazelay.
Du château de Chazelay, de ses appartements immenses, de ses meubles splendides, de ses portraits de famille, je ne me souviens que d'une simple peinture.
C'était le portrait d'une femme en robe de bal.
On me le montra en disant:
– Voilà le portrait de ta mère!
– Où est-elle, ma mère? demandai-je.
– Elle est morte.
– Comment?
– Un soir qu'elle s'habillait pour aller à une fête, le feu prit à sa robe; elle se sauva d'appartement en appartement, le vent activa la flamme, elle tomba étouffant quand on vint à elle pour la secourir.
Il y avait une tradition dans les environs que, si quelque malheur devait arriver à l'un des habitants du château, on entendait des cris et l'on voyait la nuit, à travers les fenêtres, tournoyer des flammes.
On ne parlait que de la chasteté de sa vie, que du bien qu'elle faisait, que de la reconnaissance des pauvres gens pour elle.
C'était tout à la fois une sainte et une martyre.
Dans la situation d'esprit où j'étais, ma mère m'apparaissait comme mon seul refuge; c'était mon intermédiaire naturel auprès du Seigneur.
Je passais des heures à genoux devant son portrait, et, à force de la regarder, je croyais voir s'illuminer son auréole.
Puis quand je me levais de devant elle, c'était pour aller coller mon visage aux carreaux d'une fenêtre du même salon donnant sur la route d'Argenton. J'espérais toujours, quoique je comprisse la folie de cette espérance, j'espérais toujours le voir arriver pour me délivrer.
On avait d'abord ordonné de ne pas me laisser sortir; mais lorsque M. de Chazelay vit dans quel état de torpeur je m'enfonçais de plus en plus, il ordonna lui-même que l'on m'ouvrit toutes les portes. Il y avait tant de serviteurs au château, que l'un d'eux pouvait toujours avoir les yeux sur moi.
Un jour, voyant les portes ouvertes, je sortis machinalement; puis, à cent pas du château, je m'assis sur une pierre et me mis à pleurer.
Au bout d'un instant, je vis une ombre se projeter sur moi; je levai la tête: un homme était debout et me regardait avec une expression de pitié.
Moi je le regardai avec une expression d'effroi, car c'était le même homme qui accompagnait le marquis et le commissaire de police quand le marquis était venu me réclamer; le même qui t'avait fait une visite quelques jours auparavant, mon bien-aimé Jacques, et qui m'avait trouvée si fort embellie: c'était enfin mon père nourricier, Joseph le bûcheron.
Cet homme me fit horreur; je me levai et voulus m'éloigner.
Mais lui:
– Il ne faut pas me haïr pour ce que j'ai fait, ma chère demoiselle, car je ne pouvais pas faire autrement. M. le marquis avait une reconnaissance de ma main constatant que je vous avais reçue de lui et que je m'obligeais à vous rendre à lui à la première réquisition. Il est venu et il a exigé mon témoignage. Je l'ai donné.
Il y avait dans la voix de cet homme un tel accent de vérité que je me contentai de lui dire en me rasseyant:
– Je vous pardonne, Joseph, quoique vous ayez contribué à me rendre bien malheureuse.
– Il n'y a pas de ma faute, ma chère demoiselle, et, si je puis racheter cela par des complaisances, ordonnez et je vous obéirai de grand cœur.
– Vous iriez à Argenton si je vous en priais?
– Sans doute.
– Et vous lui remettriez une lettre?
– Certainement.
– Attendez. Mais je n'ai ni plume, ni encre, on ne voudra pas m'en donner au château.
– Je vais vous procurer du papier et un crayon.
– Où les irez-vous chercher?
– Au prochain village.
– Je vous attends ici.
Joseph partit.
Depuis que j'avais dépassé la grande porte du château j'entendais des abois désespérés.
Je me retournai du côte d'où ils venaient, c'était Scipion qu'ils avaient mis à la chaîne et qui s'élançait de toute la longueur de sa chaîne pour venir me rejoindre.
Mon pauvre Scipion, pendant huit jours, comprends-tu, mon bien-aimé Jacques, je l'avais oublié!
Que veux-tu, j'eusse oublié jusqu'à ma vie, si je n'avais souffert!
Ce fut pour moi une grande joie que de revoir Scipion. Quant à lui, il était fou de bonheur.
Joseph revint avec du papier et un crayon; je t'écrivis une lettre insensée au fond de laquelle il n'y avait en réalité que ces deux mois: je t'aime.
Mon messager partit; le lendemain à la même heure je devais le retrouver à la même place.
J'avais peur que l'on m'empêchât d'emmener Scipion dans ma chambre, mais on n'y fit même pas attention.
Je ne pouvais me lasser de lui parler et, folle que j'étais de lui parler de toi, je ne sais si c'était ton nom qu'il reconnaissait ou l'accent avec lequel je le prononçais; mais, à chaque fois qu'il l'entendait, il jetait un petit cri tendre, comme si lui aussi avait dit: Je l'aime.
Dès le point du jour j'étais à ma fenêtre; je pensais que Joseph aurait passé la nuit chez toi à Argenton, et qu'il arriverait le matin.
Je m'étais trompée, il était revenu la nuit même. Quand je sortis du château, je vis, à l'endroit où j'étais assise la veille, un homme qui était couché sur l'herbe et qui faisait semblant de dormir.
Je m'approchai; c'était lui; mais je vis bien, au premier regard que je jetai sur lui, qu'il n'avait que de mauvaises nouvelles à m'apprendre.
En effet, tu étais parti, mon bien-aimé Jacques, et cela sans dire où tu allais.
Joseph me rapportait ma lettre.
Je la déchirai en morceaux impalpables que je livrai au vent. Il me semblait déchirer mon cœur lui-même.
Joseph était au désespoir.
– Je ne puis donc rien pour vous? me dit-il.
– Si fait, lui répondis-je, vous pouvez me parler de lui.
Alors avec des choses relatives à la manière dont tu m'avais trouvée et que tu m'avais racontées toi-même, il me raconta des choses que je ne savais point. Ces espèces de miracles opérés par toi sur des animaux furieux; comment tu domptais les chevaux, les taureaux, comment tu avais dompté Scipion; il me montra la voûte du mur où le chien s'était réfugié, quand tu le forças de venir rempant à tes pieds; puis des animaux il passa aux hommes et me raconta les merveilleuses cures que tu avais faites: un enfant mordu par une vipère que tu avais sauvé en suçant la plaie, un chasseur qui s'était mutilé le bras avec son fusil, à qui on voulut couper le bras, et à qui tu te conservas; que te dirai-je, mon bien-aimé Jacques, les mêmes souvenirs que je croyais toujours nouveaux. Un jour cependant la conversation changea.
– Mademoiselle, me dit Joseph avant que j'eusse eu le temps de lui adresser la parole, savez-vous une nouvelle?
– Laquelle?
– C'est que M. le marquis part; il émigre.
Je songeai aussitôt au changement que le départ du marquis allait faire dans mon existence, à la liberté qu'il allait me donner.
– En êtes-vous sûr? lui demandai-je avec un mouvement de joie que je ne pus réprimer.
– Cette nuit, ses amis se ressemblent au château; on y tient conseil sur la façon d'émigrer, et, quand chaque fugitif aura arrêté son moyen de fuite, on partira.
– Mais qui vous a dit cela, à vous, Joseph? Vous n'êtes pas, il me semble, des conseils du marquis?
– Non. Mais comme il sait que je tire proprement un coup de fusil, que je tue un lapin au déboulé et une bécassine à son troisième crochet, il serait bien aise de m'avoir près de lui.
– Et il vous a fait des offres?
– Oui. Mais je suis du peuple, moi, et par conséquent pour le peuple. De sorte que je lui ai dit: Monsieur le marquis, si nous nous retrouvons là-bas, ce sera l'un contre l'autre, et non pas l'un avec l'autre.
– Mais, m'a-t-il dit, je sais que tu es honnête homme et que le secret de mon départ, que je te confie, tu le garderas. Or, comme ce secret n'en doit pas être un pour vous et que vous ne dénoncerez pas votre père, je vous le dis pour que, de votre côté, si vous avez des mesures à prendre, vous les preniez.
– Quelle mesure voulez-vous que je prenne? Je ne dispose de rien et l'on dispose de moi; je laisserai faire à la Providence.
Le lendemain de cet entretien, mon père me fit prier de passer chez lui.
Je ne lui avais parlé que deux fois depuis qu'il m'avait repris à toi, mon bien-aimé! Il m'avait demandé si je voulais manger avec tout le monde ou dans ma chambre: je m'étais empressée de répondre: Dans ma chambre; quand on est séparé de celui qu'on aime, être seule c'est être à moitié avec lui.
Je passai chez le marquis.
Il aborda immédiatement la question.
– Ma fille, me dit-il, les circonstances deviennent telles que je dois songer à quitter la France; d'ailleurs, mon opinion, mon rang dans la société, ma position parmi la noblesse de France, me forcent d'aller offrir mon épée aux princes. Dans huit jours j'aurai rejoint le duc de Bourbon.
Je fis un mouvement.
– Ne vous inquiétez pas de moi, dit-il; j'ai des moyens sûrs de quitter la France. Quant à vous, qui ne courez aucun risque et n'avez aucun devoir à remplir, vous resterez à Bourges avec votre tante: elle vient vous chercher demain. Avez-vous des observations à me faire?
– Aucune, monsieur, je n'ai qu'à vous obéir.
– Si notre séjour à l'étranger paraît devoir se prolonger, ou si vous couriez quelque danger en France, je vous écrirais de venir me rejoindre, et nous nous fixerions hors de France pour tout le temps que durera leur infâme révolution, qui du reste, je l'espère bien, n'en a pas pour longtemps. Comme nous n'avons plus que trois ou quatre jours à passer ensemble, si vous voulez pendant ce temps prendre votre dîner en même temps que nous et avec nous, vous me ferez plaisir.
Je m'inclinai en signe d'assentiment.
Sans doute les jeunes nobles qui s'étaient réunis au château la nuit précédente y étaient restés, car le marquis avait une douzaine de convives.
Il me présenta à eux, et je vis bien vite quel était le but de cette présentation.
Trois ou quatre étaient jeunes, élégants, beaux, bien faits. Mon père voulait savoir si l'un d'entre eux ne parviendrait pas à attirer mes regards.
Mon père n'avait donc jamais aimé, qu'une pareille idée lui ait passé par l'esprit! Douze jours après que je t'avais quitté, toi ma vie, toi mon âme, toi mon Jacques bien-aimé, penser que mes yeux pouvaient s'arrêter sur un autre homme!
Je ne me fâchai même pas d'une semblable supposition; j'en haussai les épaules.
Le lendemain, ma tante arriva. Je ne l'avais jamais vue.
C'est une grande fille sèche, dévote et prude; elle n'a jamais dû être jolie, et par conséquent n'a jamais été jeune.
Son père, ne pouvant pas la marier, en fit une chanoinesse.
En 1789 elle sortit de son couvent et rentra dans la société avec six ou huit mille livres de rentes que lui faisait mon père. Seulement elle ne voulut pas quitter Bourges, sa ville chérie, pour venir demeurer au château de Chazelay.
Elle avait donc loué une maison à Bourges.
Elle avait été, quelques années après ma naissance, mise au courant de ma laideur et de mon idiotisme; puis on n'avait plus jugé à propos de lui parler de moi.
Quand le marquis lui écrivit de venir me chercher, elle s'attendait donc à trouver quelque horrible magote branlant la tête à droite et à gauche avec des yeux chinois, et exprimant ses désirs par des mots inintelligibles.
J'étais depuis une demi-heure en face d'elle qu'elle cherchait encore où je pouvais être. Enfin elle demanda qu'on lui amenât sa nièce, et, quand on lui dit que c'était elle qu'elle avait sous les yeux, elle fit un soubresaut d'étonnement.
Je crois que ma digne tante, forcée par les obligations qu'elle avait au marquis de me garder près d'elle, m'eût préféré plus laide et plus sotte. Mais je lui dis tout bas:
– C'est comme cela qu'il m'aime, ma bonne tante, et, ne vous en déplaise, je resterai ainsi.
Notre départ fut fixé au lendemain et celui du marquis à la nuit du surlendemain. Il avait pour état-major une partie de la noblesse du Berri et une cinquantaine de paysans, auxquels il promit une solde de cinquante sous par jour.
Le jour de notre départ, je dis adieu à Joseph le braconnier, qui me dit en me quittant:
– Je ne sais pas l'adresse de Jacques Mérey; mais, comme il est de l'Assemblée nationale, en lui adressant vos lettres à la Convention, il n'y a pas de doute qu'elles ne lui parviennent.
Ce fut le dernier service que cet excellent homme me rendit!
II
Le lendemain de notre départ du château de Chazelay, nous arrivâmes à Bourges. Notre voyage s'était fait dans une petite voiture des remises du marquis et avec un cheval de ses écuries; un paysan nous conduisait.
Mademoiselle de Chazelay devait renvoyer le paysan et garder la voiture et le cheval.
Il résulta de cet arrangement que nous couchâmes à Châteauroux.
Je mourais d'envie de t'écrire, mon bien-aimé Jacques! mais sans doute le marquis avait renseigné sa sœur à ton endroit, car mademoiselle de Chazelay ne détourna pas un instant ses yeux de dessus moi, et me fit coucher dans sa chambre.
J'espérais être plus libre à Bourges, et, en effet, j'eus ma chambre à moi, une chambre donnant sur un jardin.
À peine arrivée, mademoiselle de Chazelay se hâta d'organiser la maison; elle avait une vieille servante nommé Gertrude qui l'avait suivie au couvent, mais qui, en me voyant arriver, déclara qu'elle n'admettait point ce surcroît de travail.
Ma tante fit donc demander par Gertrude une femme de chambre à son confesseur, qui lui envoya le même jour une de ses pénitentes nommée Julie.
Je l'étudiai; mais je connais encore bien peu le cœur humain, même celui des femmes de chambre. Je crus le troisième jour pouvoir me fier à elle et lui donner une lettre pour toi; elle m'assura l'avoir mise à la poste, ainsi qu'une seconde et qu'une troisième; mais, comme je n'ai jamais reçu de réponse de toi, je commence à croire que j'ai été trop confiante et que mademoiselle Julie les a remises à ma tante au lieu de les porter à la poste.
À part ton absence, mon bien-aimé Jacques, et le doute où j'étais, non pas de ton amour, Dieu merci, je sens à mon cœur que tu m'aimas toujours, mais de notre réunion, le mois que je passai à Bourges ne fut point malheureux; sans m'aimer, ma tante avait des égards pour moi; elle avait gardé le paysan, l'avait habillé d'une espèce de carmagnole et en avait fait son cocher. Tous les jours, sous prétexte du soin qu'elle prenait de ma santé et en même temps de la sienne, elle nous promenait deux heures, et le reste du temps, à part l'heure des repas, j'avais toute liberté dans ma chambre.
J'en usais en restant seule.
Depuis que l'idée m'était venue que Julie avait pu me trahir, je la détestais autant que je puis détester, ce qui n'est pas bien fort; et, pour ne pas voir une créature qui m'était désagréable et à laquelle je ne voulais pas faire la peine de la renvoyer, je lui interdisais l'entrée de ma chambre.
Ma tante était abonnée au Moniteur. Je dévorais tous les jours le journal dans l'espérance d'y trouver ton nom. Deux ou trois fois mon espérance fut accomplie. D'abord je vis ton nom parmi les députés de l'Indre lors de l'appel nominal, puis je vis que tu avais été envoyé en mission près de Dumouriez, que tu lui avais servi de guide dans la forêt d'Argonne, enfin que tu avais rapporté à la Convention les drapeaux pris à Valmy.
Mais, huit ou dix jours après la bataille de Valmy, nous reçûmes une lettre du marquis, qui nous disait que les choses politiques n'allaient point tout à fait selon son espoir, et qu'il nous invitait à nous tenir prêtes à le rejoindre au premier avis que nous recevrions de lui.
Nous fîmes nos préparatifs de départ de manière à n'avoir qu'à nous mettre en route aussitôt que le marquis nous appellerait.
Nous le trouverions occupé au siége de Mayence.
Quoique l'on commençât à être sévère aux émigrations des hommes, qui emportaient un danger avec eux puisqu'ils n'émigraient que pour revenir combattre contre la France, on s'inquiétait assez peu des émigrations des femmes. Les autorités de Bourges d'ailleurs, demeurées royalistes, nous munirent de tous les papiers nécessaires pour assurer notre voyage, et nous partîmes en poste dans notre petite voiture.
Nous gagnâmes la frontière et nous la traversâmes sans avoir couru un danger réel; mais, un peu au delà de Sarrelouis, nous trouvâmes des prisonniers émigrés que l'on ramenait à une forteresse ou à une citadelle pour les faire fusiller.
Nous poussâmes jusqu'à Kaiserlautern.
Là nous apprîmes la prise de Mayence par le général Custine. Comme deux femmes à la recherche d'un frère et d'un père ne courront jamais un risque quelconque de la part d'un général français, nous poussâmes jusqu'à Oppenheim. Là les nouvelles devinrent plus précises et en même temps plus inquiétantes.
Dans un des derniers combats qui avaient eu lieu quelques jours auparavant, un certain nombre d'émigrés avaient été pris, et, lorsque ma tante prononça le nom du marquis de Chazelay, celui qu'elle interrogeait lui dit qu'en effet il croyait avoir entendu ce nom-là. Au reste, les prisonniers avaient été conduits à Mayence, et, vivants ou morts, c'était là seulement que l'on pouvait avoir de leurs nouvelles.
Nous poussâmes jusqu'à Mayence. Aux portes, on nous arrêta.
Il nous fallut écrire au général Custine. Nous ne lui cachâmes rien; nous lui dîmes qui nous étions, et le but sacré qui nous amenait à Mayence.
Un quart d'heure après, un de ses officiers d'ordonnance venait nous chercher.
– Ah! mon bien-aimé Jacques, la nouvelle était terrible. Mon père, pris les armes à la main, avait été condamné et fusillé dans les vingt-quatre heures.
Je n'avais pas de puissantes raisons d'adorer un père qui m'avait abandonnée dans mon enfance et qui ne m'avait reprise que pour me briser le cœur. Cependant, au moment où j'appris l'horrible catastrophe, je le pleurai filialement.
Mais alors un incident complètement imprévu vint faire trêve à ma douleur. Le jeune officier que le général nous avait donné pour nous accompagner, me demanda à m'entretenir d'une chose importante; d'un regard je sollicitai de ma tante la permission de l'écouter. Elle crut, comme il avait commandé le détachement exécutionnaire, qu'il avait à me transmettre de la part du marquis quelques recommandations suprêmes et je le suivis dans un cabinet, tandis que ma tante se faisait donner, pour constater le décès, le procès-verbal de l'exécution.
– Mais là, chose incroyable, de qui penses-tu que me parla cet inconnu? De toi, mon bien-aimé Jacques. Tu étais venu deux jours avant à Mayence pour savoir si parmi les papiers trouvés sur mon père il n'y aurait pas quelqu'un qui pût t'apprendre notre adresse, et non-seulement tu avais appris que nous demeurions à Bourges, mais encore tu avais pu lire une lettre de moi, à toi adressée, soustraite par ma tante et envoyée par elle à son frère. Cette lettre, mon bien-aimé Jacques! il me dit avec quels transports de joie tu l'avais lue; que tu avais demandé à la copier; qu'il t'avait autorisé à la prendre en en laissant copie; que, la copie faite, tu avais pris la lettre, tu l'avais baisée, tu l'avais mise sur ton cœur.
Mon Dieu! que cette voix du sang est peu de chose, mon bien-aimé Jacques, abandonnée à elle-même! que ces mots dits tout à coup, à propos d'un homme que l'on croyait étranger —c'est ton père!– ont peu de puissance, puisqu'en face de cette tombe de mon père à peine refermée, ton nom prononcé j'oubliai tout! C'est que tu es mon véritable père, toi! À part la vie matérielle, je te dois tout. Je suis ton enfant, je suis ton œuvre, je suis ta création; et avec cela, dans sa suprême bonté, Dieu a voulu que je pusse être autre chose.