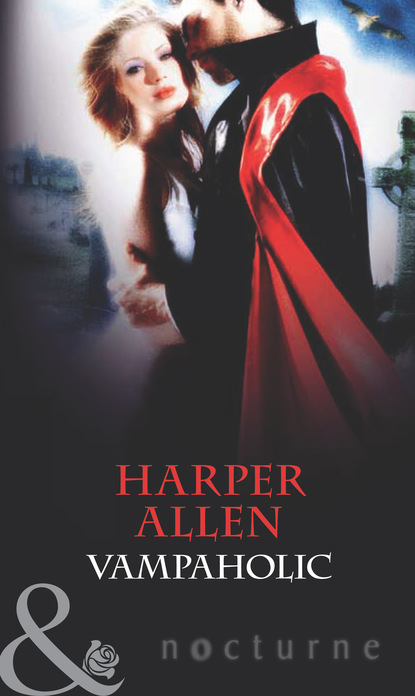Création et rédemption, deuxième partie: La fille du marquis

- -
- 100%
- +
Quand je sortis du cabinet où cet excellent jeune homme venait de m'apprendre ton passage, j'étais honteuse de moi. J'avais des larmes dans les yeux; mais, larmes et sourires, tout était pour toi.
Oh! que l'amour est bien ce que tu m'as dit, l'âme de la création tout entière, le fluide obstiné qui perpétue la vie, et qui des parcelles de temps de notre vie fait l'éternité des êtres. Nous rêvons Dieu, nous sentons l'amour; l'amour ne serait-il pas le seul, l'unique, le vrai Dieu?
Je cachai ma joie dans mon voile. Qu'eût dit la rigide chanoinesse en voyant ces fausses larmes et ce vrai sourire.
Ainsi je m'étais reprise à espérer. Depuis que nous avions été séparés, c'était la première fois que j'entendais parler de toi. Le fil de ma vie presque brisé se renouait, plus ardent que jamais, à l'amour et au bonheur.
Mais toi, de ton côté, qu'allais-tu faire, pauvre bien-aimé? courir après une nouvelle déception. Je te voyais reprenant la poste dans l'espoir de me retrouver à Bourges, te penchant en avant, pressant le postillon et arrivant dans notre sombre rue, en face de notre triste maison, pour trouver la maison fermée et apprendre mon départ.
Mais, n'importe! Je me disais, égoïste que j'étais, que toutes ces secousses-là feraient revivre ton amour comme celle que je venais de recevoir avait galvanisé le mien.
Le reste de la journée fut consacré à une visite à la tombe du marquis. Là je retrouvai des larmes. Le général nous permit de mettre une pierre sur la fosse, avec le nom de celui qu'elle recouvrait.
Mademoiselle de Chazelay s'obstinait à vouloir mettre dessus: Mort pour son roi. Mais le général lui fit observer qu'une pareille inscription ferait mettre avant vingt-quatre heures la pierre en morceaux par les soldats de la République.
Nous quittâmes Mayence dans la même nuit, et nous prîmes la route de Vienne. C'était là que mademoiselle de Chazelay voulait fixer sa résidence. Elle avait une douzaine de mille francs en or avec elle. Il ne fallait plus compter sur autre chose. Toute notre fortune était là.
Il était évident que la République héritait des biens du marquis de Chazelay, émigré pris les armes à la main et fusillé.
Nous partîmes donc pour Vienne, mais nous cessâmes de voyager en poste. Nous prîmes nos places à une diligence, et je priai tant qu'on laissa mon pauvre Scipion monter avec nous.
Scipion, c'était le dictionnaire de ma vie passée.
Nous arrivâmes à Vienne, et nous descendîmes d'abord dans le plus beau quartier de la ville, à l'Agneau d'or.
Ma tante confia au maître de la maison qu'elle désirait louer une petite maison dans un quartier calme et retiré. Trois jours après, une vieille dame venait nous prendre en voiture et nous conduisait à la place de l'Empereur-Joseph où elle avait une petite maison garnie.
Cette petite maison nous convenait sous tous les rapports. La propriétaire en voulait cent louis par an. Ma tante, après longue discussion l'obtint à deux mille francs, avec faculté de renouveler le bail d'année en année tant qu'il lui plairait.
À la fin de chaque année elle pouvait résilier, mais l'année commencée elle devait payer l'année entière.
Nous nous installâmes à Josephplatz.
Aussitôt installée, comme je n'avais plus de femme de chambre pour m'espionner, – ma tante avait jugé que nous pouvions nous servir seules, et que par conséquent cette dépense était inutile, – comme je n'avais plus de femme de chambre pour m'espionner, je t'écrivis une longue lettre et je la mis moi-même à la poste.
Ni celle-là ni trois autres que j'écrivis n'obtinrent de réponse.
Je me désespérai. M'avais-tu donc oubliée? Cela me semblait impossible.
Hélas! depuis j'ai réfléchi.
Il y avait une double raison pour que mes pauvres lettres ne t'arrivassent point.
Ne sachant point ton adresse, je t'écrivais:
«À monsieur Jacques Mérey, député du département de l'Indre à la Convention.»
J'ignorais les défiances du gouvernement autrichien. Mes lettres étaient décachetées et lues.
Puis celui qui était chargé de ce triste office de lire les lettres ne jugeait pas à propos de recacheter mes lettres et de leur faire suivre leur cours.
C'est si peu important pour un indifférent des lettres d'amour!
J'eusse donné la moitié de mon sang pour une lettre de toi!
Et, en supposant même que mes lettres eussent été remises à la poste, est-ce que la police française eût fait parvenir à monsieur Jacques Mérey, député à la Convention, des lettres de Vienne.
Cette appellation de monsieur, complètement abolie à Paris, sentait son aristocratie d'une lieue.
J'étais bien malheureuse lorsque ces observations que je fais ici me furent faites par un vieux savant, notre voisin, avec la femme duquel ma tante allait faire parfois sa partie de whist.
Une chose qui te fera rire, mon cher Jacques, c'est que ce vieux savant aimait à causer avec moi, disait-il, parce que j'étais savante.
Moi savante! Hélas la chose que j'eusse dû savoir avant tout c'est que, pour que mes lettres t'arrivassent, il ne fallait pas écrire à monsieur Mérey, mais au citoyen Mérey.
Une fois que j'eus trouvé la cause de ton silence, mon Jacques, bien loin de t'en vouloir, je t'en aimai davantage. Mais ce n'était pas le tout de t'aimer de mon côté, je voulais que tu m'aimasses du tien.
Or ce point de la cause de ton silence éclairci, tu m'aimais toujours; que m'importait le reste. Ton amour n'était-il pas tout pour moi.
III
La vie que nous menions, ma tante et moi, à Vienne, ressemblait beaucoup à celle que nous menions à Bourges.
Nous avions pris une femme pour nous servir; c'était une vieille Française, dont le mari, domestique d'un attaché d'ambassade, était mort à Vienne.
Tant qu'il y avait eu ambassade française à Vienne, l'ancien maître du mari de Thérèse avait aidé la veuve; mais depuis la guerre avec l'Autriche, l'ambassadeur français avait pris ses passeports, et Thérèse s'était mise à faire les ménages de ses compatriotes émigrés.
Depuis la mort de mon père, ma tante, tombée dans une espèce de spleen, ne s'occupait plus ou paraissait ne plus s'occuper de nos amours.
J'étais libre, j'avais ma chambre à moi; j'y demeurais seule tant que je voulais, et j'avais tout le temps de t'écrire.
Pendant le premier mois de mon arrivée, je t'écrivis toutes les semaines; seulement ma tristesse était profonde de voir que quoique je t'adjurasse, au nom des plus douces heures de notre amour, de me répondre, tu ne me répondais pas; cette fois, je ne pouvais pas même concevoir l'idée que mes lettres étaient détournées, puisque deux ou trois fois j'avais mis mes lettres moi-même à la poste.
Vers le troisième mois de notre séjour à Vienne, j'eus une grande douleur; mon pauvre Scipion s'en allait mourant de vieillesse.
C'était avec toi le seul être qui m'eût véritablement aimée; et lui qui t'avait quitté volontairement pour me suivre quand le marquis m'avait enlevée, lui qui était venu avec moi en exil, ne m'aimait-il pas mieux que toi dont le silence incompréhensible accusait l'oubli?
Si ton silence venait de ta fierté blessée, je le comprenais encore tant que le marquis vivait; mais, le marquis mort, tu n'avais plus aucun motif pour ne pas m'écrire; d'ailleurs, ne savais-je point par l'officier d'ordonnance du général Custine que tu m'aimais toujours?
N'avais-je pas pleuré de joie quand il m'avait raconté tes transports de joie à la lecture de ma lettre?
Je me dis que sans doute certaine partie de mon cerveau n'avait pas été suffisamment développée par toi, que le temps t'avait manqué pour achever mon entière création; que de cette partie incomplète venait le trouble dans lequel je me perdais.
Scipion ne me quittait plus d'un pas; on eût dit que la puissance de son attachement pour moi lui avait inspiré la révélation de sa mort prochaine.
Et moi, en le voyant s'affaiblir de jour en jour, je le regardais tristement. Scipion c'était le catalogue de toute ma vie. Avant que personne m'aimât, il m'aimait; quand je n'étais qu'une masse inerte, il me réchauffait; quand j'étais impuissante à percevoir moralement, je le percevais physiquement. Il fut, quand la vue me fut donnée, le premier être que je vis, et quand peu à peu je reçus le mouvement, il fut mon premier moyen de locomotion; à tous mes souvenirs de toi, il est mêlé, et ce fut à travers lui en quelque sorte que j'arrivai à toi. Depuis que nous sommes séparés, pour parler de toi je n'ai que lui; et aujourd'hui que la mort s'approche, que son regard trouble m'entrevoit avec peine, si je lui demande où est notre maître bien-aimé à tous deux, il comprend de qui il est question, et par de douces plaintes arrachées à ton nom il semble me dire: Pas plus que toi je ne sais où il est, mais comme toi, tu vois bien que je le pleure.
Les journaux français sont défendus ici; mais comme, grâce à toi, l'allemand est devenu pour moi une seconde langue maternelle, je lis les journaux allemands. J'ai vu ton vote dans le procès de ce malheureux roi dont nous ne nous étions jamais occupés ensemble, dont nous avions parlé deux ou trois fois à peine, dont j'ignorais presque l'existence. Quand, au nom de la patrie, on est venu te chercher pour lutter contre son pouvoir expirant, tu n'as pas voulu voter la peine de mort, cœur miséricordieux, et tu t'es exposé aux murmures et peut-être à la vengeance de toute l'Assemblée pour rester fidèle, non pas dans ta foi, – car je sais ce que tu pensais, – mais dans ton humanité.
Tu n'as aucune idée de la façon dont on s'illusionne ici. Tous les émigrés passent ici, et dans leur nombre immense nous en voyons quelques-uns parlant de leur retour en France comme d'une chose prochaine et sûre; selon eux, la mort du roi, loin de gâter les affaires de l'émigration, les rend meilleures; si la tête du roi tombe, disent-ils, toute l'Europe se soulèvera, et il me semble impossible que la France résiste à toute l'Europe, quoique je désire bien rentrer en France, puisque rentrer en France ce sera me rapprocher de toi. Je ne voudrais pas rentrer à ce prix, il me semble que c'est une impiété d'espérer une pareille chose.
Inutile de te dire que ma tante est au nombre de ceux qui espèrent rentrer en France de cette façon.
Si je n'étais pas si triste, mon bien-aimé Jacques, je rirais des étonnements que causent à ma tante les preuves successives et inattendues de l'éducation que tu m'as donnée.
D'abord, en arrivant en Allemagne, sa grande inquiétude était de savoir comment elle se ferait comprendre, lorsque tout à coup elle me vit parler couramment allemand avec les postillons et les aubergistes.
Premier étonnement.
Il y a huit ou dix jours, nous avons visité les serres du palais, qui sont fort belles. Le jardinier justement est Français, et, reconnaissant en moi une compatriote, il voulut me faire lui-même les honneurs de son royaume.
Aux premiers mots que nous échangeâmes, il vit que je n'étais point tout à fait étrangère à la botanique. Alors il me fit visiter ses orchidées les plus curieuses; il en avait de magnifiques, dont les fleurs imitaient des insectes, des papillons, des casques; puis, voyant que je m'intéressais surtout aux choses mystérieuses de la nature, il me fit voir sa collection d'hybrides.
Mais l'excellent homme ne connaissait que les hybrides naturelles, fruit et résultat d'un accident quelconque de la nature; il ne savait point en faire artificiellement en enlevant les étamines d'une fleur avant sa fécondation, et en apportant sur le pistil le pollen d'une autre espèce.
Il se plaignait aussi que ses hybrides, quoique fécondes, retournassent spontanément à la tige maternelle, c'est-à-dire à l'atavisme. Je lui indiquai alors le moyen de combattre ce retour, en redoublant dans les générations subséquentes une nouvelle aspersion du pollen paternel.
Le jardinier était dans le ravissement; il m'écoutait comme il eût écouté Kœlrenter lui-même. Quant à ma tante, tu comprends, mon bien-aimé, elle qui est arrivée à l'âge de soixante-neuf ans sans savoir distinguer une anémone d'une tubéreuse, elle était stupéfaite.
Mais ce fut bien pis lorsque hier, à propos de mon pauvre Scipion, qui sera mort demain, je me pris avec le confesseur de ma tante, vieux prêtre français non assermenté, d'une discussion sur l'âme des hommes et sur celle des animaux, et lorsque j'avançai que c'était l'orgueil humain qui avait converti en âme l'intelligence humaine plus perfectionnée grâce à la quantité de matière cérébrale plus considérable contenue dans le crâne humain que dans le crâne des animaux, et que j'attribuai à chaque animal une âme en harmonie avec son intelligence. J'essayai vainement de faire comprendre que la nature n'était rien autre chose dans son éternelle palpitation que cette chaîne générale des êtres, que la séve de l'arbre était le sang de l'homme, et que la moindre plante, à un degré inférieur, avait sa vie sensitive à des degrés de plus en plus supérieurs, comme le mollusque, comme l'insecte, comme le reptile, comme le poisson, comme le mammifère, comme l'homme enfin.
Le prêtre m'accusa de panthéisme, et ma tante, qui ne savait pas ce que c'était que le panthéisme, déclara simplement que j'étais une athée.
Comment se fait-il, ô mon cher maître, comment se fait-il, mon Jacques bien-aimé, que ce soit nous qui voyons Dieu en toutes choses dans les mondes qui roulent au-dessus de nos têtes, dans l'air que nous respirons, dans l'océan que ne peut embrasser notre regard, dans le peuplier qui plie au vent, dans la fleur qui s'ouvre au soleil, dans la goutte de rosée que secoue l'aurore, dans l'infiniment petit, dans le visible et dans l'invisible, dans le temps et dans l'éternité, comment se fait-il que ce soit nous qu'on accuse d'être des athées, c'est-à-dire de ne pas croire en Dieu?
Notre pauvre Scipion est mort ce matin. Il en sait maintenant autant que nous en saurons un jour sur le grand secret, que le tombeau ne révélera jamais du moment où il n'a pas répondu à la sublime interrogation de Shakespeare.
Ce matin, ne le voyant pas entrer lorsque l'on ouvrit la porte de ma chambre, je me doutai ou qu'il était mort, ou qu'il était trop malade pour venir jusqu'à moi.
J'allai donc jusqu'à sa niche.
Il était vivant encore, mais trop faible déjà pour marcher. Son œil était fixé sur la porte par laquelle il s'attendait à me voir paraître.
En m'apercevant, son œil s'anima. Il fit entendre un petit cri de joie, sa queue s'agita, il sortit à moitié de sa niche.
Je pris un tabouret et vins m'asseoir près de lui et, voyant qu'il faisait effort, je lui pris la tête et la posai sur mon pied.
C'était cela qu'il voulait.
Une fois là, l'œil fixé sur moi, de temps en temps détournant son regard pour le plonger dans le lointain, comme s'il te cherchait, mais le ramenant aussitôt vers moi, il ne s'occupa plus qu'à mourir.
En vérité, celui qui donne une âme à l'assassin sans pitié qui égorge pour quarante sous des femmes et des enfants à la porte d'une prison, et la refuse à ce noble animal qui, pareil au pécheur privilégié de l'Écriture, après avoir fait le mal s'est repenti de l'avoir fait, et a consacré le reste de sa vie au bien et à l'amour, celui-là me semble non-seulement hors de raison, mais hors d'intelligence.
Mon bien-aimé Jacques, le jour où tu liras ces lignes, si tu les lis jamais, et que tu te reporteras à leur date, 23 janvier 1793, tu me trouveras sans doute bien enfantine de m'absorber dans la contemplation d'un chien qui meurt au moment même où tu te trouves, toi, en face de l'échafaud d'un roi, au milieu des débris d'un trône qui croule. Mais tout est relatif: l'amour qu'on porte à son roi, c'est-à-dire à un homme que l'on n'a jamais vu, à qui l'on n'a jamais parlé, est une convention sociale, une affaire d'éducation, tandis que l'amitié que je porte à la pauvre bête qui agonise là sous mes yeux en pensant à moi dans la mesure de son intelligence, est un sentiment presque d'égal à égal, en supposant même que Scipion n'ait pas été longtemps mon supérieur.
Quant à ce trône qui croule, il tombe sous la mine incessante de huit siècles de despotisme, sous la parole de tous les grands philosophes et de tous les esprits sublimes de notre temps, et ses débris, symboles de haine et de vengeance, essayent, en roulant vers l'abîme, d'entraîner avec eux tout ce qu'il y a de courageux, de loyal et de patriotique dans no1130 tre époque.
Notre pauvre Scipion est mort.
Un dernier frémissement d'agonie a parcouru tout son corps, ses yeux se sont fermés, il a poussé un faible gémissement, et tout a été fini pour lui.
Ô mort! ô éternité! n'est-ce pas que tu es la même pour tous les êtres créés, ou du moins pour tous ceux dont les cœurs ont battu, pour tous ceux qui ont souffert, pour tous ceux qui ont aimé.
Scipion est enterré dans le jardin, et sur la pierre qui le couvre j'ai gravé le seul mot: FIDELIS.
** *Là, malgré lui, Jacques Mérey s'arrêta. Cet homme qui avait vu tant de grands événements d'un œil sec, avait senti malgré lui les pleurs obscurcir son regard; une larme d'Éva avait laissé sa trace sur le manuscrit; une larme de Jacques tomba près d'elle.
Puis il regarda tristement le lit où elle avait couché, la chaise où elle s'était assise, la table où elle avait mangé, fit plusieurs tours dans la chambre, vint s'asseoir sur son fauteuil, reprit son manuscrit et se remit à lire.
Mais il y avait une grande lacune entre l'endroit où il était arrivé et celui où le récit continuait.
Il reprenait à la date du 26 MAI 1793.
** *Je pars pour la France demain soir. C'est le premier usage que je fais de ma liberté. Je ne crois pas courir aucun danger, et, si j'en cours, je les braverai joyeusement en pensant que c'est pour toi que je les brave.
Ma pauvre tante est morte hier d'une apoplexie foudroyante. Elle faisait son whist avec deux vieilles dames et son directeur; c'était à son tour à jouer, elle tenait les cartes et ne jouait pas.
– Jouez donc, lui dit son partner.
Mais au lieu de jouer, elle poussa un soupir et se renversa dans son fauteuil.
Elle était morte.
Quel bonheur, le 4 juin au plus tard, je serai dans tes bras, car je ne puis croire que tu m'aies oubliée!
Tu trouveras peut-être étonnant que je n'aie pas une parole de regret pour la pauvre vieille fille que nous conduirons demain à sa dernière demeure, quand j'ai employé six pages à te parler de la mort et de l'agonie de mon chien; mais, que veux-tu, je suis l'enfant de la nature, je ne sais pleurer que ce que je regrette, et je ne puis, en conscience, regretter une parente que je n'ai connue que comme ma geôlière.
Voici l'épitaphe que j'ai composée pour elle et dont son orgueil héraldique serait satisfait, je crois, si elle pouvait la lire.
CY GITTRÈS-HAUTE ET TRÈS-PUISSANTE DEMOISELLECLAUDE-LORRAINE-ANASTASIE-LOUISE-ADÉLAIDEDE CHAZELAY,DE SON VIVANT CHANOINESSE ET SUPÉRIEUREDES DAMES AUGUSTINESDE BOURGESLE VENT DES RÉVOLUTIONS L'A EMPORTÉESUR LA TERRE ÉTRANGÈRE OU ELLE ESTMORTELE XXV MAI 1793PRIEZ LE SEIGNEUR POUR SON ÂMEAu revoir, mon bien-aimé, la première fois que je te dirai je t'aime, ce sera de vive voix!
** *Oh! la malheureuse enfant! s'écria Jacques Mérey en laissant tomber le manuscrit; elle sera arrivée le surlendemain du jour où j'aurai quitté Paris!..
Mais comme l'intérêt croissait pour lui, il le ramassa avec un soupir, et en reprit avidement la lecture.
IV
Oh! décidément, j'étais maudite avant ma naissance, et la malédiction écartée un instant par toi est retombée plus pesante sur ma tête.
J'arrive à Paris. Je m'arrête à l'hôtel même de la diligence. Je dépose mes malles dans ma chambre. Je cours à la Convention, je me précipite dans une tribune, je te cherche des yeux parmi les députés, je ne te vois pas; je demande où sont les girondins.
On me montre des bancs vides.
– C'est là qu'ils étaient, me dit-on.
– Qu'ils étaient?..
– Arrêtés! prisonniers! en fuite!
Je redescends avec l'intention d'interroger un député dont la physionomie m'inspirera quelque confiance.
Je croise un représentant dans le corridor: au moment où je le croise, une voix appelle: Camille!
Il se retourne.
– Citoyen, lui dis-je, on vient de vous appeler Camille.
– Oui, citoyenne, c'est mon nom de baptême.
– Seriez-vous le citoyen Camille Desmoulins, par hasard?
– Trop heureux si je pouvais vous être bon à quelque chose.
– Vous avez connu le représentant Jacques Mérey? lui demandai-je vivement.
– Quoiqu'il fût d'un parti opposé au mien, nous étions amis.
– Pouvez-vous me dire où il est?
– Savez-vous s'il est arrêté ou en fuite?
– Je ne savais pas même, il y a dix minutes, qu'il fût proscrit. J'arrive de Vienne. Je suis sa fiancée. Je l'aime!
– Ah! pauvre enfant! Vous avez été chez lui?
– Il y a huit mois que nous sommes séparés sans nouvelles l'un de l'autre, je ne sais pas même où il demeurait.
– Je le sais, moi. Voulez-vous prendre mon bras? nous irons à son hôtel; peut-être le propriétaire pourra-t-il nous donner des renseignements; il saura du moins s'il a été arrêté chez lui.
– Ah! vous me sauvez la vie! Allons.
Je pris le bras de Camille, nous traversâmes la place du Carrousel, nous entrâmes à l'hôtel de Nantes.
Nous demandâmes le propriétaire, Camille Desmoulins se nomma; on nous introduisit dans un petit cabinet dont le propriétaire referma avec soin la porte.
– Citoyen, lui dit Camille, tu logeais ici un député qui était mon ami à moi et le fiancé de la citoyenne.
– Le citoyen Jacques Mérey, dis-je vivement.
– Oui, à l'entresol; mais depuis le 2 juin il a disparu.
– Écoute, dit Desmoulins, nous ne sommes ni de la police, ni de la Commune, ni partisans du citoyen Marat, par conséquent tu peux te fier à nous.
– Je le ferais bien volontiers, dit le propriétaire, mais j'ignore complètement ce que le citoyen Mérey est devenu. Le soir du 2 juin, un gendarme est venu pour l'arrêter, et, voyant qu'il n'y était pas, il est resté dans sa chambre, en l'attendant toute la journée d'avant-hier et d'hier; mais, voyant qu'il faisait une faction inutile, il est parti.
– Depuis quand n'avez-vous pas revu Jacques Mérey?
– Depuis le 2 juin au matin. Il est sorti, comme d'habitude, pour aller à la Convention nationale.
– Je l'ai vu à son banc jusqu'à quatre heures, dit Camille.
– Et il n'a pas reparu chez vous? demanda Éva.
– Je ne l'ai pas revu.
– Si l'on vous en croyait, dit Éva, il serait parti sans vous payer, ce qui n'est pas probable.
– Le citoyen Jacques Mérey payait tous les matins sa dépense et son loyer de la veille, prévoyant justement le cas où viendrait le moment de fuir sans perdre une minute.
– Un homme qui prend ces précautions-là, dit Camille, ne les prend pas pour se laisser arrêter. Il se sera probablement dirigé vers Caen avec les autres proscrits.
– Avec lequel de ses amis de la Gironde était-il particulièrement lié?
– Avec Vergniaud, dit le maître de l'hôtel, c'est celui que j'ai vu venir le visiter le plus souvent.
– Vergniaud doit être arrêté, fit Camille; Vergniaud est trop paresseux pour avoir essayé de fuir.
– Comment s'assurer s'il est ou s'il n'est pas arrêté?
– C'est bien facile, dit Camille.
– Comment cela?
– Julie Candeille doit le savoir.
– Qu'est-ce que Julie Candeille?
– C'est une charmante actrice du Théâtre-Français qui a fait avec Vergniaud la Belle fermière.
– Mais mademoiselle Julie Candeille craindra probablement de se compromettre.
– Oh! pauvre fille, elle passerait dans le feu pour lui.
– Mais de compromettre Vergniaud.
– Je lui ferai cette simple question: Est-il ou n'est-il pas arrêté? Elle me répondra oui
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.