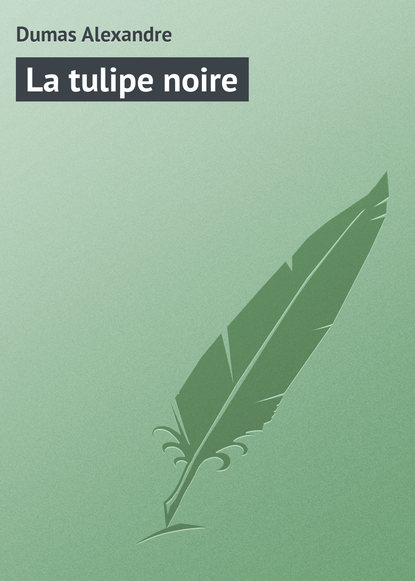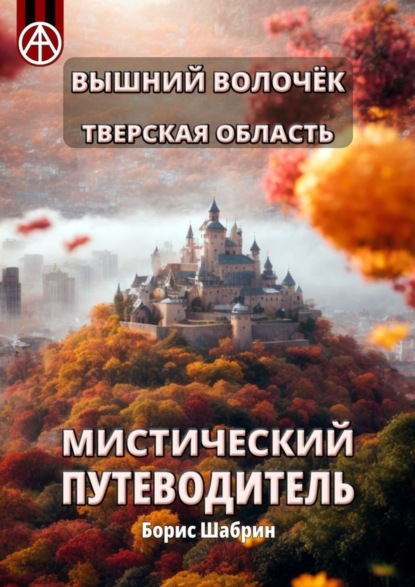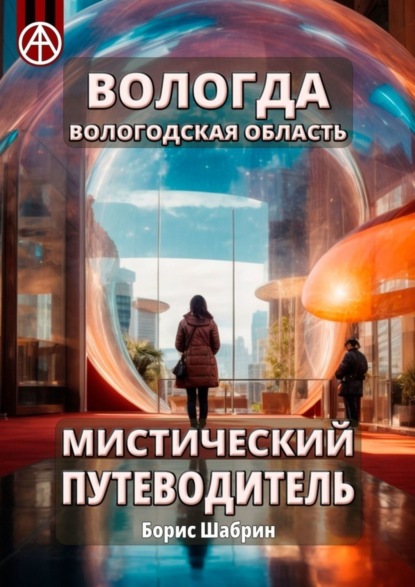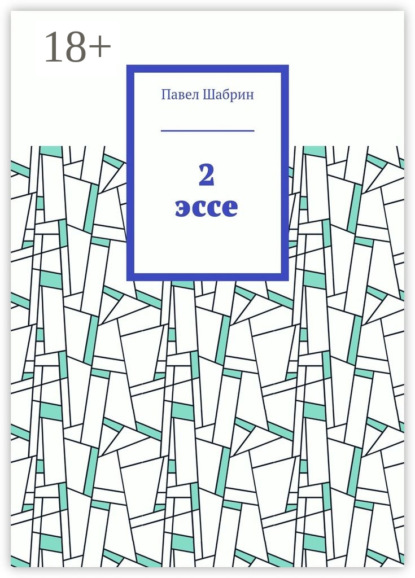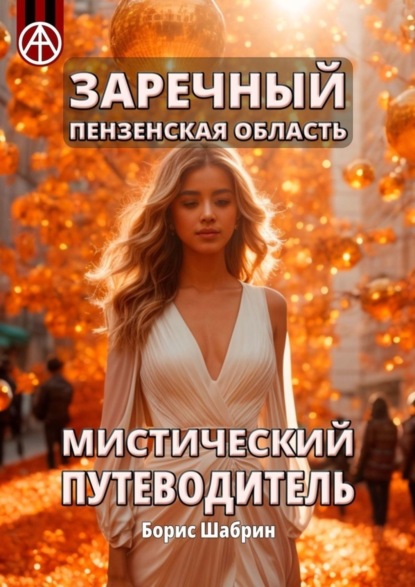- -
- 100%
- +
En conséquence et pour se faire un bonheur à sa façon, Cornélius se mit à étudier les végétaux et les insectes, cueillit et classa toute la flore des îles, piqua toute l'entomologie de sa province, sur laquelle il composa un traité manuscrit avec planches dessinées de sa main, et enfin, ne sachant plus que faire de son temps et de son argent surtout, qui allait s'augmentant d'une façon effrayante, il se mit à choisir parmi toutes les folies de son pays et de son époque une des plus élégantes et des plus coûteuses.
Il aima les tulipes.
C'était le temps, comme on sait, où les Flamands et les Portugais exploitant à l'envie ce genre d'horticulture, en étaient arrivés à diviniser la tulipe et à faire de cette fleur venue de l'orient ce que jamais naturaliste n'avait osé faire de la race humaine, de peur de donner de la jalousie à Dieu.
Bientôt de Dordrecht à Mons il ne fut plus question que des tulipes de mynheer1 van Baërle; et ses planches, ses fosses, ses chambres de séchage, ses cahiers de caïeux furent visités comme jadis les galeries et les bibliothèques d'Alexandrie par les illustres voyageurs romains.
Van Baërle commença par dépenser son revenu de l'année à établir sa collection, puis il ébrécha ses florins neufs à la perfectionner; aussi son travail fut-il récompensé d'un magnifique résultat: il trouva cinq espèces différentes qu'il nomma la Jeanne, du nom de sa mère, la Baërle, du nom de son père, la Corneille, du nom de son parrain; les autres noms nous échappent, mais les amateurs pourront bien certainement les retrouver dans les catalogues du temps.
En 1672, au commencement de l'année, Corneille de Witt vint à Dordrecht pour y habiter trois mois dans son ancienne maison de famille; car on sait que non seulement Corneille était né à Dordrecht, mais que la famille des de Witt était originaire de cette ville.
Corneille commençait dès lors, comme disait Guillaume d'Orange, à jouir de la plus parfaite impopularité. Cependant, pour ses concitoyens, les bons habitants de Dordrecht, il n'était pas encore un scélérat à pendre, et ceux-ci, peu satisfaits de son républicanisme un peu trop pur, mais fiers de sa valeur personnelle, voulurent bien lui offrir le vin de la ville quand il entra.
Après avoir remercié ses concitoyens, Corneille alla voir sa vieille maison paternelle, et ordonna quelques réparations avant que madame de Witt, sa femme, vint s'installer avec ses enfants.
Puis le ruward se dirigea vers la maison de son filleul, qui seul peut-être à Dordrecht ignorait encore la présence du ruward dans sa ville natale.
Autant Corneille de Witt avait soulevé de haines en maniant ces graines malfaisantes qu'on appelle les passions politiques, autant van Baërle avait amassé de sympathies en négligeant complètement la culture de la politique, absorbé qu'il était dans la culture de ses tulipes.
Aussi van Baërle était-il chéri de ses domestiques et de ses ouvriers, aussi ne pouvait-il supposer qu'il existât au monde un homme qui voulût du mal à un autre homme.
Et cependant, disons-le à la honte de l'humanité, Cornélius van Baërle avait, sans le savoir, un ennemi bien autrement féroce, bien autrement acharné, bien autrement irréconciliable, que jusque-là n'en avaient compté le ruward et son frère parmi les orangistes les plus hostiles de cette admirable fraternité qui, sans nuage pendant la vie, venait se prolonger par le dévouement au-delà de la mort.
Au moment où Cornélius commença de s'adonner aux tulipes, et y jeta ses revenus de l'année et les florins de son père, il y avait à Dordrecht et demeurant porte à porte avec lui, un bourgeois nommé Isaac Boxtel, qui, depuis le jour où il avait atteint l'âge de connaissance, suivait le même penchant et se pâmait au seul énoncé du mot tulban, qui, ainsi que l'assure le floriste français, c'est-à-dire l'historien le plus savant de cette fleur, est le premier mot qui, dans la langue du Chingulais, ait servi à désigner ce chef d'œuvre de la création qu'on appelle la tulipe.
Boxtel n'avait pas le bonheur d'être riche comme van Baërle. Il s'était donc à grand'peine, à force de soins et de patience, fait dans sa maison de Dordrecht un jardin commode à la culture; il avait aménagé le terrain selon les prescriptions voulues et donné à ses couches précisément autant de chaleur et de fraîcheur que le codex des jardiniers en autorise.
À la vingtième partie d'un degré près, Isaac savait la température de ses châssis. Il savait le poids du vent et le tamisait de façon qu'il l'accommodait au balancement des tiges de ses fleurs. Aussi ses produits commençaient-ils à plaire. Ils étaient beaux, recherchés même. Plusieurs amateurs étaient venus visiter les tulipes de Boxtel. Enfin, Boxtel avait lancé dans le monde des Linné et des Tournefort une tulipe de son nom. Cette tulipe avait fait son chemin, avait traversé la France, était entrée en Espagne, avait pénétré jusqu'en Portugal, et le roi don Alphonse VI, qui, chassé de Lisbonne, s'était retiré dans l'île de Terceire, où il s'amusait, non pas comme le grand Condé, à arroser des œillets, mais à cultiver des tulipes, avait dit: «pas mal» en regardant la susdite Boxtel.
Tout à coup, à la suite de toutes les études auxquelles il s'était livré, la passion de la tulipe ayant envahi Cornélius van Baërle, celui-ci modifia sa maison de Dordrecht, qui, ainsi que nous l'avons dit, était voisine de celle de Boxtel et fit élever d'un étage certain bâtiment de sa cour, lequel, en s'élevant, ôta environ un demi-degré de chaleur et, en échange, rendit un demi-degré de froid au jardin de Boxtel, sans compter qu'il coupa le vent et dérangea tous les calculs et toute l'économie horticole de son voisin.
Après tout, ce n'était rien que ce malheur aux yeux du voisin Boxtel. Van Baërle n'était qu'un peintre, c'est-à-dire une espèce de fou qui essaie de reproduire sur la toile en les défigurant les merveilles de la nature. Le peintre faisant élever son atelier d'un étage pour avoir meilleur jour, c'était son droit. M. van Baërle était peintre comme M. Boxtel était fleuriste-tulipier; il voulait du soleil pour ses tableaux, il en prenait un demi-degré aux tulipes de M. Boxtel.
La loi était pour M. van Baërle. Bene sit.
D'ailleurs, Boxtel avait découvert que trop de soleil nuit à la tulipe, et que cette fleur poussait mieux et plus colorée avec le tiède soleil du matin ou du soir qu'avec le brûlant soleil de midi.
Il sut donc presque gré à Cornélius van Baërle de lui avoir bâti gratis un parasoleil.
Peut-être n'était-ce point tout à fait vrai, et ce que disait Boxtel à l'endroit de son voisin van Baërle n'était-il pas l'expression entière de sa pensée. Mais les grandes âmes trouvent dans la philosophie d'étonnantes ressources au milieu des grandes catastrophes.
Mais hélas! que devint-il, cet infortuné Boxtel, quand il vit les vitres de l'étage nouvellement bâti se garnir d'oignons, de caïeux, de tulipes en pleine terre, de tulipes en pot, enfin de tout ce qui concerne la profession d'un monomane tulipier!
Il y avait les paquets d'étiquettes, il y avait les casiers, il y avait les boîtes à compartiments et les grillages de fer destinés à fermer ces casiers pour y renouveler l'air sans donner accès aux souris, aux charançons, aux loirs, aux mulots et aux rats, curieux amateurs de tulipes à deux mille francs l'oignon.
Boxtel fut fort ébahi lorsqu'il vit tout ce matériel, mais il ne comprenait pas encore l'étendue de son malheur. On savait van Baërle ami de tout ce qui réjouit la vue. Il étudiait à fond la nature pour ses tableaux, finis comme ceux de Gérard Dow, son maître, et de Miéris, son ami. N'était-il pas possible qu'ayant à peindre l'intérieur d'un tulipier, il eût amassé dans son nouvel atelier tous les accessoires de la décoration?
Cependant, quoique bercé par cette décevante idée, Boxtel ne put résister à l'ardente curiosité qui le dévorait. Le soir venu, il appliqua une échelle contre le mur mitoyen et, regardant chez le voisin Baërle, il se convainquit que la terre d'un énorme carré peuplé naguère de plantes différentes, avait été remuée, disposée en plates-bandes de terreau mêlé de boue de rivière, combinaison essentiellement sympathique aux tulipes, le tout contre-forté de bordures de gazon pour empêcher les éboulements. En outre, soleil levant, soleil couchant, ombre ménagée pour tamiser le soleil de midi; de l'eau en abondance et à portée, exposition au sud-sud-ouest, enfin conditions complètes, non seulement de réussite, mais de progrès. Plus de doute, van Baërle était devenu tulipier.
Boxtel se représenta sur-le-champ ce savant homme aux quatre cent mille florins de capital, aux dix mille florins de rente, employant ses ressources morales et physiques à la culture des tulipes en grand. Il entrevit son succès dans un vague mais prochain avenir, et conçut, par avance, une telle douleur de ce succès, que ses mains se relâchant, les genoux s'affaissèrent, il roula désespéré en bas de son échelle.
Ainsi, ce n'était pas pour des tulipes en peinture, mais pour des tulipes réelles que van Baërle lui prenait un demi-degré de chaleur. Ainsi van Baërle allait avoir la plus admirable des expositions solaires et, en outre, une vaste chambre où conserver ses oignons et ses caïeux: chambre éclairée, aérée, ventilée, richesse interdite à Boxtel, qui avait été forcé de consacrer à cet usage sa chambre à coucher, et qui, pour ne pas nuire par l'influence des esprits animaux à ses caïeux et à ses tubercules, se résignait à coucher au grenier.
Ainsi porte à porte, mur à mur, Boxtel allait avoir un rival, un émule, un vainqueur peut-être, et ce rival, au lieu d'être quelque jardinier obscur, inconnu, c'était le filleul de maître Corneille de Witt, c'est-à-dire une célébrité!
Boxtel, on le voit, avait l'esprit moins bien fait que Porus, qui se consolait d'avoir été vaincu par Alexandre justement à cause de la célébrité de son vainqueur.
En effet, qu'arriverait-il si jamais van Baërle trouvait une tulipe nouvelle et la nommait la Jean de Witt, après en avoir nommé une la Corneille? Ce serait à en étouffer de rage.
Ainsi, dans son envieuse prévoyance, Boxtel, prophète de malheur pour lui même, devinait ce qui allait arriver.
Aussi Boxtel, cette découverte faite, passa-t-il la plus exécrable nuit qui se puisse imaginer.
VI
LA HAINE D'UN TULIPIER
À partir de ce moment, au lieu d'une préoccupation, Boxtel eut une crainte. Ce qui donne de la vigueur et de la noblesse aux efforts du corps et de l'esprit, la culture d'une idée favorite, Boxtel le perdit en ruminant tout le dommage qu'allait lui causer l'idée du voisin.
Van Baërle, comme on peut le penser, du moment où il eut appliqué à ce point la parfaite intelligence dont la nature l'avait doué, van Baërle réussit à élever les plus belles tulipes.
Mieux que qui que ce soit à Harlem et à Leyde, villes qui offrent les meilleurs territoires et les plus sains climats, Cornélius réussit à varier les couleurs, à modeler les formes, à multiplier les espèces.
Il était de cette école ingénieuse et naïve qui prit pour devise, dès le viie siècle, cet aphorisme développé en 1653 par un de ses adeptes: «C'est offenser Dieu que mépriser les fleurs.»
Prémisse dont l'école tulipière, la plus exclusive des écoles, fit en 1653 le syllogisme suivant:
«C'est offenser Dieu que mépriser les fleurs.
«Plus la fleur est belle, plus en la méprisant on offense Dieu.
«La tulipe est la plus belle de toutes les fleurs.
«Donc qui méprise la tulipe offense démesurément Dieu.»
Raisonnement à l'aide duquel, on le voit, avec de la mauvaise volonté, les quatre ou cinq mille tulipiers de Hollande, de France et du Portugal, nous ne parlons pas de ceux de Ceylan, de l'Inde et de la Chine, eussent mis l'univers hors la loi, et déclaré schismatiques, hérétiques et dignes de mort plusieurs centaines de millions d'hommes froids pour la tulipe.
Il ne faut point douter que pour une pareille cause Boxtel, quoique ennemi mortel de van Baërle, n'eût marché sous le même drapeau que lui.
Donc van Baërle obtint des succès nombreux et fit parler de lui, si bien que Boxtel disparut à tout jamais de la liste des notables tulipiers de la Hollande, et que la tuliperie de Dordrecht fut représentée par Cornélius van Baërle, le modeste et inoffensif savant.
Ainsi du plus humble rameau la greffe fait jaillir les rejetons les plus fiers, et l'églantier aux quatre pétales incolores commence la rose gigantesque et parfumée. Ainsi les maisons royales ont pris parfois naissance dans la chaumière d'un bûcheron ou dans la cabane d'un pêcheur.
Van Baërle, adonné tout entier à ses travaux de semis, de plantation, de récolte, van Baërle, caressé par toute la tuliperie d'Europe, ne soupçonna pas même qu'à ses côtés il y eut un malheureux détrôné dont il était l'usurpateur. Il continua ses expériences, et par conséquent ses victoires, et en deux années couvrit ses plates-bandes de sujets tellement merveilleux que jamais personne, excepté peut-être Shakespeare et Rubens, n'avait tant créé après Dieu.
Aussi fallait-il, pour prendre une idée d'un damné oublié par Dante, fallait-il voir Boxtel pendant ce temps. Tandis que van Baërle sarclait, amendait, humectait ses plates-bandes, tandis qu'agenouillé sur le talus de gazon, il analysait chaque veine de la tulipe en floraison et méditait les modifications qu'on y pouvait faire, les mariages de couleurs qu'on y pouvait essayer, Boxtel, caché derrière un petit sycomore qu'il avait planté le long du mur, et dont il se faisait un éventail, suivait, l'œil gonflé, la bouche écumante, chaque pas, chaque geste de son voisin, et, quand il croyait le voir joyeux, quand il surprenait un sourire sur ses lèvres, un éclair de bonheur dans ses yeux, alors il leur envoyait tant de malédictions, tant de furieuses menaces, qu'on ne saurait concevoir comment ces souffles empestés d'envie et de colère n'allaient point s'infiltrant dans les tiges des fleurs y porter des principes de décadence et des germes de mort.
Bientôt, tant le mal, une fois maître d'une âme humaine, y fait de rapides progrès, bientôt Boxtel ne se contenta plus de voir van Baërle. Il voulut voir aussi ses fleurs, il était artiste au fond, et le chef-d'œuvre d'un rival lui tenait au cœur.
Il acheta un télescope, à l'aide duquel, aussi bien que le propriétaire lui-même, il put suivre chaque évolution de la fleur, depuis le moment où elle pousse, la première année, son pâle bourgeon hors de terre, jusqu'à celui où, après avoir accompli sa période de cinq années, elle arrondit son noble et gracieux cylindre sur lequel apparaît l'incertaine nuance de sa couleur et se développent les pétales de la fleur, qui seulement alors révèle les trésors secrets de son calice.
Oh! que de fois le malheureux jaloux, perché sur son échelle, aperçut-il dans les plates-bandes de van Baërle des tulipes qui l'aveuglaient par leur beauté, le suffoquaient par leur perfection!
Alors, après la période d'admiration qu'il ne pouvait vaincre, il subissait la fièvre de l'envie, ce mal qui ronge la poitrine et qui change le cœur en une myriade de petits serpents qui se dévorent l'un l'autre, source infâme d'horribles douleurs.
Que de fois, au milieu de ses tortures, dont aucune description ne saurait donner l'idée, Boxtel fut-il tenté de sauter la nuit dans le jardin, d'y ravager les plantes, de dévorer les oignons avec les dents, et de sacrifier à sa colère le propriétaire lui-même s'il osait défendre ses tulipes.
Mais, tuer une tulipe, c'est, aux yeux d'un véritable horticulteur, un si épouvantable crime!
Tuer un homme, passe encore.
Cependant, grâce aux progrès que faisait tous les jours van Baërle dans la science qu'il semblait deviner par instinct, Boxtel en vint à un tel paroxysme de fureur qu'il médita de lancer des pierres et des bâtons dans les planches de tulipes de son voisin.
Mais comme il réfléchit que le lendemain, à la vue du dégât, van Baërle informerait, que l'on constaterait alors que la rue était loin, que pierres et bâtons ne tombaient plus du ciel au xviie siècle comme au temps des Amalécites, que l'auteur du crime, quoiqu'il eût opéré dans la nuit, serait découvert et non seulement puni par la loi, mais encore déshonoré à tout jamais aux yeux de l'Europe tulipière, Boxtel aiguisa la haine par la ruse et résolut d'employer un moyen qui ne le compromît pas.
Il chercha longtemps, c'est vrai, mais enfin il trouva.
Un soir, il attacha deux chats chacun par une patte de derrière avec une ficelle de dix pieds de long, et les jeta, du haut du mur, au milieu de la plate-bande maîtresse, de la plate-bande princière, de la plate-bande royale, qui non seulement contenait la Corneille de Witt, mais encore la Brabançonne, blanc de lait, pourpre et rouge, la Marbrée, de Rotre, gris de lin mouvant, rouge et incarnadin éclatant, et la Merveille, de Harlem, la tulipe Colombin obscur et Colombin clair terni.
Les animaux effarés, en tombant du haut en bas du mur, se ruèrent d'abord sur la plate-bande, essayant de fuir chacun de son côté, jusqu'à ce que le fil qui les retenait l'un à l'autre fût tendu; mais alors, sentant l'impossibilité d'aller plus loin, ils vaguèrent çà et là avec d'affreux miaulements, fauchant avec leur corde les fleurs au milieu desquelles ils se débattaient; puis enfin, après un quart d'heure de lutte acharnée, étant parvenus à rompre le fil qui les enchevêtrait, ils disparurent.
Boxtel, caché derrière son sycomore, ne voyait rien, à cause de l'obscurité de la nuit; mais aux cris enragés des deux chats, il supposait tout, et son cœur, dégonflant de fiel, s'emplissait de joie.
Le désir de s'assurer du dégât commis était si grand dans le cœur de Boxtel, qu'il resta jusqu'au jour pour jouir par ses yeux de l'état où la lutte des deux matous avait mis les plates-bandes de son voisin.
Il était glacé par le brouillard du matin; mais il ne sentait pas le froid; l'espoir de la vengeance lui tenait chaud.
La douleur de son rival allait le payer de toutes ses peines.
Aux premiers rayons de soleil, la porte de la maison blanche s'ouvrit; van Baërle apparut, et s'approcha de ses plates-bandes, souriant comme un homme qui a passé la nuit dans son lit, qui y a fait de bons rêves.
Tout à coup, il aperçoit des sillons et des monticules sur ce terrain plus uni la veille qu'un miroir; tout à coup, il aperçoit les rangs symétriques de ses tulipes désordonnées comme sont les piques d'un bataillon au milieu duquel aurait tombé une bombe.
Il accourt tout pâlissant.
Boxtel tressaillit de joie. Quinze ou vingt tulipes lacérées, éventrées, gisaient les unes courbées, les autres brisées tout à fait et déjà pâlissantes; la sève coulait de leurs blessures; la sève, ce sang précieux que van Baërle eût voulu racheter au prix du sien.
Mais, ô surprise! ô joie de van Baërle! ô douleur inexprimable de Boxtel! pas une des quatre tulipes menacées par l'attentat de ce dernier n'avait été atteinte. Elles levaient fièrement leurs nobles têtes au-dessus des cadavres de leurs compagnes. C'était assez pour consoler van Baërle, c'était assez pour faire crever de rage l'assassin, qui s'arrachait les cheveux à la vue de son crime commis, et commis inutilement.
Van Baërle, tout en déplorant le malheur qui venait de le frapper, malheur qui, du reste, par la grâce de Dieu, était moins grand qu'il aurait pu être, van Baërle ne put en deviner la cause. Il s'informa seulement et apprit que toute la nuit avait été troublée par des miaulements terribles. Au reste, il reconnut le passage des chats à la trace laissée par leurs griffes, au poil resté sur le champ de bataille et auquel les gouttes indifférentes de la rosée tremblaient comme elles faisaient à côté sur les feuilles d'une fleur brisée, et pour éviter qu'un pareil malheur se renouvelât à l'avenir, il ordonna qu'un garçon jardinier coucherait chaque nuit dans le jardin, sous une guérite, près des plates-bandes.
Boxtel entendit donner l'ordre. Il vit se dresser la guérite dès le même jour, et trop heureux de n'avoir pas été soupçonné, seulement plus animé que jamais contre l'heureux horticulteur, il attendit de meilleures occasions.
Ce fut vers cette époque que la société tulipière de Harlem proposa un prix pour la découverte, nous n'osons pas dire pour la fabrication de la grande tulipe noire et sans tache, problème non résolu et regardé comme insoluble, si l'on considère qu'à cette époque l'espèce n'existait pas même à l'état de bistre dans la nature.
Ce qui faisait dire à chacun que les fondateurs du prix eussent aussi bien pu mettre deux millions que cent mille livres, la chose étant impossible.
Le monde tulipier n'en fut pas moins ému de la base à son faîte.
Quelques amateurs prirent l'idée, mais sans croire à son application; mais telle est la puissance imaginaire des horticulteurs que, tout en regardant leur spéculation comme manquée à l'avance, ils ne pensèrent plus d'abord qu'à cette grande tulipe noire réputée chimérique comme le cygne noir d'Horace, et comme le merle blanc de la tradition française.
Van Baërle fut du nombre des tulipiers qui prirent l'idée; Boxtel fut au nombre de ceux qui pensèrent à la spéculation. Du moment où van Baërle eut incrusté cette tâche dans sa tête perspicace et ingénieuse, il commença lentement les semis et les opérations nécessaires pour amener du rouge au brun, et du brun au brun foncé, les tulipes qu'il avait cultivées jusque-là.
Dès l'année suivante, il obtint des produits d'un bistre parfait, et Boxtel les aperçut dans sa plate-bande, lorsque lui n'avait encore trouvé que le brun clair.
Peut-être serait-il important d'expliquer aux lecteurs les belles théories qui consistent à prouver que la tulipe emprunte aux éléments ses couleurs; peut-être nous saurait-on gré d'établir que rien n'est impossible à l'horticulteur qui met à contribution, par sa patience et son génie, le feu du soleil, la candeur de l'eau, les sucs de la terre et les souffles de l'air. Mais ce n'est pas un traité de la tulipe en général, c'est l'histoire d'une tulipe en particulier, que nous avons résolu d'écrire; nous nous y renfermerons, quelque attrayants que soient les appâts du sujet juxtaposé au nôtre.
Boxtel, encore une fois vaincu par la supériorité de son ennemi, se dégoûta de la culture et, à moitié fou, se voua tout entier à l'observation.
La maison de son rival était à claire-voie. Jardin ouvert au soleil, cabinets vitrés pénétrables à la vue, casiers, armoires, boîtes et étiquettes dans lesquels le télescope plongeait facilement; Boxtel laissa pourrir les oignons sur les couches, sécher les coques dans leurs cases, mourir les tulipes sur les plates-bandes, et désormais usant sa vie avec sa vue, il ne s'occupa que de ce qui se passait chez van Baërle; il respira par la tige de ses tulipes, se désaltéra par l'eau qu'on leur jetait, et se rassasia de la terre molle et fine que saupoudrait le voisin sur ses oignons chéris.
Mais le plus curieux du travail ne s'opérait pas dans le jardin.
Sonnait une heure, une heure de la nuit, van Baërle montait à son laboratoire, dans le cabinet vitré où le télescope de Boxtel pénétrait si bien, et là, dès que les lumières du savant, succédant aux rayons du jour, avaient illuminé murs et fenêtres, Boxtel voyait fonctionner le génie inventif de son rival.
Il le regardait triant ses graines, les arrosant de substances destinées à les modifier ou à les colorer. Il devinait, lorsque chauffant certaines de ces graines, puis les humectant, puis les combinant avec d'autres par une sorte de greffe, opération minutieuse et merveilleusement adroite, il enfermait dans les ténèbres celles qui devaient donner la couleur noire, exposait au soleil ou à la lampe celles qui devaient donner la couleur rouge, mirait dans un éternel reflet d'eau celles qui devaient fournir le blanc, candide représentation hermétique de l'élément humide.
Cette magie innocente, fruit de la rêverie enfantine et du génie viril tout ensemble, ce travail patient, éternel, dont Boxtel se reconnaissait incapable, c'était de verser dans le télescope de l'envieux toute sa vie, toute sa pensée, tout son espoir.
Chose étrange! tant d'intérêt et l'amour-propre de l'art n'avaient pas éteint chez Isaac la féroce envie, la soif de la vengeance. Quelquefois, en tenant van Baërle dans son télescope, il se faisait l'illusion qu'il l'ajustait avec un mousquet infaillible, et il cherchait du doigt la détente pour lâcher le coup qui devait le tuer; mais il est temps que nous rattachions à cette époque des travaux de l'un et de l'espionnage de l'autre la visite que Corneille de Witt, ruward de Pulten, venait faire à sa ville natale.