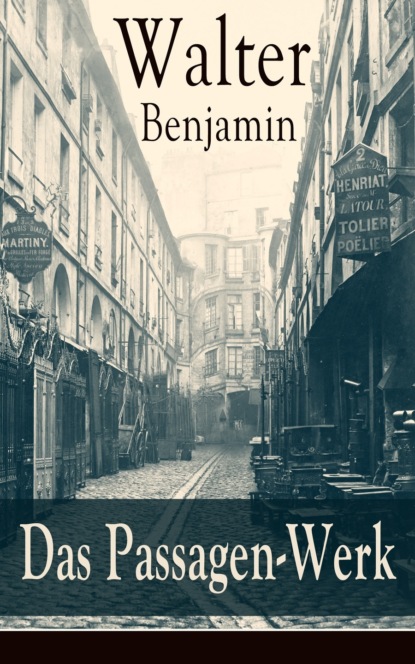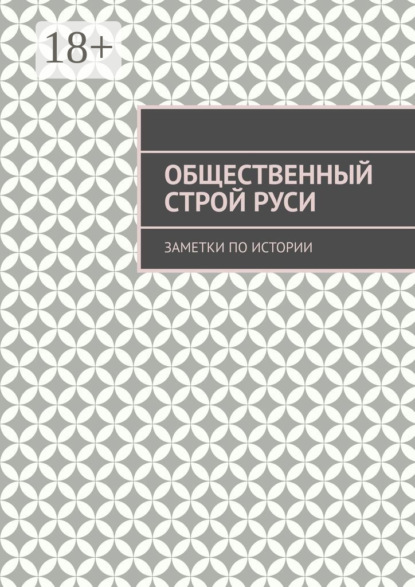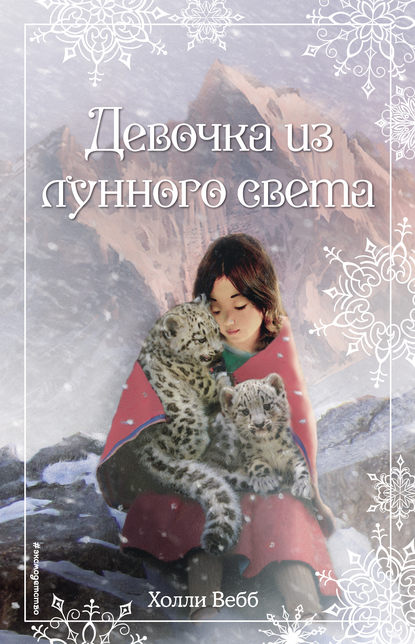- -
- 100%
- +
Haussmann oder die Barrikaden
»J’ai le culte du Beau, du Bien, des grandes choses,
De la belle nature inspirant le grand art,
Qu’il enchante l’oreille ou charme le regard;
J’ai l’amour du printemps en fleurs: femmes et roses!«
(Baron Haussmann:) Confession d’un lion devenu vieux»Das Blüthenreich der Dekorationen,
Der Reiz der Landschaft, der Architektur
Und aller Szenerie-Effekt beruhen
Auf dem Gesetz der Perspektive nur.«
Franz Böhle: Theater-Katechismus. München. p. 74.Haussmanns urbanistisches Ideal waren die perspektivischen Durchblicke durch lange Straßenfluchten. Es entspricht der im XIX. Jahrhundert immer wieder bemerkbaren Neigung, technische Notwendigkeiten durch künstlerische Zielsetzungen zu veredeln. Die Institute der weltlichen und geistlichen Herrschaft des Bürgertums sollten, in den Rahmen der Straßenzüge gefaßt, ihre Apotheose finden, Straßenzüge wurden vor ihrer Fertigstellung mit einem Zelttuch verhangen und wie Denkmäler enthüllt. – Die Wirksamkeit Haussmanns fügt sich dem napoleonischen Imperialismus ein. Dieser begünstigt das Finanzkapital. Paris erlebt eine Hochblüte der Spekulation. Das Börsenspiel drängt die aus der feudalen Gesellschaft überkommenen Formen des Hasardspiels zurück. Den Phantasmagorien des Raumes, denen der Flaneur sich ergibt, entsprechen die Phantasmagorien der Zeit, denen der Spieler nachhängt. Das Spiel verwandelt die Zeit in ein Rauschgift. Lafargue erklärt das Spiel als eine Nachbildung der Mysterien der Konjunktur im kleinen. Die Expropriationen durch Haussmann rufen eine betrügerische Spekulation ins Leben. Die Rechtsprechung des Kassationshofs, die von der bürgerlichen und orleanistischen Opposition inspiriert wird, erhöht das finanzielle Risiko der Haussmannisierung.
Haussmann versucht seine Diktatur zu stützen und Paris unter ein Ausnahmeregime zu stellen. 1864 bringt er in einer Kammerrede seinen Haß gegen die wurzellose Großstadtbevölkerung zum Ausdruck. Diese vermehrt sich durch seine Unternehmungen ständig. Die Steigerung der Mietpreise treibt das Proletariat in die faubourgs. Die quartiers von Paris verlieren dadurch ihre Eigenphysiognomie. Die rote ceinture entsteht. Haussmann hat sich selber den Namen »artiste démolisseur« gegeben. Er fühlte sich zu seinem Werk berufen und betont das in seinen Memoiren. Indessen entfremdet er den Parisern ihre Stadt. Sie fühlen sich in ihr nicht mehr heimisch. Der unmenschliche Charakter der Großstadt beginnt, ihnen bewußt zu werden. Maxime Du Camps Monumentalwerk »Paris« verdankt diesem Bewußtsein die Entstehung. Die »Jérémiades d’un Haussmannisé« geben ihm die Form einer biblischen Klage.
Der wahre Zweck der Haussmannschen Arbeiten war die Sicherung der Stadt gegen den Bürgerkrieg. Er wollte die Errichtung von Barrikaden in Paris für alle Zukunft unmöglich machen. In solcher Absicht hatte schon Louis-Philippe Holzpflasterung eingeführt. Dennoch spielten die Barrikaden in der Februarrevolution eine Rolle. Engels beschäftigt sich mit der Taktik der Barrikadenkämpfe. Haussmann will sie auf doppelte Art unterbinden. Die Breite der Straßen soll ihre Errichtung unmöglich machen und neue Straßen sollen den kürzesten Weg zwischen den Kasernen und Arbeitervierteln herstellen. Die Zeitgenossen taufen das Unternehmen »L’embellissement stratégique«.
»Fais voir, en déjouant la ruse,
O république à ces pervers
Ta grande face de Méduse
Au milieu de rouges éclairs.«
Chanson d’ouvriers vers 1850. (Adolf Stahr: Zwei Monate in Paris. Oldenburg 1851. II, p. 199.)Die Barrikade ersteht in der Kommune von neuem auf. Sie ist stärker und besser gesichert denn je. Sie zieht sich über die großen Boulevards, reicht oft bis in die Höhe des ersten Stocks und deckt hinter ihr befindliche Schützengräben. Wie das kommunistische Manifest die Epoche der Berufsverschwörer beendet, so macht die Kommune mit der Phantasmagorie ein Ende, die die Frühzeit des Proletariats beherrscht. Durch sie wird der Schein zerstreut, daß es Aufgabe der proletarischen Revolution sei, Hand in Hand mit der Bourgeoisie das Werk von 1789 zu vollenden. Diese Illusion beherrscht die Zeit von 1831 bis 1871, vom Lyoner Aufstand bis zur Kommune. Die Bourgeoisie hat nie diesen Irrtum geteilt. Ihr Kampf gegen die gesellschaftlichen Rechte des Proletariats beginnt schon in der großen Revolution und fällt mit der philanthropischen Bewegung zusammen, die ihn verdeckt und die unter Napoleon III. ihre bedeutendste Entfaltung erfährt. Unter ihm entsteht das Monumentalwerk der Richtung: Le Play’s »Ouvriers européens«. Neben der gedeckten Stellung der Philanthropie hat die Bourgeoisie jederzeit die offene des Klassenkampfes bezogen. Schon 1831 erkennt sie im »Journal des Débats«: »Jeder Fabrikant lebt in seiner Fabrik wie die Plantagenbesitzer unter ihren Sklaven.« Ist es das Unheil der alten Arbeiteraufstände, daß keine Theorie der Revolution ihnen den Weg weist, so ist es auf der andern Seite auch die Bedingung der unmittelbaren Kraft und des Enthusiasmus, mit dem sie die Herstellung einer neuen Gesellschaft in Angriff nehmen. Dieser Enthusiasmus, der seinen Höhepunkt in der Kommune erreicht, gewinnt der Arbeiterschaft zeitweise die besten Elemente der Bourgeoisie, führt sie aber dazu, am Ende ihren schlechtesten zu unterliegen. Rimbaud und Courbet bekennen sich zur Kommune. Der Brand von Paris ist der würdige Abschluß von Haussmanns Zerstörungswerk.
»Mein guter Vater war in Paris gewesen.«
Karl Gutzkow: Briefe aus Paris. Leipzig 1842. I, p 58.Balzac hat als erster von den Ruinen der Bourgeoisie gesprochen. Aber erst der Surrealismus hat den Blick auf sie freigegeben. Die Entwicklung der Produktivkräfte legte die Wunschsymbole des vorigen Jahrhunderts in Trümmer noch ehe die sie darstellenden Monumente zerfallen waren. Diese Entwicklung hat im XIX. Jahrhundert die Gestaltungsformen von der Kunst emanzipiert wie im XVI. Jahrhundert sich die Wissenschaften von der Philosophie befreit haben. Den Anfang macht die Architektur als Ingenieurkonstruktion. Es folgt die Naturwiedergabe als Photographie. Die Phantasieschöpfung bereitet sich vor, als Werbegraphik praktisch zu werden. Die Dichtung unterwirft sich im Feuilleton der Montage. Alle diese Produkte sind im Begriff, sich als Ware auf den Markt zu begeben. Aber sie zögern noch auf der Schwelle. Dieser Epoche entstammen die Passagen und Interieurs, die Ausstellungshallen und Panoramen. Sie sind Rückstände einer Traumwelt. Die Verwertung der Traumelemente beim Erwachen ist der Schulfall des dialektischen Denkens. Daher ist das dialektische Denken das Organ des geschichtlichen Aufwachens. Jede Epoche träumt ja nicht nur die nächste sondern träumend drängt sie auf das Erwachen hin. Sie trägt ihr Ende in sich und entfaltet es – wie schon Hegel erkannt hat – mit List. Mit der Erschütterung der Warenwirtschaft beginnen wir, die Monumente der Bourgeoisie als Ruinen zu erkennen noch ehe sie zerfallen sind.
Paris, Capitale du XIXeme siecle Exposé
Introduction
»L’histoire est comme Janus, elle a deux visages: qu’elle regarde le passé ou le présent, elle voit les mêmes choses.«
Maxime Du Camp, Paris. VI, p. 315.L’objet de ce livre est une illusion exprimée par Schopenhauer, dans cette formule que pour saisir l’essence de l’histoire il suffit de comparer Hérodote et la Presse du Matin. C’est là l’expression de la sensation de vertige caractéristique pour la conception que le siècle dernier se faisait de l’histoire. Elle correspond à un point de vue qui compose le cours du monde d’une série illimitée de faits figés sous forme de choses. Le résidu caractéristique de cette conception est ce qu’on a appelé »L’Histoire de la Civilisation«, qui fait l’inventaire des formes de vie et des créations de l’humanité point par point. Les richesses qui se trouvent ainsi collectionnées dans l’aerarium de la civilisation apparaissent désormais comme identifiées pour toujours. Cette conception fait bon marché du fait qu’elles doivent non seulement leur existence mais encore leur transmission à un effort constant de la société, un effort par où ces richesses se trouvent par surcroît étrangement altérées. Notre enquête se propose de montrer comment par suite de cette représentation chosiste de la civilisation, les formes de vie nouvelle et les nouvelles créations à base économique et technique que nous devons au siècle dernier entrent dans l’univers d’une fantasmagorie. Ces créations subissent cette »illumination« non pas seulement de manière théorique, par une transposition idéologique, mais bien dans l’immédiateté de la présence sensible. Elles se manifestent en tant que fantasmagories. Ainsi se présentent les »passages«, première mise en œuvre de la construction en fer; ainsi se présentent les expositions universelles, dont l’accouplement avec les industries de plaisance est significatif; dans le même ordre de phénomènes, l’expérience du flâneur, qui s’abandonne aux fantasmagories du marché. A ces fantasmagories du marché, où les hommes n’apparaissent que sous des aspects typiques, correspondent celles de l’intérieur, qui se trouvent constituées par le penchant impérieux de l’homme à laisser dans les pièces qu’il habite l’empreinte de son existence individuelle privée. Quant à la fantasmagorie de la civilisation elle-même, elle a trouvé son champion dans Haussmann, et son expression manifeste dans ses transformations de Paris. – Cet éclat cependant et cette splendeur dont s’entoure ainsi la société productrice de marchandises, et le sentiment illusoire de sa sécurité ne sont pas à l’abri des menaces; l’écroulement du Second Empire, et la Commune de Paris le lui remettent en mémoire. A la même époque, l’adversaire le plus redouté de cette société, Blanqui, lui a révélé dans son dernier écrit les traits effrayants de cette fantasmagorie. L’humanité y fait figure de damnée. Tout ce qu’elle pourra espérer de neuf se dévoilera n’être qu’une réalité depuis toujours présente; et ce nouveau sera aussi peu capable de lui fournir une solution libératrice qu’une mode nouvelle l’est de renouveler la société. La spéculation cosmique de Blanqui comporte cet enseignement que l’humanité sera en proie à une angoisse mythique tant que la fantasmagorie y occupera une place.
Fourier ou les passages
I
»De ces palais les colonnes magiques
A l’amateur montrent de toutes parts,
Dans les objets qu’étaient leurs portiques,
Que l’industrie est rivale des arts.«
Nouveaux Tableaux de Paris. Paris 1828, p. 27.La majorité des passages sont construits à Paris dans les quinze années qui suivent 1822. La première condition pour leur développement est l’apogée du commerce des tissus. Les magasins de nouveautés, premiers établissements qui ont constamment dans la maison des dépôts de marchandises considérables, font leur apparition. Ce sont les précurseurs des grands magasins. C’est à cette époque que Balzac fait allusion lorsqu’il écrit: »Le grand poème de l’étalage chante ses strophes de couleurs depuis la Madeleine jusqu’à la porte Saint-Denis.« Les passages sont des noyaux pour le commerce des marchandises de luxe. En vue de leur aménagement l’art entre au service du commerçant. Les contemporains ne se lassent pas de les admirer. Longtemps ils resteront une attraction pour les touristes. Un Guide illustré de Paris dit: »Ces passages, récente invention du luxe industriel, sont des couloirs au plafond vitré, aux entablements de marbre, qui courent à travers des blocs entiers d’immeubles dont les propriétaires se sont solidarisés pour ce genre de spéculation. Des deux côtés du passage, qui reçoit sa lumière d’en haut, s’alignent les magasins les plus élégants, de sorte qu’un tel passage est une ville, un monde en miniature.« C’est dans les passages qu’ont lieu les premiers essais d’éclairage au gaz.
La deuxième condition requise pour le développement des passages est fournie par les débuts de la construction métallique. Sous l’Empire on avait considéré cette technique comme une contribution au renouvellement de l’architecture dans le sens du classicisme grec. Le théoricien de l’architecture Boetticher, exprime le sentiment général lorsqu’il dit que: »quant aux formes d’art du nouveau système, le style hellénique« doit être mis en vigueur. Le style Empire est le style du terrorisme révolutionnaire pour qui l’Etat est une fin en soi. De même que Napoléon n’a pas compris la nature fonctionnelle de l’Etat en tant qu’instrument de pouvoir pour la bourgeoisie, de même les architectes de son époque n’ont pas compris la nature fonctionnelle du fer, par où le principe constructif acquiert la prépondérance dans l’architecture. Ces architectes construisent des supports à l’imitation de la colonne pompéienne, des usines à l’imitation des maisons d’habitation, de même que plus tard les premières gares affecteront les allures d’un chalet. La construction joue le rôle du subconscient. Néanmoins le concept de l’ingénieur, qui date des guerres de la révolution commence à s’affirmer et c’est le début des rivalités entre constructeur et décorateur, entre l’Ecole Polytechnique et l’Ecole des Beaux-Arts. – Pour la première fois depuis les Romains un nouveau matériau de construction artificiel, le fer, fait son apparition. Il va subir une évolution dont le rythme au cours du siècle va en s’accélérant. Elle reçoit une impulsion décisive au jour où l’on constate que la locomotive – objet des tentatives les plus diverses depuis les années 1828-29 – ne fonctionne utilement que sur des rails en fer. Le rail se révèle comme la première pièce montée en fer, précurseur du support. On évite l’emploi du fer pour les immeubles et on l’encourage pour les passages, les halls d’exposition, les gares – toutes constructions qui visent à des buts transitoires.
II
»Rien d’étonnant à ce que tout intérêt de masse, la première fois qu’il monte sur l’estrade, dépasse de loin dans l’idée ou la représentation que l’on s’en fait ses véritables bornes.«
Marx et Engels: La Sainte-FamilleLa plus intime impulsion donnée à l’utopie fouriériste, il faut la voir dans l’apparition des machines. Le phalanstère devait ramener les hommes à un système de rapports où la moralité n’a plus rien à faire. Néron y serait devenu un membre plus utile de la société que Fénelon. Fourier ne songe pas à se fier pour cela à la vertu, mais à unfonctionnement efficace de la société dont les forces motrices sont les passions. Par les engrenages des passions, par la combinaison complexe des passions mécanistes avec la passion cabaliste, Fourier se représente la psychologie collective comme un mécanisme d’horlogerie. L’harmonie fouriériste est le produit nécessaire de ce jeu combiné. Fourier insinue dans le monde aux formes austères de l’Empire, l’idylle colorée du style des années trente. Il met au point un système où se mêlent les produits de sa vision colorée et de son idiosyncrasie des chiffres. Les »harmonies« de Fourier ne se réclament en aucune manière d’une mystique des nombres prise dans une tradition quelconque. Elles sont en fait directement issues de ses propres décrets: élucubrations d’une imagination organisatrice, qui était extrêmement développée chez lui. Ainsi il a prévu la signification du rendez-vous pour le citadin. La journée des habitants du phalanstère s’organise non pas de chez eux, mais dans des grandes salles semblables à des halls de la Bourse, où les rendez-vous sont ménagés par des courtiers.
Dans les passages Fourier a reconnu le canon architectonique du phalanstère. C’est ce qui accentue le caractère »empire« de son utopie, que Fourier reconnaît lui-même naïvement: »L’Etat sociétaire sera dès son début d’autant plus brillant qu’il a été plus longtemps différé. La Grèce à l’époque des Solon et des Périclès pouvait déjà l’entreprendre.« Les passages qui se sont trouvés primitivement servir à des fins commerciales, deviennent chez Fourier des maisons d’habitation. Le phalanstère est une ville faite de passages. Dans cette »ville en passages« la construction de l’ingénieur affecte un caractère de fantasmagorie. La »ville en passages« est un songe qui flattera le regard des parisiens jusque bien avant dans la seconde moitié du siècle. En 1869 encore, les »rues-galeries« de Fourier fournissent le tracé de l’utopie de Moilin Paris en l’an 2.000. La ville y adopte une structure qui fait d’elle avec ses magasins et ses appartements le décor idéal pour le flâneur.
Marx a pris position en face de Carl Grün pour couvrir Fourier et mettre en valeur sa »conception colossale de l’homme«. Il considérait Fourier comme le seul homme à côté de Hegel qui ait percé à jour la médiocrité de principe du petit bourgeois. Au dépassement systématique de ce type chez Hegel correspond chez Fourier son anéantissement humoristique. Un des traits les plus remarquables de l’utopie fouriériste c’est que l’idée de l’exploitation de la nature par l’homme, si répandue à l’époque postérieure, lui est étrangère. La technique se présente bien plutôt pour Fourier comme l’étincelle qui met le feu aux poudres de la nature. Peut-être est-ce là la clé de sa représentation bizarre d’après laquelle le phalanstère se propagerait »par explosion«. La conception postérieure de l’exploitation de la nature par l’homme est le reflet de l’exploitation de fait de l’homme parles propriétaires des moyens de production. Si l’intégration de la technique dans la vie sociale a échoué, la faute en est à cette exploitation.
Grandville ou les expositions universelles
I
»Oui, quand le monde entier, de Paris jusqu’en Chine,
O divin Saint-Simon, sera dans ta doctrine,
L’âge d’or doit renaître avec tout son éclat,
Les fleuves rouleront du thé, du chocolat;
Les moutons tout rôtis bondiront dans la plaine,
Et les brochets au bleu nageront dans la Seine;
Les épinards viendront au monde fricassés,
Avec des croûtons frits tout autour concassés;
Les arbres produiront des pommes en compotes,
Et l’on moissonnera des carricks et des bottes;
Il neigera du vin, il pleuvra des poulets,
Et du ciel les canards tomberont aux navets.«
Langlé et Vanderburch: Louis-Bronze et le Saint-Simonien (Théâtre du Palais Royal 27 février 1832)Les expositions universelles sont les centres de pèlerinage de la marchandise-fétiche. »L’Europe s’est déplacée pour voir des marchandises« dit Taine en 1855. Les expositions universelles ont eu pour précurseurs des expositions nationales de l’industrie, dont la première eut lieu en 1798 sur le Champ de Mars. Elle est née du désir »d’amuser les classes laborieuses et devient pour elles une fête de l’émancipation«. Les travailleurs formeront la première clientèle. Le cadre de l’industrie de plaisance ne s’est pas constitué encore. Ce cadre c’est la fête populaire qui le fournit. Le célèbre discours de Chaptal sur l’industrie ouvre cette exposition. – Les Saint-Simoniens qui projettent l’industrialisation de la planète, s’emparent de l’idée des expositions universelles. Chevalier, la première compétence dans ce domaine nouveau, est un élève d’Enfantin, et le rédacteur du journal Saint-Simonien Le Globe. Les Saint-Simoniens ont prévu le développement de l’industrie mondiale; ils n’ont pas prévu la lutte des classes. C’est pourquoi, en regard de la participation à toutes les entreprises industrielles et commerciales vers le milieu du siècle, on doit reconnaître leur impuissance dans les questions qui concernent le prolétariat.
Les expositions universelles idéalisent la valeur d’échange des marchandises. Elles créent un cadre où leur valeur d’usage passe au second plan. Les expositions universelles furent une école où les foules écartées de force de la consommation se pénètrent de la valeur d’échange des marchandises jusqu’au point de s’identifier avec elle: »il est défendu de toucher aux objets exposés«. Elles donnent ainsi accès à une fantasmagorie où l’homme pénètre pour se laisser distraire. A l’intérieur des divertissements, auxquels l’individu s’abandonne dans le cadre de l’industrie de plaisance, il reste constamment un élément composant d’une masse compacte. Cette masse se complaît dans les parcs d’attractions avec leurs montagnes russes, leurs »tête-à-queue«, leurs »chenilles«, dans une attitude toute de réaction. Elle s’entraîne par là à cet assujettissement avec lequel la propagande tant industrielle que politique doit pouvoir compter. – L’intronisation de la marchandise et la splendeur des distractions qui l’entourent, voilà le sujet secret de l’art de Grandville. D’où la disparité entre son élément utopique et son élément cynique. Ses artifices subtils dans la représentation d’objets inanimés correspondent à ce que Marx appelle les »lubies théologiques« de la marchandise. L’expression concrète s’en trouve clairement dans la »spécialité« – une désignation de marchandise qui fait à cette époque son apparition dans l’industrie de luxe. Les expositions universelles construisent un monde fait de »spécialités«. Les fantaisies de Grandville réalisent la même chose. Elles modernisent l’univers. L’anneau de Saturne devient pour lui un balcon en fer forgé où les habitants de Saturne prennent l’air à la tombée de la nuit. De la même façon un balcon en fer forgé représenterait à l’exposition universelle l’anneau de Saturne et ceux qui s’y avancent se verraient entrainés dans une fantasmagorie où ils se sentent mués en habitants de Saturne. Le pendant littéraire de cette utopie graphique, c’est l’œuvre du savant fouriériste Toussenel. Toussenel s’occupait de la rubrique des sciences naturelles dans un journal de mode. Sa zoologie range le monde animal sous le sceptre de la mode. Il considère la femme comme le médiateur entre l’homme et les animaux. Elle est en quelque sorte le décorateur du monde animal, qui en échange dépose à ses pieds son plumage et ses fourrures. »Le lion ne demande pas mieux que de se laisser rogner les ongles, pourvu que ce soit une jolie fille qui tienne les ciseaux.«
II
»La mode: Monseigneur la mort! Monseigneur la mort!«
Léopardi: Dialogue entre la mode et la mortLa mode prescrit le rite suivant lequel le fétiche qu’est la marchandise demande à être adoré; Grandville étend son autorité sur les objets d’usage courant aussi bien que sur le cosmos. En la poussant jusqu’à ses conséquences extrêmes il en révèle la nature. Elle accouple le corps vivant au monde inorganique. Vis-à-vis du vivant elle défend les droits du cadavre. Le fétichisme qui est ainsi sujet au sex appeal du non-organique, est son nerf vital. Les fantaisies de Grandville correspondent à cet esprit de la mode, tel qu’Apollinaire en a tracé plus tard une image: »Toutes les matières des différents règnes de la nature peuvent maintenant entrer dans la composition d’un costume de femme. J’ai vu une robe charmante, faite de bouchons de liège … La porcelaine, le grès et la faïence ont brusquement apparu dans l’art vestimentaire … On fait des souliers en verre de Venise et des chapeaux en cristal de Baccarat.«
Louis-Philippe ou l’intérieur
I
»Je crois … à mon âme: la Chose.«
Léon Deubel: Œuvres. Paris 1929, p. 193.Sous le règne de Louis-Philippe le particulier fait son entrée dans l’histoire. Pour le particulier les locaux d’habitation se trouvent pour la première fois en opposition avec les locaux de travail. Ceux-là viennent constituer l’intérieur; le bureau en est le complément. (De son côté il se distingue nettement du comptoir, qui par ses globes, ses cartes murales, ses balustrades, se présente comme une survivance de formes baroques antérieures à la pièce d’habitation.) Le particulier qui ne tient compte que des réalités dans son bureau demande à être entretenu dans ses illusions par son intérieur. Cette nécessité est d’autant plus pressante qu’il ne songe pas à greffer sur ses intérêts d’affaires une conscience claire de sa fonction sociale. Dans l’aménagement de son entourage privé il refoule ces deux préoccupations. De là dérivent les fantasmagories de l’intérieur; celui-ci représente pour le particulier l’univers. Il y assemble les régions lointaines et les souvenirs du passé. Son salon est une loge dans le théâtre du monde.
L’intérieur est l’asile où se réfugie l’art. Le collectionneur se trouve être le véritable occupant de l’intérieur. Il fait son affaire de l’idéalisation des objets. C’est à lui qu’incombe cette tâche sisyphéenne d’ôter aux choses, parce qu’il les possède, leur caractère de marchandise. Mais il ne saurait leur conférer que la valeur qu’elles ont pour l’amateur au lieu de la valeur d’usage. Le collectionneur se plaît à susciter un monde non seulement lointain et défunt mais en même temps meilleur; un monde où l’homme est aussi peu pourvu à vrai dire de ce dont il a besoin que dans le monde réel, mais où les choses sont libérées de la servitude d’être utiles.