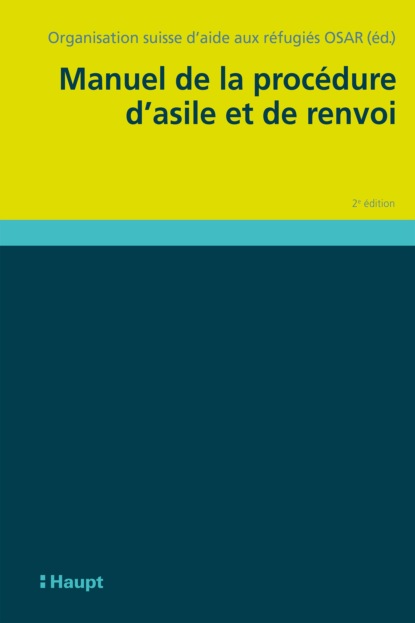- -
- 100%
- +
Sommairement motivée (art. 37a LAsi), voir chap. V, pt 7.5.
Assortie d’une décision de renvoi (art. 44 LAsi).
Exige en règle générale un examen séparé des obstacles à l’exécution du renvoi, voir chap. X ; pour les cas Dublin, voir chap. VII, pt 2.2.
Délai de recours de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi), voir chap. XIII.
Des mesures de contrainte peuvent être prononcées à certaines conditions, voir chap. XVI, pt 3.1.
3.2.2 Réfugiés exclus de l’asile
Lorsque l’autorité relève un motif d’exclusion de l’asile (motif d’indignité ou motifs subjectifs postérieurs à la fuite), le réfugié n’obtient pas l’asile et se voit notifier une décision de renvoi. L’exécution du renvoi d’un réfugié étant illicite, ce dernier sera mis au bénéfice d’une admission provisoire (voir pt 3.3.2).
[109]3.2.3 Absence de qualité de réfugié
Lorsque le requérant n’a pas la qualité de réfugié, l’autorité prononce le renvoi, voire son exécution. Les règles procédurales applicables à une décision de renvoi exécutoire varient selon que la personne est originaire ou non d’un Etat présumé sûr (au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi). Pour les requérants qui proviennent des autres Etats, la décision de rejet de l’asile est soumise aux règles procédurales ordinaires. Elle doit être motivée de manière à ce que la personne concernée puisse la contester utilement (chap. V, pt 7.5). Le délai de recours est de 30 jours. Un recours sur la qualité de réfugié ou sur l’octroi de l’asile peut être déposé même lorsque la personne a été admise à titre provisoire. Le délai de départ fixé dans la décision de première instance est, en principe, de huit semaines.13
Les décisions de renvoi vers un Etat présumé sûr (« safe country ») font l’objet d’une procédure matérielle accélérée (« procédure en 48 heures ») depuis le 1er février 2014.14 La présomption de sécurité n’exempte pas les autorités d’examiner les éventuels indices de persécution invoqués par le requérant d’asile. La motivation de la décision matérielle peut par contre être sommaire. Les délais de traitement et de recours sont similaires à ceux prévus pour les décisions de non-entrée en matière : le délai de recours tout comme le délai de traitement du recours au TAF sont de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 et 109 al. 1 LAsi).
3.3 La décision d’admission provisoire
Lorsque l’exécution de la décision de renvoi est impossible, illicite ou raisonnablement inexigible, l’autorité admet provisoirement le requérant (art. 83 al. 1 LEtr). Le statut de l’admission provisoire (livret F) n’est pas une autorisation du droit des étrangers à l’instar des permis B et C, mais une simple mesure de substitution à l’exécution du renvoi. La personne est en théorie tenue de quitter le pays alors que la Suisse ne peut ou ne doit pas exécuter le renvoi. En pratique, les personnes admises à titre provisoire restent généralement en Suisse pour une durée prolongée, tout comme les personnes au bénéfice de l’asile. Jusqu’au début des années 2000, les Sri Lankais représentaient une part importante des personnes admises provisoirement. Ils ont été suivis par des personnes originaires de Serbie, puis de Somalie et d’Erythrée, alors que ces dernières années, ce sont principalement [110] les ressortissants d’Afghanistan, d’Iran et de Syrie qui ont été mis au bénéfice de l’admission provisoire.15
Le séjour des personnes admises à titre provisoire est réglé aux art. 83 à 88 LEtr, 74 OASA et 16 à 26a OERE. D’importantes distinctions sont faites selon que la personne est reconnue comme réfugié ou comme étranger admis à titre provisoire. Seule la première peut se prévaloir des droits conférés par la CR et bénéficie de ce fait d’un bien meilleur statut.
3.3.1 Non-entrée en matière et admission provisoire
Chaque année, plusieurs dizaines de personnes se voient notifier une décision de NEM, puis mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison d’un obstacle à l’exécution du renvoi. L’examen dissocié du besoin de protection au sens du droit d’asile d’une part, et du droit des étrangers d’autre part, conduit à une problématique propre au système Suisse : une personne admise à titre provisoire peut être autorisée à rester en Suisse sans que ses motifs d’asile ne soient examinés par une autorité compétente. Ces cas de figure restent cependant marginaux par rapport au nombre de demandes traitées.
3.3.2 Réfugié admis provisoirement
En 2014, 9367 personnes ont été admises à titre provisoire, parmi lesquelles 2494 en tant que réfugiés exclus de l’asile. Les dispositions relatives à l’exclusion de l’asile ont été appliquées en premier lieu aux ressortissants du Tibet (République populaire de Chine), d’Erythrée, de Syrie, du Sri Lanka et d’Iran. Cela s’explique dans la quasi-totalité des cas par l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (voir chap. IX, pt 3.3). Les diasporas de ces pays étant fréquemment surveillées par les services secrets du pays d’origine, toute personne engagée – ou suspectée de l’être – auprès de l’opposition en exil encourt un risque de persécution et devient de ce fait un réfugié. L’exclusion de l’asile vise alors à « punir » les personnes qui ne s’engageraient politiquement qu’au motif d’acquérir la qualité de réfugié. La continuité des convictions ou orientations déjà affichées avant le départ étant particulièrement difficile à démontrer, ces mesures touchent avant tout les communautés de pays [111]dont l’opposition politique est active en Suisse, à l’instar notamment des Iraniens, des Sri Lankais et des Syriens. Sont également exclues de l’asile les personnes dont la qualité de réfugié ne se fonde que sur le départ illégal du pays. Cette situation touche, en Suisse, essentiellement les Erythréens et les Tibétains dont la socialisation en Erythrée ou en Chine n’est cependant pas mise en doute.
3.3.3 Etranger admis provisoirement
Il se peut qu’une personne ne remplisse pas les critères de la qualité de réfugié, sans pour autant que l’on puisse la renvoyer dans son pays d’origine. 6873 personnes ont obtenu en 2014 une admission provisoire, sans reconnaissance de la qualité de réfugié.16 La plupart de ces admissions provisoires sont octroyées en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Les « réfugiés de la violence » ayant fui une situation de guerre ou de violence généralisée peuvent alors rester en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire lorsque la situation sécuritaire est telle que l’on ne saurait raisonnablement exiger qu’ils retournent dans leur pays. En pratique, les ressortissants d’Afghanistan, de Somalie, d’Irak ou de Syrie représentent une part importante des étrangers admis en Suisse à ce titre. D’autres aspects humanitaires, tels que l’état de santé de la personne, l’accès aux soins ou les possibilités de réintégration sociale et économique peuvent également conduire à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, particulièrement en présence d’un cumul d’éléments défavorables au renvoi (chap. X, pt 3).
Lorsque l’autorité prononce l’admission provisoire sans reconnaître la qualité de réfugié, l’intéressé peut recourir contre le rejet de l’asile selon les modalités de recours ordinaires.
3.4 Reconnaissance du besoin de protection (taux de protection)
Le taux d’octroi de l’asile ne suffit pas à reconnaître le besoin de protection des personnes qui déposent une demande d’asile en Suisse. Si l’on admet l’admission provisoire comme étant une forme de protection au même titre que l’asile, on constate que 76.6 % des demandeurs d’asile dont les demandes ont été traitées sur le fond (à l’exclusion des décisions de non-entrée en matière) ont reçu une protection en 2014 à l’issue de la procédure.17 Le SEM détermine quant à lui le taux d’octroi d’une protection par rapport à l’ensemble des décisions rendues en première instance (y compris les décisions de NEM) et arrive à un taux de reconnaissance de 58.3 % en 2014.
[112]4 Aspects procéduraux de la décision
4.1 La décision d’asile et son dispositif
La décision formelle – Le SEM est en principe tenu de statuer par décision sur toute demande d’asile déposée en Suisse.18 La décision se divise en trois parties : la première relate l’état de fait sur lequel se fonde l’examen de la demande, la seconde se prononce sur la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, voire sur les éventuels motifs de non-entrée en matière et la troisième partie se concentre le cas échéant sur l’examen d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi. L’ensemble des conclusions figure dans le dispositif en fin de décision, qui énumère les constatations développées dans les considérants. Les éléments centraux de la décision sont repris dans une lettre d’accompagnement qui n’a pas de valeur légale à proprement parler.
Le dispositif – L’autorité se prononce successivement et séparément sur les éléments essentiels de la décision que sont l’entrée en matière, la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile, le renvoi et l’exécution du renvoi le cas échéant. Elle désigne si nécessaire un canton d’attribution, ou un canton responsable de l’exécution du renvoi. Ce n’est qu’au moment de la reconnaissance formelle du statut de réfugié que la personne peut se prévaloir des droits qui découlent de la qualité de réfugié, excluant toute application rétroactive.19
4.2 Délais et stratégies de traitement
Délais de traitement – En procédure de première instance, le SEM doit en principe rendre une décision dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 2 LAsi).20 Pour les décisions NEM, le délai d’ordre est de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande ou de l’approbation d’une requête de (re)prise en charge par un autre Etat Dublin (al. 1). Les délais d’ordre de la LAsi [113]sont applicables par analogie aux demandes de réexamen.21 Le non-respect de ces délais n’a toutefois pas de conséquence juridique sur la procédure.22 En dépit de la volonté marquée de l’ensemble des acteurs de la procédure, les incitations législatives ne suffisent visiblement pas à réduire les délais de traitement en pratique. D’importants changements sont toutefois attendus avec l’introduction des procédures cadencées actuellement expérimentées au centre test de la Confédération à Zurich (chap. V, pt 5).
Stratégie de traitement – La loi sur l’asile impose au SEM une stratégie de traitement des demandes qui tienne compte de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes, ainsi que du comportement des requérants (art. 37b LAsi). Le SEM a également une obligation de diligence particulière lorsque le requérant est un mineur non-accompagné ou lorsqu’il se trouve en détention (art. 37b en lien avec art. 17 al. 2bis LAsi). La stratégie de traitement du SEM consiste souvent à prioriser les demandes d’asile pouvant être rapidement rejetées. Le traitement prioritaire des demandes émanant de personnes provenant de régions en conflit au cours de l’année 2014 a eu pour effet positif de réduire nettement le nombre de dossiers en suspens en première instance, avec de surcroît l’avantage considérable de fixer les demandeurs sur leur sort et de favoriser leur intégration.23
Les coûts d’une durée de procédure excessive : La durée des procédures engendre des coûts notables, non seulement pour les autorités, mais également pour les requérants d’asile. Alors qu’une part de ces coûts se laisse facilement déduire des frais d’entretien et administratifs engendrés tout au long de la procédure, une autre partie, plus difficilement quantifiable, se rapporte aux coûts sociaux et économiques de la « désintégration » des demandeurs d’asile. L’incertitude sur l’avenir, et les problèmes de santé qui l’accompagnent, ralentissent considérablement le processus d’intégration, engendrant des coûts qui se répercutent alors sur le système de santé et des assurances sociales. Sur les coûts de la procédure d’asile et la répartition des frais entre cantons et Confédération, il est utile de se référer au rapport final du groupe de travail sur la restructuration, Planification générale de la restructuration du domaine de l’asile, du 18 février 2014.24
[114]4.3 Déni de justice et retard injustifié
L’obligation de célérité – Le requérant peut se prévaloir du traitement de sa demande « dans un délai raisonnable » en vertu des garanties de procédure de l’art. 29 al. 1 Cst. Un recours pour déni de justice peut être déposé auprès de l’autorité de recours lorsque le SEM s’abstient de rendre une décision sans en avoir le droit ou tarde à le faire (art. 46a PA). On parle de déni de justice formel (Rechtsverweigerung) lorsque l’autorité refuse expressément de statuer alors qu’elle en a l’obligation ou lorsqu’elle ne statue que partiellement. Le déni de justice matériel peut être, quant à lui, constaté en cas de retard injustifié (Rechtsverzögerung), lorsque l’autorité tarde sans droit à statuer ou décide à tort de suspendre la procédure.
Le délai raisonnable – Le délai au-delà duquel l’inaction de l’autorité contrevient à son obligation de statuer dépend de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Il s’apprécie au cas par cas sur la base d’éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l’affaire, le temps qu’exige l’instruction de la procédure, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. L’importance du bien juridique défendu doit être prise en considération, tout comme les répercussions que peut avoir une attente excessive sur la santé du requérant.25 Il doit également être tenu compte des délais d’ordre de la LAsi (art. 37 et 37b LAsi). Dans des circonstances concrètes et objectives, le SEM peut justifier une prolongation de la procédure, mais ne peut s’appuyer sur des motifs liés à une organisation déficiente, à un manque de personnel ou à une surcharge structurelle.26 Il n’est pas important de savoir s’il a commis une faute, mais uniquement de déterminer s’il a agit dans un délai raisonnable.
Le TAF a estimé que l’autorité administrative a contrevenu à son devoir de célérité dans les cas suivant (déni de justice matériel)27 :
Procédure ordinaire :
Plus de deux ans se sont écoulés depuis le dernier acte de procédure sans que la requérante érythréenne n’ait été convoquée à l’audition sur les motifs [115]d’asile. La pénurie d’interprète en tigrigna ne justifie pas l’inactivité du SEM.28
Aucune mesure d’instruction reconnaissable n’a été entreprise pendant 25 mois.29
Demande de réexamen30 :
dans le cadre de la seconde demande de réexamen d’une femme éthiopienne accompagnée de son nouveau-né et traumatisée par les viols subis, le TAF a estimé qu’il était opportun de conclure rapidement la procédure de réexamen. Les quatorze mois d’inactivité du SEM depuis le dépôt de la demande de réexamen violent l’obligation de célérité.
Procédures d’ambassade et autorisations d’entrer en Suisse :
Au vu de la situation délicate des requérants d’asile érythréens au Soudan, le délai de 17 mois dépasse clairement le délai raisonnable pour statuer sur l’entrée en Suisse.31
L’attente de 11 mois pour la remise d’un formulaire type relatif aux motifs d’asile, malgré les demandes répétées des requérants, viole l’obligation de diligence de l’autorité.32
Mineurs non accompagnés – L’obligation de célérité prend une importance particulière dans le cadre des procédures de mineurs non accompagnés. L’incertitude quant à l’issue de la procédure fait peser sur le mineur une pression psychique considérable et la durée excessive de la procédure peut avoir des répercutions néfastes sur son intégration, en raison notamment des difficultés d’accès à la formation. Au moment de l’impression, le TAF n’avait pas encore défini de portée propre à la nouvelle disposition de l’art. 17 al. 2bis LAsi qui impose au SEM une diligence particulière dans le traitement prioritaire des demandes de MNA.33 En l’espèce, il a admis le déni de justice dans les cas de MNA suivants :
Déni de justice constaté le 19 mars 2015 pour une demande d’asile déposée le 22 février 2011 par trois frères et sœurs MNA. Le SEM a cessé ses échanges avec le HCR en vue de la clarification de l’état de fait en mars 2013 et n’a pas réagit aux demandes répétées des requérants envoyées dès le mois de mai 2014.34
[116]Déni de justice constaté le 10 janvier 2014, dans le cas d’un mineur devenu non accompagné au moment du décès de son père survenu après le dépôt d’une demande d’asile en novembre 2010. Malgré de nombreux rappels adressés au SEM, le garçon n’avait pas été entendu sur ses motifs d’asile plus de trois ans après le dépôt de la demande.35
L’absence de mesures de traitement d’une demande d’un MNA afghan pendant 24 mois a été jugé contraire à l’obligation de diligence de l’autorité.36 Le même constat a été tiré dans une autre affaire, alors que l’autorité est restée inactive pendant deux ans et demi.37
Déni de justice formel – Lorsque le SEM refuse indûment de statuer sur une question de droit ou ne statue que partiellement, le TAF admet un déni de justice formel et renvoie généralement le dossier à l’autorité inférieure. Dans un cas d’espèce, le SEM a contrevenu à son devoir de statuer en refusant de se prononcer sur la demande d’asile d’un mineur qu’il a traité conjointement à la demande de réexamen de ses parents.38 C’est également indûment que le SEM a éludé la demande de réexamen d’un requérant visant à inclure son épouse dans le statut d’asile.39
Exigences formelles – Le recours pour déni de justice matériel peut être déposé en tout temps (art. 50 al. 2 PA), quand bien même le requérant n’aurait pas encore été entendu sur ses motifs d’asile. Le requérant doit avoir un intérêt digne de protection au moment du dépôt de la requête et pouvoir démontrer la bonne foi de sa démarche.40 Les mesures entreprises pour inciter le SEM à statuer au plus vite ne sont pas une condition formelle d’entrée en matière, mais il convient d’en tenir compte. Dans le cadre d’un recours pour déni de justice formel, la jurisprudence du TF exige que le recours soit déposé dans les 30 jours qui suivent le refus de l’autorité de se prononcer sur la question.41 Quant au mémoire de recours, il doit répondre aux exigences de forme générales prescrites par la PA (art. 52 PA).
Conséquences juridiques – Lorsque le TAF entre en matière sur le recours, il n’examine pas le fond de l’affaire, mais se détermine uniquement sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure. Si le déni de justice est admis, il renvoie généralement le dossier à l’autorité inférieure qu’il exhorte à statuer dans les meilleurs [117]délais. L’examen de la demande se poursuit idéalement plus rapidement, bien que le Tribunal ne fixe généralement pas de délai contraignant pour agir.42
Délais de traitement du TAF – En tant qu’autorité de surveillance administrative,43 le Tribunal fédéral peut recevoir des plaintes lorsque le TAF s’abstient indûment de rendre une décision ou tarde à le faire (art. 71 PA). Cette dénonciation ne confère aucun droit au dénonciateur qui ne dispose pas des droits de partie (art. 71 al. 2 PA). Le Tribunal fédéral examine alors uniquement si le cours de la procédure devant le TAF correspond au déroulement régulier d’une affaire. Les critères développés par la jurisprudence dans le cadre du recours pour retard injustifié s’appliquent par analogie.44 En pratique, une procédure de trois ans et neuf mois (45 mois) ne correspond objectivement pas au déroulement ordinaire d’une affaire.45 Le TAF a également été condamné pour violation du devoir de célérité dans le cadre d’une procédure d’asile (menée en parallèle à une procédure d’extradition) ayant duré 21 mois, dont 9 d’inactivité complète,46 ainsi que dans le cadre d’une demande de révision durant laquelle aucune mesure d’instruction n’a été prise pendant 21
mois.47
4.4 Classement sans décision formelle
Conformément au droit administratif général, une demande est radiée du rôle lorsqu’elle devient sans objet ou qu’un intérêt juridique fait défaut.48 Cela arrive notamment lorsque le requérant d’asile retire sa demande dans la perspective d’une autre autorisation de séjour, par exemple à la suite d’un mariage, ou lorsque le requérant est devenu introuvable. Lors de la révision du 14 décembre 2012,49 Le législateur a introduit de nouveaux motifs de classement propres aux procédures d’asile. Le SEM est ainsi autorisé à classer une demande sans décision formelle dans les cas suivants :
[118]Le requérant, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours, sous réserve de la Convention de Genève (art. 8 al. 3bis LAsi ; voir chap. XII, pt 3.2)
Suite à l’entretien de conseil, le requérant retire une demande d’asile qui n’est pas conforme à la loi ni suffisamment justifiée (art. 25a LAsi)
La demande de réexamen (art. 111b LAsi) ou la demande multiple (art. 111c LAsi) est infondée ou présente de manière répétée les mêmes motivations (voir chap. XIII, pt 7.2 s).
Ces nouveaux motifs de classement poursuivent des objectifs punitifs (en cas de violation du devoir de collaborer ou de demandes dites abusives) ou d’économie de procédure qui dépassent largement le cadre jusqu’ici admis du classement des demandes devenues sans objet. Or, en renonçant à l’examen matériel des motifs d’asile, la décision de classement est susceptible d’avoir de graves conséquences pour les personnes touchées. Elle doit donc répondre à des exigences procédurales strictes pour assurer sa conformité aux principes généraux du droit et aux engagements internationaux de la Suisse.50 Cela requiert l’existence de voies de contestation auprès d’une autorité judiciaire, l’examen subséquent d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi par une autorité de préférence fédérale et la possibilité de rouvrir un dossier, voire de déposer une seconde demande d’asile suite au classement.
Voies de contestation – La possibilité de contester un classement sans décision formelle n’est pas encore totalement clarifiée. Le classement d’une demande doit selon nous pouvoir être contesté conformément aux dispositions des art. 105 ss LAsi, dans le respect des garanties de procédure de l’art. 29 Cst. et du droit à un recours effectif de l’art. 13 CEDH.51 Par le classement de la demande, l’autorité prive le requérant de l’examen de ses motifs d’asile et de la possibilité de se voir accorder une protection. L’intérêt juridique défendu est de haute importance et [119]l’appréciation de l’autorité soulève des questions de droit complexes.52 Ainsi, à titre d’exemple, le caractère suffisamment fondé ou non d’une demande de réexamen ne peut être soumis à la seule appréciation de l’autorité administrative, au risque de contrevenir aux droits fondamentaux des personnes concernées (voir chap. XIII, pt 7.2).53
La proportionnalité d’une décision de renvoi sans examen préalable des motifs d’asile ou des obstacles à l’exécution du renvoi doit à notre sens également être soumise au contrôle juridictionnel d’une autorité de recours lorsqu’elle fait suite à une violation du devoir de collaborer. Déterminant quant aux droits et aux obligations dont peuvent se prévaloir les requérants, le classement constitue à notre sens une décision au sens de l’art. 5 PA et devrait à ce titre pouvoir être contesté directement auprès de l’instance de recours. Le SEM ne partage toutefois pas cet avis.54 Dans l’attente d’une clarification du TAF sur la nature juridique de la décision de classement, la possibilité de demander une décision en constatation au SEM conformément à l’art. 25 PA subsiste et permet d’assurer l’exercice du droit au recours.55
Examen des obstacles à l’exécution du renvoi – Le renvoi ne peut être exécuté sans qu’il ne soit procédé à un examen préalable des obstacles qui s’y opposeraient (art. 83 et 84 LEtr). Dans le cadre de procédures de droit des étrangers, il revient actuellement aux cantons d’examiner en dernier lieu l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi selon la LEtr. Cette solution semble toutefois insatisfaisante au vue de la grande variabilité des pratiques cantonales et du manque d’expertise des autorités de police quant à la situation qui prévaut dans les pays d’origine.56 La possibilité laissée aux cantons de proposer l’admission provisoire au SEM (art. 83 [120]al. 6 LEtr) ne remplit pas les exigences légales nécessaires à garantir le respect du principe de non-refoulement.