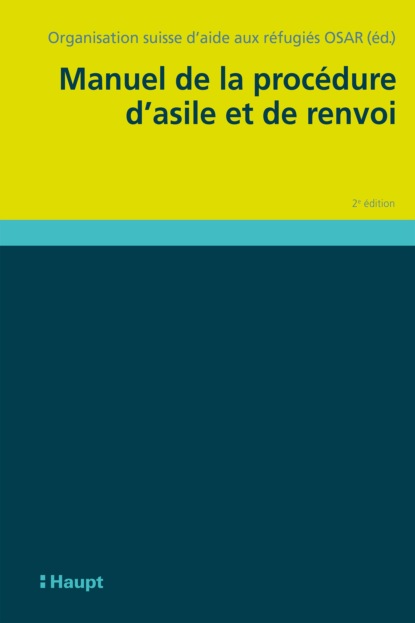- -
- 100%
- +
3.2.4 Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEtr)
3.2.5 Détention en vue de l’exécution du renvoi dans le cadre d’une procédure Dublin (art. 76a LEtr)
3.2.6 Détention en vue du refoulement en cas de non-collaboration à l’obtention des documents de voyage (art. 77 LEtr)
3.2.7 Détention pour insoumission (art. 78 LEtr)
3.3 Procédure de contrôle de la décision
3.4 Conditions de détention (art. 81 LEtr)
3.5 Perspectives
XVII Réglementation des cas de rigueur
1 Généralités
2 Procédure
2.1 Procédure devant l’autorité cantonale
2.2 Qualité de partie dans la procédure cantonale
2.3 Suspension de l’exécution du renvoi ?
2.4 Procédure d’approbation devant le SEM
3 Conditions
3.1 Conditions formelles
3.2 Conditions matérielles (art. 31 OASA)
3.2.1 Intégration
3.2.2 Durée de la présence en Suisse
3.2.3 Respect de l’ordre juridique
[19]3.2.4 Situation familiale
3.2.5 Etat de santé
3.2.6 Réintégration dans le pays de provenance
3.2.7 Justification de son identité
3.3 Conditions matérielles (art. 30a OASA)
4 Réglementation des cas de rigueur dans la pratique cantonale
4.1 Pratiques diverses
4.2 Commissions cantonales des cas de rigueur
5 Excursus : Demande de cas de rigueur pour des personnes avec un livret F conformément à l’art. 84 al. 5 LEtr
XVIII Application de la procédure d’asile à certains groupes de personnes.
1 Familles
1.1 Généralités
1.2 Asile familial
1.2.1 Le cercle des personnes privilégiées
1.2.2 Motif d’exclusion des « circonstances particulières »
1.2.3 Qualité de réfugié originaire et dérivée
1.2.4 Asile familial et regroupement familial en provenance de l’étranger
1.2.5 Asile familial pour les membres de la famille se trouvant en Suisse
1.3 Effets de l’asile accordé aux familles (art. 51 LAsi)
1.4 Etrangers admis provisoirement
1.4.1 Regroupement familial de membres de la famille à l’étranger
1.4.2 Inclusion des membres de la famille en Suisse
2 Victimes de persécution de nature sexuelle
2.1 Généralités
2.2 Persécution spécifique aux femmes
2.2.1 Définition
2.2.2 Domaines problématiques et situation juridique / aspects procéduraux
2.3 Persécution des LGBTI
2.3.1 Définition de la persécution des LGBTI
2.3.2 Aspects procéduraux
3 Requérants d’asile mineurs non accompagnés
[20]3.1 Généralités
3.2 Domaines problématiques et situation juridique
3.2.1 Capacité d’ester en justice
3.2.2 Détermination de l’âge
3.2.3 Curatelle et tutelle
3.2.4 Désignation d’une personne de confiance
3.2.5 Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant pendant le séjour en Suisse
3.2.6 Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant en cas de renvoi
4 Victimes de la traite d’êtres humains
4.1 Définition de la traite d’êtres humains et pertinence dans la procédure d’asile
4.2 Aspects procéduraux
5 Requérants d’asile avec un handicap
6 Apatrides
7 Requérants d’asile adultes incapables de discernement
Liste des abréviations
Bibliographie
Matériel législatif
Sites internet utiles
Table des illustrations
Les auteurs
[21]Préface de l’éditrice
Le présent manuel de la procédure d’asile et de renvoi est la seconde édition, entièrement revue, du manuel rédigé par Ruedi Illes, Nina Schrepfer et Jürg Schertenleib. La première édition de l’ouvrage, parue aux éditions Haupt en 2009, avait revisité en profondeur le manuel de référence de Mario Gattiker sur la procédure d’asile et de renvoi paru dans sa 3ème édition en 1999. Depuis 2009, les bases du droit d’asile ont subi d’importantes modifications dans plusieurs domaines, tant dans le contexte européen que suisse, de sorte qu’une révision du manuel s’imposait depuis longtemps.
Le but du manuel n’a cependant pas changé : les représentant-e-s des œuvres d’entraide, les étudiant-e-s, les mandataires juridiques des requérant-e-s d’asile et des réfugié-e-s ainsi que toutes les personnes intéressées par les questions relevant du droit d’asile devraient y obtenir un aperçu rapide de la situation juridique actuelle et trouver facilement des informations précises sur les bases légales, la jurisprudence et la pratique en vigueur.
La structure du manuel s’apparente à celle de la première édition. Les fondements de la procédure d’asile et de renvoi et son déroulement y sont décrits, de même que leurs implications pour les personnes concernées. Le manuel ne se limite donc pas simplement aux procédures de reconnaissance de la qualité de réfugié, d’octroi de l’asile et d’examen des obstacles à l’exécution du renvoi ; il traite également des nouveaux développements politiques et juridiques et expose certaines constellations spécifiques au droit d’asile qui sont présentées de manière aussi complète que possible dans un cadre clair et concis. Il est tenu compte de la jurisprudence jusqu’à juin 2015. Dans la version française, nous avons renoncé, pour des motifs de simplification du texte, à l’usage du langage épicène. Nous avons privilégié la forme masculine du fait que la grande majorité des requérants d’asile arrivés en Suisse sont des hommes, à l’inverse des réfugiés à l’échelle mondiale majoritairement représentés par les femmes. La forme masculine inclut ici implicitement l’ensemble des personnes concernées, hommes et femmes confondus.
Nous remercions Ruedi Illes, Nina Schrepfer et Jürg Schertenleib qui ont rendu possible la parution de cette seconde édition en acceptant le remaniement de leur ouvrage de 2009. Nous tenons aussi à remercier le Secrétariat d’Etat aux migrations, qui a soutenu la publication de cette édition avec une généreuse contribution. L’OSAR remercie tout particulièrement les auteur-e-s de la nouvelle édition[22] et spécialement les auteures externes Susanne Bolz, Nula Frei, Teresia Gordzielik, Olivia Le Fort Mastrota et Stephanie Motz qui ont fait preuve d’un grand engagement et d’une précieuse expertise dans la rédaction de l’ouvrage. Nous remercions également Olivier von Allmen, avocat indépendant à la Chaux-de-Fonds, pour la traduction des textes allemands vers le français. Pour leur aide inestimable dans le cadre de la finalisation de l’ouvrage, nous remercions chaleureusement Maria Keller, Anne Kneer, Christelle Maire, Bojana Milicevic, Jonathan Thévoz, Djouna Vodoz et particulièrement Jean Perrenoud. Merci aussi aux collaboratrices et colborateurs de l’OSAR, en particulier Sarah Frehner, Seraina Nufer, Johan Rochel, Adrian Schuster et Christoph Hess pour le soutien multiple et varié apporté dans le cadre de la préparation, de la réalisation technique et juridique et de la finalisation de l’ouvrage. Nous adressons aussi nos sincères remerciements aux éditions Haupt pour être toujours restées à l’écoute et pour la collaboration empreinte de confiance dans le cadre de la publication du manuel.
Pour l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés,
Adriana Romer
Marie Khammas
Constantin Hruschka
Richard Greiner
Michael Pfeiffer
Berne, octobre 2015
I Introduction
[23]Le développement du droit d’asile en Suisse et en Europe est actuellement au cœur de l’attention politique et sociétale. Loin de se limiter au Parlement fédéral, les questions d’asile sont également âprement débattues dans le domaine public. Dans les cantons et les communes du pays, l’asile passionne et donne naissance à d’importants débats de société.
Ces débats ne reflètent pas seulement la sensibilité des thèmes liés à l’asile, mais indiquent également la pertinence des échanges sur l’identité suisse et la façon dont le pays voit son rôle dans un monde en changement permanent. Par les questions qu’il soulève et les défis qu’il provoque, l’asile renvoie le pays à l’importance de sa « tradition humanitaire ». Alors que l’histoire et la perception d’elle-même que la Suisse aime entretenir sont marquées par cette ambition humanitaire – notamment l’accueil des Huguenots à Genève aux 16ème et 17ème siècles – la législation actuelle trouve sa source au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
La politique suisse en matière de réfugiés durant ce conflit a souvent été critiquée parce qu’elle était dominée par une attitude générale de rejet. Pour de nombreux observateurs, le renvoi à la frontière des personnes cherchant protection et le statut juridique des réfugiés admis, pour la plupart, seulement de manière provisoire marquent un chapitre sombre de l’histoire contemporaine suisse. L’adhésion de la Suisse en 1955 à la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés1 est marquée par ce contexte.
En 1957, le Conseil fédéral considère l’octroi de l’asile comme une maxime de politique fédérale : « Le droit d’asile n’est pas une simple tradition de la Suisse. Il est un principe politique et une manifestation de la conception suisse de la liberté et de l’indépendance. […] L’histoire des réfugiés pendant la dernière guerre mondiale nous apprend que la Suisse devrait accueillir dans la mesure de ses possibilités les fugitifs étrangers, c’est-à-dire les hommes qui cherchent asile sur son sol parce que leur vie et leur intégrité corporelle sont sérieusement menacées. Elle nous montre aussi que les autorités ne devraient en principe pas fixer de chiffre maximum pour l’accueil de ces personnes. […] Notre pays ayant le devoir de pratiquer l’asile d’une manière conforme à sa tradition, il y a lieu d’envisager un large accueil des réfugiés [24][en allemand : « eine freie, weitherzige Aufnahme von Flüchtlingen »]. »2 L’accueil des personnes persécutées compte ainsi comme tâche essentielle de la collectivité et marque une ligne de conduite pour l’activité de l’Etat et pour le législateur.
Jusqu’au début des années quatre-vingts, la politique suisse d’asile a été marquée par l’admission de groupes de réfugiés persécutés à la suite de troubles politiques, de guerres et de guerres civiles, comme en Hongrie (1956), au Tibet (1962), en Tchécoslovaquie (1968), au Chili (1973), en Indochine (1975) et en Pologne (1982). Les réfugiés étaient d’habitude admis collectivement sans examen individuel comparable à la procédure d’asile actuelle. En règle générale, le pays accueillait les personnes qui pouvaient prouver leur appartenance au groupe que le Conseil fédéral avait décidé d’admettre en Suisse. Parallèlement, l’immigration des travailleurs étrangers fut débattue de manière extrêmement controversée depuis la fin des années soixante. Le discours public a été fortement marqué par l’initiative dite « Schwarzenbach », refusée à 54 % en 1970.3 A l’époque, l’admission des réfugiés se basait sur quelques normes du droit général des étrangers (loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers – LSEE, et ordonnances relatives à cette loi) et sur des circulaires. Ce n’est qu’en 1979 que le législateur a édicté une première loi sur l’asile, entrée en vigueur le 1er janvier 1981.
Depuis l’entrée en vigueur de cette première loi sur l’asile, le cadre juridique s’est développé de manière à la fois rapide et profonde. Même si le traitement des ressortissants étrangers relève d’une compétence clé de l’Etat souverain, cette souveraineté se justifie et s’exerce dans les limites du droit international public. Les engagements de droit international pris par la Suisse ont une importance cruciale dans le cadre des procédures d’asile et de l’octroi d’une protection.
Depuis une vingtaine d’années, le régime européen de l’asile exerce une influence considérable sur la Suisse. Même si elle n’est pas membre de l’Union européenne, la Suisse participe au régime de Dublin et de Schengen. A ce titre, elle est géographiquement, juridiquement et politiquement partie intégrante des évolutions européennes. Une vue d’ensemble des normes en vigueur ne peut donc faire l’économie [25] de comprendre les relations parfois complexes entre le droit suisse, le droit européen et les normes de droit international public.
1 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention de Genève, CR, RS 0.142.30). Le champ d’application de la CR a été élargi par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (dit Protocole de New York). Dans le présent manuel, la CR fait toujours référence à la Convention de 1951 telle qu’élargie par le Protocole de New York.
2 Rapport du Conseil fédéral du 1er février 1957 concernant les « Principes à observer dans la pratique de l’asile en cas de tension internationale accrue ou de guerre », publié dans le contexte du rapport Ludwig (Ludwig Carl, La politique pratiquée par la Suisse à l’égard des réfugiés au cours des années 1933 à 1955, rapport adressé au Conseil fédéral à l’intention des conseils législatifs). Voir annexe au rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 13 septembre 1957 sur la politique pratiquée par la Suisse à l’égard des réfugiés au cours des années 1933 à nos jours, p. 387 ss, FF 1957 II 668.
3 Initiative populaire fédérale « contre l’emprise étrangère », voir à ce sujet le Rapport du Conseil fédéral, FF 1969 II 1050. La votation a eu lieu le 7 juin 1970, FF 1970 II 301.
[26][27]II Développements juridiques
Johan Rochel
1 Les développements du droit suisse
1.1 Développements précédents
Jusqu’en 1981, les dispositions légales sur l’asile étaient intégrées au droit général des étrangers. Les deux matières étaient traitées ensemble, car elles concernaient toutes deux des personnes de nationalité étrangère. Aujourd’hui, le droit d’asile forme un régime spécifique qu’il faut distinguer du droit des étrangers, mais aussi de l’association de la Suisse à certaines parties du droit de l’Union européenne. Sur le fond, les matières présentent des différences importantes. Malgré ces différences, ces domaines du droit connaissent de nombreux recoupements et interférences. Par exemple, le statut juridique des personnes admises provisoirement ou les mesures de contrainte qui touchent de nombreux requérants déboutés sont réglés dans la loi sur les étrangers (LEtr). Les bases essentielles sur les questions de l’intégration ou de l’octroi des autorisations pour cas de rigueur sont également contenues dans le droit des étrangers. Suivant le statut en cause, différentes bases légales sont donc applicables.
Depuis la première loi sur l’asile de 1979, le développement du droit d’asile est marqué par une cadence de révisions très rapide. Ces révisions reflètent notamment l’évolution des conditions cadres extérieures de la politique suisse de l’asile, marquée entre autres par une augmentation constante des demandes d’asile jusqu’au début des années nonante. Depuis lors, d’importantes variations ont eu lieu. Les périodes d’augmentation des demandes ont été marquées par une forte attention publique. Alors qu’en 1979, le nombre des demandes d’asile était encore inférieur à 1’000, il a dépassé les 10’000 pour la première fois en 1987. En 1989, il s’est élevé à 24’425 avant d’atteindre 41’629 en 1991. En 1992, il a diminué de plus de la moitié. En 1997, un peu moins de 24’000 demandes d’asile ont été enregistrées alors que 41’302 demandes ont été déposées en 1998 suite au conflit du Kosovo. En 2014, 21’695 personnes ont déposé une première demande d’asile en Suisse.1
[28]En plus de provoquer de vifs débats de politique intérieure sur les prétendus excès de générosité de la législation suisse sur l’asile, l’évolution du nombre des demandes d’asile a posé des problèmes administratifs et logistiques considérables aux autorités fédérales et cantonales (longue durée de la procédure, nombre de dossiers pendants, difficultés d’hébergement, etc.). Depuis 1979, les révisions partielles ont ainsi toujours été axées sur l’accélération et la simplification de la procédure. Elles ont aussi régulièrement conduit à des tentatives visant à détériorer le statut juridique des requérants d’asile.
La loi sur l’asile de 1979 a été soumise à une révision totale en 1998. Entre 1999 et 2014, celle-ci a connu d’importants changements par le biais de nombreuses révisions partielles. Parmi ces changements, les adaptations de la loi sur l’asile dans les processus d’adoption de la loi sur les étrangers et d’association à l’espace Schengen/ Dublin ont été les plus significatives. La LEtr et l’association à Schengen/Dublin ont été confirmées en votation populaire en 2005 et 2006. Durant cette phase d’évolutions, trois éléments ont joué un rôle prépondérant.
Premièrement, le domaine de l’asile a fait l’objet d’initiatives populaires visant directement les requérants d’asile et d’autres propositions traitant plus généralement des conditions d’entrée et de séjour des ressortissants étrangers. En 2002, l’initiative populaire « contre les abus du droit d’asile » lancée par l’UDC a été rejetée d’extrême justesse par 50.1 % des voix en votation populaire. L’initiative puisait sa source dans la crise du Kosovo, une période difficile durant laquelle de très nombreuses personnes déplacées cherchaient une protection en Suisse. Pour le Conseil fédéral et la majorité des partis politiques, son rejet de justesse était un signe révélateur que de nombreux citoyens souhaitaient de nouveaux durcissements de la loi sur l’asile. De manière plus générale, l’initiative sur le renvoi des étrangers criminels (acceptée par le peuple et les cantons en 2010) et l’initiative contre l’immigration de masse (acceptée par le peuple et les cantons en 2014) sont particulièrement symptomatiques de la pression politique qui s’exerce sur la thématique générale de la migration en Suisse.
Deuxièmement, la loi sur l’asile a été durcie pour raison d’économie sur le budget fédéral. A titre d’exemple, le régime de l’aide sociale a été durablement modifié et une forte pression continue à s’exercer demandant l’exclusion de l’aide sociale des personnes relevant de l’asile. Le passage de l’aide sociale à l’aide d’urgence est devenu pratique courante dans le domaine de l’asile. En 2005, le Parlement fédéral avait même proposé d’exclure de l’aide d’urgence les requérants déboutés qui refussaient de coopérer. En même temps, le Tribunal fédéral a jugé dans un cas d’espèce que l’exclusion de l’aide d’urgence était contraire à la Constitution.2 Cette décision [29]a poussé les Chambres fédérales à retirer cette proposition. Plusieurs propositions discutées dans le domaine mettent directement en jeu la répartition des compétences entre les cantons et la Confédération. De manière générale, ces propositions illustrent le changement de paradigme dans le domaine de l’aide sociale pour l’asile et le nécessaire dialogue qui s’engage entre autorités judiciaires et pouvoirs politiques.
Troisièmement, la Suisse est entrée de plein pied dans le régime européen de l’asile en acceptant en 2005 les accords d’association à Schengen et Dublin. Depuis cette date, les modifications de la loi sur l’asile ont été marquées par l’influence grandissante du cadre européen. En 2008, le Parlement a adopté la reprise du code frontières Schengen et ses compléments en vue de la mise en œuvre complète de l’acquis Schengen/Dublin. Dès lors, les développements des acquis Schengen et Dublin ont influencé la législation suisse sur l’asile, la Suisse s’étant engagée à reprendre ces développements. Pour le domaine de l’asile, les développements liés à la mise en œuvre de la Directive retour et la reprise des nouveaux règlements Dublin et Eurodac ont été particulièrement importants.
Ces trois composantes – pression grandissante des initiatives populaires, pression budgétaire et discussion sur la répartition des compétences entre cantons et Confédération, influence du contexte européen – continuent de marquer le développement du droit suisse. En plus d’adaptations ponctuelles, une nouvelle révision significative du droit d’asile se dessine depuis 2009. Cette révision de fond devrait changer durablement le visage de la procédure d’asile en Suisse.
1.2 Restructuration du domaine de l’asile
Entre 2010 et 2012, le Conseil fédéral et le Département de justice et police de la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga ont esquissé les contours d’une restructuration complète du domaine de l’asile. Une partie des modifications proposées ont été déclarées urgentes par le Parlement, puis combattues sans succès par référendum dans une votation populaire (juin 2013). Les mesures urgentes les plus débattues concernaient le droit de déposer une demande d’asile dans une ambassade suisse, le statut accordé aux personnes fuyant une obligation de service militaire, la création d’une base légale pour créer des centres spéciaux pour requérants d’asile récalcitrants et la création d’une base légale pour l’utilisation de bâtiments publics par la Confédération. Ces mesures urgentes ont été intégrées dans la révision générale proposée au Parlement fédéral en 2014. Dans les mesures non-urgentes proposées par le Conseil fédéral et acceptées par le Parlement, il est important de noter l’abandon de la plupart des clauses de non-entrée en matière. Seules les clauses relatives aux requérants dont la protection est assurée dans un Etat tiers,[30] aux cas Dublin ou aux demandes déposées exclusivement à des fins économiques ou médicales ont été maintenues.
La restructuration générale du domaine de l’asile est placée sous le mot d’ordre de l’accélération des procédures. A cette fin, la procédure d’asile sera fondamentalement modifiée en s’inspirant du modèle hollandais. L’idée-clé consiste à traiter rapidement un nombre important de demandes dans des centres rassemblant tous les acteurs de la procédure d’asile. A terme, la majorité des requérants ne seraient ainsi plus attribués à un canton et resteraient durant toute la procédure dans un centre unique. Ce centre rassemblerait l’ensemble des acteurs de la procédure d’asile, à savoir principalement les autorités fédérales du SEM, les services sociaux et les conseillers et représentants juridiques. Depuis janvier 2014, ce projet est testé dans le cadre d’un projet pilote mené à Altstetten (Zurich). Un projet de loi reprenant les éléments principaux de ce projet pilote a été soumis au Parlement fédéral en septembre 2014. Les Chambres fédérales ont adopté le projet, avec quelques modifications, le 25 septembre 2015.
La restructuration adoptée marque un changement fondamental dans la façon de concevoir la procédure d’asile. Elle signifie premièrement une répartition différente des compétences entre les cantons et la Confédération. Comme elle le faisait déjà pour les centres d’enregistrement et de procédure, la Confédération devient responsable des procédures accélérées ayant lieu dans les nouveaux centres. Sur ce nouveau modèle, les cantons qui n’hébergent pas de centres fédéraux ne sont responsables que des demandes qui leur sont transmises après une première phase de sélection, des personnes ayant reçu protection ainsi que des personnes dont l’exécution du renvoi n’est pas prévisible. Cette réforme devrait permettre, à terme, d’accélérer sensiblement la durée des procédures d’une majorité de demandes. De manière cruciale, la nouvelle loi repose sur l’équilibre entre cette accélération des procédures et la garantie d’une offre adéquate et gratuite en termes de conseils et de représentation juridiques. De plus, la qualité des procédures doit être compatible avec les standards de l’Etat de droit et avec les engagements européens et internationaux de la Suisse.
De manière générale, la restructuration complète du domaine de l’asile peut s’appuyer sur de solides appuis, tant au Parlement fédéral qu’auprès des organisations et associations travaillant dans le domaine de l’asile. Tous soulignent la nécessité d’accélérer les procédures d’asile tout en garantissant les standards d’un Etat de droit. Du point de vue de la protection des requérants d’asile, cette accélération ne sera acceptable que si la qualité de la procédure est compatible avec les standards que la Suisse se doit de respecter.