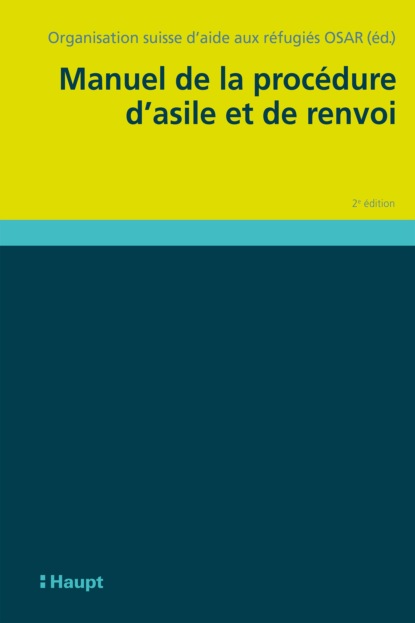- -
- 100%
- +
[31]2 Le contexte international
De manière générale, les Etats ont la compétence de déterminer à quels ressortissants étrangers ils veulent accorder un droit de séjour sur leur territoire. Par les choix souverains qu’elle a réalisés, la Suisse s’est toutefois engagée à respecter certains droits et principes du droit international.
Le concept de « juridiction » joue un rôle essentiel à cet égard. En bref, la responsabilité de l’Etat est engagée dès qu’une personne se trouve sous sa juridiction. Dès ce moment, l’Etat porte la responsabilité d’assurer une protection suffisante à cette personne. En plus des droits et principes reconnus dans sa propre Constitution, cette protection comprend l’ensemble des droits conférés par les conventions et traités internationaux que l’Etat en question s’est engagé à respecter.
Dans la plupart des cas, cette question de la juridiction est relativement facile à régler. La présence de la personne sur le territoire de l’Etat coïncide avec la juridiction. Lorsqu’un requérant d’asile se rend à la frontière d’un Etat, il entre sous sa juridiction en déposant une demande d’asile. Toutefois, comme une série de décisions sensibles le prouve, cet aspect peut être difficile à clarifier lorsque l’Etat agit au-delà de ses frontières. Un arrêt de principe de la Cour européenne des droits de l’homme de 2012 traite de la responsabilité de l’Italie lorsqu’elle intercepte des bateaux de migrants en Méditerranée.3 Selon la Cedh, le critère de juridiction était rempli dans ce cas d’espèce. L’Italie était donc responsable d’assurer une protection en adéquation avec ses engagements internationaux, dans ce cas la CEDH. Cette responsabilité n’implique pas de reconnaître automatiquement l’asile à ces requérants, mais elle implique un traitement juste et conforme de leur demande. De manière générale, cette notion de juridiction fait donc apparaître clairement les liens entre souveraineté, responsabilité et respect des engagements internationaux.
Une fois ce critère de juridiction établi, différents engagements internationaux de la Suisse s’appliquent, notamment la Convention de Genève (CR). Cette convention fonde le droit d’asile moderne et la définition du réfugié qu’elle contient fait office d’étalon pour les législations nationales. D’une part, le réfugié reconnu doit être traité sur un pied d’égalité avec les autres ressortissants étrangers présents sur le territoire, voire comme les nationaux, dans de nombreux domaines (travail, logement, soutien). D’autre part, la CR contient une interdiction de refoulement. Les Etats parties s’engagent ainsi à ne pas refouler des personnes vers un pays où elles seraient menacées de persécutions (« interdiction de refoulement du droit des réfugiés »).
[32]Cette interdiction de refoulement inscrite dans la CR fait écho à l’interdiction de refoulement contenue à l’art. 3 CEDH. Sur la base de l’interdiction de la torture et de tout traitement inhumain, la Cedh a formulé une interdiction absolue de renvoyer des personnes dans des pays où elles risqueraient de subir la torture ou d’autres graves violations des droits humains (« interdiction de refoulement résultant des droits humains »). L’interdiction de refoulement en cas de menace de torture fait partie du « droit international impératif » (ius cogens). La Convention de l’ONU contre la torture4 contient aussi, à son art. 3, une interdiction de refoulement. L’art. 7 Pacte II de l’ONU5 connaît également une interdiction de la torture et de tout traitement inhumain. La Suisse a signé et ratifié toutes les conventions précitées.
La Constitution fédérale6 mentionne expressément aussi bien l’interdiction de refoulement du droit des réfugiés que celle basée sur les droits humains (art. 25 al. 2 et 3 Cst.). Une initiative populaire des Démocrates suisses déposée en 1992 a été déclarée invalide par les Chambres fédérales pour incompatibilité avec cette norme impérative.
La Convention sur les droits de l’enfant7 joue également un rôle important pour l’asile en Suisse. En s’engageant à mettre l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de ses politiques, la Suisse a accepté de porter une attention particulière aux défis spécifiques des mineurs. Ce principe influe fortement sur la procédure d’asile spécifique aux mineurs non accompagnés et sur les conditions de leur accueil en Suisse.
D’autres conventions internationales portant sur des besoins spécifiques de protection peuvent également être pertinentes dans le domaine de l’asile. Elles concernent par exemple la protection des droits des personnes handicapées8, des victimes de la traite des êtres humains9 ou l’élimination des discriminations à l’encontre des femmes10. Les développements des standards liés aux droits humains en vue d’une protection renforcée pourraient bientôt déployer plus d’effets dans le domaine de l’asile.
[33]3 Le contexte européen
3.1 Le développement du droit européen de l’asile
Depuis le traité de Maastricht (1992), les Etats membres de l’UE reconnaissent que la politique d’asile est une « affaire d’intérêt général ». Jusqu’en 1998, la coopération en matière de politique d’asile de l’UE est toutefois demeurée largement informelle. Les Etats membres développèrent une collaboration intergouvernementale composée principalement de diverses recommandations non contraignantes. Avec les traités d’Amsterdam (1997) puis de Nice (2000), l’asile est devenu une politique communautaire. Les éléments clés du droit d’asile européen sont donc le résultat d’une délégation graduelle de compétences de la sphère nationale vers le niveau supranational de l’Union. Cette volonté politique se confirme avec le traité de Lisbonne (2007). Aujourd’hui, la politique d’asile commune est un pilier important de la politique d’immigration européenne et de son objectif de créer « un espace de liberté, de sécurité et de droit ». Cette évolution se traduit également dans la normalisation politique du régime de l’asile au niveau de l’UE. Dans le domaine de l’asile, le Parlement européen joue maintenant un rôle de législateur aux cotés du Conseil et de la Commission. La Cour de justice de l’UE exerce un contrôle judiciaire.
Le régime d’asile européen commun (RAEC) vise à la création d’un véritable espace européen de l’asile. Selon le Conseil européen de juin 2014, ce « processus devrait aboutir à la mise en place de normes communes élevées et à une coopération plus poussée, créant des conditions uniformes qui assurent aux demandeurs d’asile des garanties procédurales et une protection identiques dans toute l’Union ».11 Ce processus est indissociable du développement du régime de Dublin, en application depuis 1997 déjà. Pour l’essentiel, ce régime détermine quel Etat membre est responsable de l’examen d’une demande d’asile. Il poursuit l’objectif d’éviter des demandes à répétition et de prévenir ceux que l’on appelle les « réfugiés en orbite » pour lesquels aucun Etat ne se reconnait compétent.
Quant à la terminologie, il sied de rappeler qu’une directive de l’UE fixe le cadre général. Elle doit être transposée dans le droit national des Etats membres dans un délai imparti. Les tribunaux nationaux et la CJUE garantissent une interprétation uniforme. Un règlement de l’UE est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les Etats membres de l’UE.
Actuellement, les directives et règlements suivants fixent des normes contraignantes pour les Etats membres de l’UE dans le domaine de l’asile :
[34]Directive sur la notion de réfugié et sur la protection dite complémentaire (Directive qualification) : cette directive promulguée en 200412 a été profondément modifiée en 2011.13 Elle contient des indications sur la notion de réfugié et sur le statut juridique des réfugiés ainsi que sur les personnes à protéger qui, sans remplir les conditions de la notion de réfugié, ont besoin de protection selon les prescriptions internationales (« protection internationale »). Elle harmonise en outre les droits octroyés dans les différents Etats membres aux bénéficiaires d’une protection internationale. En particulier, la refonte de la directive a considérablement amélioré les droits liés au statut.
Directive sur la procédure d’asile (Directive procédures) : cette directive promulguée en 200514 a été profondément modifiée en 2013.15 Elle contient des normes minimales pour l’aménagement des procédures d’asile dans les Etats membres. La refonte poursuit un objectif d’harmonisation et d’amélioration des procédures d’asile afin de garantir la cohérence des systèmes d’asile des Etats membres.
Directive sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile (Directive accueil) : cette directive promulguée en 200316 a été profondément modifiée en 2013.17 Elle règle le niveau de vie pendant la procédure d’asile. Elle traite notamment de l’aide sociale et de l’accès aux soins médicaux et contient des dispositions sur les standards minimaux pour l’incarcération des requérants d’asile.
Directive sur l’octroi de protection en cas d’afflux massif (Directive sur la protection temporaire) : elle contient des dispositions sur l’octroi de protection et [35]le statut juridique des personnes qui entrent dans l’UE dans le cadre de mouvements massifs de réfugiés et sur la répartition des charges entre les Etats membres.18 Comme les dispositions sur la protection temporaire de la loi sur l’asile suisse, cette disposition n’a jamais été utilisée.
Règlement Dublin III : promulgué en 2013,19 ce règlement représente la version remaniée du Règlement Dublin II de 2003.20 Il détermine quel Etat membre est responsable de l’examen d’une demande d’asile. Son élément central porte sur les critères qui permettent de désigner l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile. Il est tenu compte, d’une part, de l’unité de la famille et, d’autre part, de la responsabilité des Etats lors de l’entrée légale ou illégale. Le RD III comprend une série de nouveaux éléments relatifs à la protection des mineurs non-accompagnés et de l’unité de la famille, aux droits procéduraux, à la protection juridique et aux motifs et délais de détention pour les personnes en procédure Dublin. Objet de difficiles discussions politiques, le nouveau règlement prévoit un mécanisme d’alerte et de crise si un Etat subit une très forte pression migratoire. A la suite de ces changements, le Règlement portant sur les modalités d’application du Règlement Dublin21 a également été modifié.22 Le RD III a été repris par la Suisse. Il est en vigueur depuis le 1er janvier [36] 2014 et directement applicable.23 Les changements législatifs nécessaires ont été réalisés le 1er juillet 2015.24
Le Règlement Eurodac : le Règlement remanié Eurodac25 (se basant sur le Règlement de 200026 et intégrant maintenant les règles du Règlement de mise en œuvre Eurodac de 200227) étend le champ d’application des dispositions Eurodac. Le règlement porte sur l’adaptation du système des empreintes digitales pour les demandeurs d’asile et les personnes sans droit de séjour. Le but est de faciliter la mise en œuvre du système Dublin en mettant à la disposition des Etats des moyens de preuve concernant les entrées, les séjours et le dépôt de demandes d’asile. La nouvelle mouture permet d’enregistrer plus d’informations et de les mettre plus facilement à disposition des autorités nationales. Certaines de ces informations sont mises à dispositions des autorités pénales nationales, même si celles-ci ne sont pas impliquées dans la procédure d’asile. Ce Règlement Eurodac est partie intégrante de l’acquis Dublin contraignant pour la Suisse. La nouvelle version du règlement et les changements dans la législation suisse sont entrés en vigueur le 20 juillet 2015.28
De plus, les règlements et accords suivants sont pertinents pour la pratique suisse, soit à titre contraignant en tant que développement de l’acquis Schengen,29 soit [37]indirectement en tant que reprise de la jurisprudence en matière de libre circulation des personnes.30
Directive modifiant la Directive relative aux résidents de longue durée dans l’UE : la modification de la directive étend son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire). Sous certaines conditions, il leur est désormais permis de solliciter une carte de résident longue durée de l’UE.31
Directive relative au droit au regroupement familial : la directive règle le droit au regroupement familial des personnes migrantes provenant d’Etats tiers. La directive comprend des règles particulières pour les réfugiés des pays tiers.32
Directive retour : la directive contient des dispositions uniformes à l’échelle de l’UE concernant les décisions de renvoi, la détention en vue de garantir l’exécution du renvoi, le renvoi ou l’expulsion ainsi que les interdictions d’entrée.33
L’Accord de Schengen de 198534 et la Convention d’application de 199035 : dans le régime Schengen, les Etats membres contrôlent leurs frontières extérieures et renoncent à des contrôles aux frontières intérieures de l’UE. Cela suppose une politique harmonisée en matière de visas et l’accès au système d’information commun de Schengen (SIS).
Règlement (CE) no 2007/2004 sur la création de l’agence européenne FRONTEX : ce règlement définit les tâches et le statut de l’agence européenne de gestion des frontières FRONTEX.36
[38]Règlement (CE) no 863/2007 sur l’engagement de troupes d’intervention rapide aux frontières (« rapid border intervention teams », RABIT) : ce règlement précise les modalités d’interventions de groupes de garde-frontières de différents Etats membres. Ces groupes interviennent à la demande d’un Etat membre faisant face à une situation exceptionnelle.37
Règlement (CE) no 562/2006 sur le code frontières Schengen.38 Selon l’art. 1 du code Schengen, le Règlement prévoit « l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les Etats membres de l’Union européenne. Il établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne. » La dernière modification du code frontière par le Règlement (UE) no 1051/2013 porte sur la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles.39 Ce règlement introduit une nouvelle réglementation concernant la durée maximale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures.
Règlement (CE) no 810/2009 sur le code des visas.40 Ce règlement contient les règles de procédure et les conditions d’obtention d’un visa pour les ressortissants des pays tiers. Le règlement concerne les voyages sur le territoire des Etats membres et les séjours jusqu’à trois mois (resp. six mois) dans l’espace Schengen.
Ces directives et règlements sont accompagnés de mécanismes de soutien aux Etats membres. Depuis 2010, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) sis à Malte a démarré son activité.41 Sa fonction consiste à renforcer la coopération pratique des pays de l’UE et à améliorer la mise en œuvre du régime d’asile européen commun. En plus de documents généraux sur la législation européenne, le bureau publie des rapports annuels sur la situation de l’asile en Europe. Les quatre [39]Etats associés à Dublin (Suisse, Norvège, Islande, Liechtenstein) peuvent participer aux activités du bureau à titre d’observateurs. Depuis 2015, la Suisse participe en tant que partenaire à titre de soutien et de conseil.42 Pour la période 2014-2020, le Fonds « Asile, migration et intégration » (FAMI) succède au Fonds « Solidarité et gestion des flux migratoires » de la période 2007-2013.43 Le fonds de 265 millions d’euros a pour but de soutenir la mise en place du régime européen d’asile, d’équilibrer les charges financières des Etats membres et de financer des mesures destinées à faciliter l’intégration des réfugiés.
Malgré des divergences politiques profondes entre les différents Etats membres, le régime d’asile européen commun s’est développé de manière rapide. Deux défis particulièrement importants continuent de marquer son évolution. Il s’agit premièrement d’assurer une protection équivalente dans les Etats membres. Les différentes réformes du Règlement Dublin rappellent que l’accord ne peut finalement remplir sa fonction que si les chances de reconnaissance de la qualité de réfugié et les conditions d’admission sont comparables dans tous les Etats membres. Il s’agit deuxièmement de donner une consistance au concept de solidarité qui soustend ce régime européen. L’art. 67 par. 2 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) rappelle que l’UE « assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre Etats membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers ».44 Ce concept de solidarité est central, car il permet de faire évoluer le régime de Dublin d’un vaste mécanisme de distribution bureaucratique des demandes d’asile vers une véritable coopération solidaire européenne. La définition de cette solidarité exige une vision politique que les Etats membres et l’UE font émerger peu à peu. Il est intéressant de noter que la CJUE et la Cedh participent de plein pied à ce débat en signifiant des limites au système de redistribution intra-européenne. Par le biais d’arrêts cruciaux,45 les Cours ont ainsi rappelé que le régime européen de [40]l’asile doit répondre à des standards de protection des droits fondamentaux de l’UE (notamment la Charte des droits fondamentaux46) et de la CEDH.
3.2 L’importance du contexte européen pour la Suisse
Le contexte européen brièvement esquissé plus haut joue un rôle fondamental pour le régime de l’asile en Suisse, notamment en raison de la position géographique de la Suisse. En plein cœur de l’Europe, la Suisse n’a d’autre choix que de suivre, bon gré mal gré, les développements européens de l’asile. Reconnu par le Conseil fédéral en 1998 déjà, le risque est grand de voir la Suisse devenir un « pays d’asile de réserve » pour les requérants déboutés dans d’autres pays européens47.
Prenant acte de cette réalité, la première phase de coopération entre la Suisse et l’UE a été marquée par une stratégie de compensation. Le législateur s’est appliqué à ne pas faire apparaître le régime suisse de l’asile comme étant « trop attractif » par rapport à celui des autres pays européens. De plus, par le biais d’accords bilatéraux, la Suisse a étendu peu à peu la collaboration avec les pays européens, avant tout dans la réadmission de requérants entrés illégalement. Elle a aussi œuvré dans le cadre des Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia (IGC). La coopération entre la Suisse et l’UE a gagné une nouvelle dimension avec l’acceptation en votation populaire le 5 juin 2005 de l’arrêté fédéral48 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux II sur l’association à l’Espace Schengen49 et à l’Espace Dublin.50 Il s’agit là d’un pas décisif dans la collaboration entre l’UE et la Suisse dans le domaine de l’asile. Avec ces deux accords d’association, la Suisse est partiellement entrée dans le régime européen de l’asile et se trouve liée à l’évolution de ce système.
Sur certains points, la Suisse s’est engagée à respecter le droit de l’UE et à reprendre ses développements :
[41]L’association à l’Espace Dublin signifie que la Suisse participe au système de la détermination de la responsabilité mis en place par l’UE pour l’examen des demandes d’asile. L’examen matériel d’une deuxième demande d’asile déposée en Suisse après le refus d’un Etat de l’Espace Dublin ou inversement est en principe exclu. La Suisse participe également au système européen de comparaison des empreintes digitales Eurodac.
L’association à l’Espace Schengen signifie que la Suisse renonce désormais au contrôle systématique des personnes aux frontières avec l’UE et participe au système de l’octroi des visas et de la surveillance des frontières extérieures de l’UE.51
Comme esquissé plus haut, ces instruments juridiques sont régulièrement développés par l’UE. Le régime suisse s’en trouve directement touché. Dans le processus de collaboration autour de Schengen et Dublin, la Suisse jouit d’une voix consultative et participe aux travaux d’un comité mixte. Si le ou la ministre en charge du dossier de l’asile peut participer aux réunions communes, il ou elle n’a pas de pouvoir formel de codécision. Une fois une décision arrêtée, il appartient à la Suisse de décider souverainement si elle veut reprendre dans sa législation le nouvel acte juridique. Toutefois, un refus de sa part pourrait avoir pour ultime conséquence la fin de l’application des accords. Le délai prévu pour la réception de nouveaux actes juridiques est de deux ans. A des fins d’illustration chiffrée, la Direction des affaires européennes (DAE) note que depuis le 26 octobre 2004, date de la signature des accords, l’UE a notifié à la Suisse 170 développements de l’acquis de Schengen, l’acquis de Dublin/Eurodac ayant pour sa part connu trois développements (état au 17 août 2015). 26 de ces communications portaient sur des normes dont la reprise a été soumise à l’approbation du Parlement.
La reprise de l’acquis de Dublin a eu des conséquences directes pour la législation suisse, notamment sur les sanctions pénales pour les entreprises de transport qui ne respectent pas leurs obligations de contrôle, les dispositions sur la communication et la protection des données, la procédure en cas de non-entrée en matière après des décisions Dublin. De même, dans le prolongement de l’acquis de Schengen, l’UE a adopté la Directive retour qui fixe entre autre la durée maximale de privation de liberté en vue du renvoi à 18 mois. La Suisse a dû corriger sa propre position qui prévoyait une durée maximale de 24 mois. En 2014, la Suisse a repris le Règlement Dublin III et le nouveau Règlement Eurodac et a modifié, en [42]conséquence, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et la loi sur l’asile (LAsi)52. Les décisions de la CJUE – et le cas échéant de la Cedh – sur ce Règlement Dublin III devront être respectées par les autorités et les tribunaux suisses.
Au-delà de la reprise des acquis de Schengen et Dublin, il importe de saisir que certaines normes européennes ont également une importance pour la Suisse. La distinction entre les normes contraignantes pour la Suisse (Schengen et Dublin) et les normes non contraignantes pourrait donner l’impression erronée que le reste du développement européen ne concerne pas le régime suisse de l’asile. A l’inverse, le régime suisse est profondément influencé par les évolutions européennes esquissées plus haut, même si celles-ci ne sont pas toutes formellement contraignantes.
Premièrement, l’application du droit d’asile suisse se fait, dans la mesure du possible, à l’aune des évolutions européennes. Dans le cadre de l’interprétation de notions juridiques définies sur le plan international, comme par exemple la notion de réfugié, les autorités et les tribunaux suisses – à savoir principalement le SEM et le TAF – observent avec beaucoup d’attention les évolutions de la jurisprudence de l’UE53. Deuxièmement, un mécanisme similaire d’adaptation et de prévention des conflits de normes est à l’œuvre dans le travail législatif. Ainsi, les révisions de la loi sur l’asile prennent de plus en plus en compte leur euro-compatibilité et préviennent ainsi d’éventuelles dispositions qui se situeraient en deçà des normes minimales prévues par l’UE. De plus, l’art. 113 LAsi prévoit que la Confédération participe à l’harmonisation de la politique européenne à l’égard des réfugiés au niveau international et aux efforts entrepris à l’étranger pour résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés. A terme, la situation pourrait devenir problématique dans le cas où la législation suisse s’éloignerait trop des évolutions européennes, par exemple sur la question du statut accordé aux personnes au bénéfice d’une protection internationale.
1 SEM, Statistiques en matière d’asile, Statistiques annuelles, disponible sous : www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/statistik/asylstatistik/jahresstatistiken.html (consulté le 31 juillet 2015).
2 ATF 131 I 166.
3 Cedh, Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, no 27765/09.