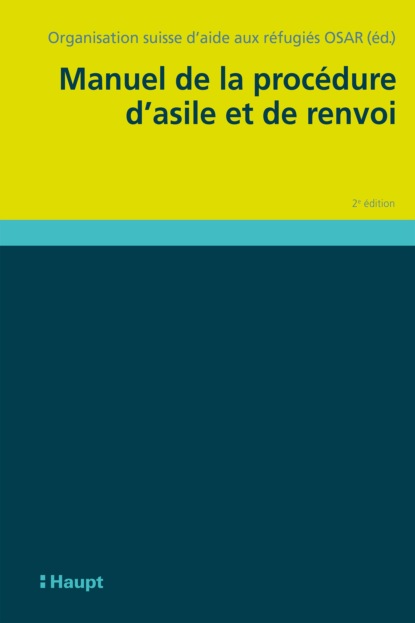- -
- 100%
- +
La notification peut se faire par télécopie lorsque la demande d’asile a été présentée à la frontière ou à l’aéroport (art. 13 al. 3 LAsi). Ce type de notification est également possible dans d’autres cas urgents (art. 13 al. 4 LAsi). Cependant, pour être juridiquement valable, la notification par télécopie suppose cumulativement que le cas soit urgent, que la télécopie soit signée, qu’une copie ait été remise à son destinataire et que celui-ci en confirme la réception. Si le requérant a un mandataire, il suffit de lui donner connaissance de la notification sans retard ; l’art. 11 al. 3 PA n’est pas applicable dans de tels cas. Il en va de même pour les décisions de [95]non-entrée en matière au sens de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (art. 13 al. 5 LAsi) qui concernent à titre primaire des procédures Dublin.
Ce n’est qu’au moment de la notification que le requérant a la possibilité de prendre connaissance de la décision le concernant. La date à laquelle elle se produit fait partir le délai de recours (sur les délais, voir chap. XIII, pt 3.1). Une notification de la décision par publication dans un journal officiel n’entre pas en ligne de compte dans la procédure d’asile en raison de l’intérêt de la personne concernée au maintien du secret.
7.7 Droit de consulter le dossier
Les personnes concernées ne peuvent s’exprimer efficacement sur leur cause et apporter des preuves appropriées que si elles ont accès au dossier sur lequel se base l’autorité.106 Par conséquent, les requérants d’asile ou, le cas échéant, leur mandataire ont le droit de consulter leur dossier. Lorsque la procédure est pendante, le droit de consulter le dossier est régi par les art. 26 ss PA et, lorsqu’elle est terminée, par les dispositions de la loi sur la protection des données (voir l’art. 2 LPD dont l’al. 2 let. c exclut expressément (et uniquement) les procédures administratives pendantes du champ d’application de la LPD).107
Pendant la procédure d’instruction, une requête visant à la consultation du dossier peut être refusée en application de l’art. 27 al. 1 let. c PA mais, après la clôture de l’instruction, l’autorité a l’obligation d’accorder le droit à la consultation du dossier. En principe, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu lorsque le SEM retient un dossier qui lui a été demandé pour consultation longtemps à l’avance, pour ensuite – sans motifs pertinents – en transmettre les pièces juste avant l’expédition de la décision ; en revanche, cette pratique porte atteinte au principe de loyauté en procédure et va à l’encontre de l’économie de procédure.108
Pour que la personne concernée puisse s’exprimer de manière adéquate sur le dossier consulté, les autorités ont le devoir de verbaliser et de verser au dossier tous les actes d’instructions, interrogatoires et expertises ainsi que tout autre élément pouvant avoir une incidence sur la décision.109 Le dossier doit être organisé de manière ordonnée, accessible et complète et l’on doit voir qui l’a constitué et comment.110 Sont des pièces du dossier tous les documents mentionnés à l’art. 26 PA. Les pièces [96]internes à l’administration sont exclues du droit de consulter le dossier. L’étendue de ce droit ne se détermine cependant pas selon que l’autorité classe elle-même un moyen de preuve comme interne ou secret, mais en fonction de la signification objective de la pièce en cause dans le cas concret. Des rapports et expertises établis de manière interne à l’administration sur des questions litigieuses de fait ne sont pas considérés comme des documents internes.111 Selon la jurisprudence difficilement explicable du TAF, la remarque du collaborateur du SEM qui « demande » une décision positive ne fait pas partie de cette catégorie d’exceptions bien qu’elle influence de manière décisive le processus de décision.112
Le contenu essentiel des « expertises Lingua » (voir chap. XII) doit être révélé dans le cadre du droit de consulter le dossier.113 Il faut donner au requérant la possibilité de s’exprimer à ce sujet et de proposer des contre-preuves. Les notes et les notices d’entretien rédigées à l’occasion de « tests sur les pays » ou de l’utilisation des informations sur les pays d’origine sont des moyens de preuve en procédure d’asile.114
Le droit de consulter le dossier peut être limité lorsqu’il existe un intérêt prépondérant au maintien du secret de certains documents. Ce point doit être tranché sur la base d’une pesée concrète, attentive et étendue des intérêts contradictoires en cause dans le respect du principe de la proportionnalité.115 Le refus du droit de consulter le dossier doit être motivé.
[97]8 Aperçu du projet 2
8.1 Centres de la Confédération
Selon le message du Conseil fédéral, la « restructuration du domaine de l’asile »116 nécessiterait environ 3’600 places supplémentaires, du fait que l’ensemble de la procédure accélérée doit en principe se dérouler dans les centres de la Confédération. Pour répondre à ce besoin, il faudrait créer un centre de procédure dans chacune des six régions de la Suisse ainsi que deux centres de préparation au départ. De plus, l’ouverture de deux centres spécifiques est envisagée.
La durée de séjour dans les centres de la Confédération serait de 140 jours et devrait pouvoir être prolongée de manière « appropriée ». Il est dès lors important que les possibilités d’hébergement tiennent compte de la durée de séjour nouvellement prévue et, en particulier, des besoins des personnes vulnérables. Ces centres ne devraient pas être situés à des endroits totalement reculés pour garantir des contacts sociaux aux résidants et ne pas leur compliquer excessivement l’accès à une représentation juridique. Si cette règle n’est pas respectée, le placement des requérants dans les centres reviendrait à une restriction disproportionnée de leur liberté de mouvement, voire à une privation de cette liberté.117
8.2 Procédure accélérée et élargie
Les demandes d’asile ne nécessitant pas d’autres mesures d’instruction seront à l’avenir soumises à la procédure accélérée (art. 26c P-LAsi). Dans ces cas, il ne devrait plus y avoir d’attribution à un canton et les personnes concernées seraient logées dans un centre de la Confédération pendant toute la durée de la procédure d’asile et de l’exécution du renvoi. Les cas Dublin seraient aussi soumis à la procédure accélérée. Selon le message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral part du principe qu’environ 60 % des demandes pourraient être traitées selon cette procédure.
Pour les autres cas – environ 40 % – qui nécessitent des compléments d’instruction et ne peuvent pas être tranchés immédiatement, il serait fait application de la [98]procédure élargie au sens de l’art. 26d P-LAsi. Les requérants d’asile seraient alors attribués à un canton et la procédure devrait être terminée dans le délai d’une année.
Les expériences faites dans le cadre des phases de test ont révélé les chiffres suivants pour l’année 2014 : 65.7 % des cas (y compris 31.4 % de procédures Dublin) ont pu être réglés en procédure accélérée. 22.2 % des requérants d’asile attribués au centre test ont passé en procédure étendue. 12.2 % des cas ont été classés ou liquidés d’une autre manière.118
8.3 Conseil et représentation juridique
A titre de mesure d’accompagnement de la procédure rapide, il est prévu aux art. 102f ss P-LAsi que les requérants concernés aient droit à un conseil et à une représentation juridiques gratuits. Cela est tout à fait bienvenu, car un soutien et un conseil adéquats peuvent notablement contribuer à la loyauté de la procédure. Selon l’expérience faite en phase de test, cet élément augmente notamment l’acceptation des décisions négatives par les intéressés.
1 TF, 2A 548/2003 du 26 novembre 2003, consid. 2.3.
2 ATF 121 II 59, consid. 3c.
3 RO 2012 5359 (modifications urgentes de la loi sur l’asile du 28 septembre 2012).
4 Abstraction faite de l’asile familial et du regroupement familial.
5 Directive du SEM III.1, ch. 1.1.1.6.
6 Art. 8 al. 1 PA.
7 JICRA 1996/5.
8 ATF 117 II 6, consid. 1b.
9 ATAF 2011/39, consid. 4.3.2, [Trad.].
10 Working Paper 26 du BAMF, Parusel Bernd, Unbegleitete minderjährige Migranten in Deutschland – Aufnahme, Rückkehr und Integration, 2009, p. 29. Voir aussi HCR, Safe and Sound – What States can do to ensure respect for the best interest of unaccompanied and separated children in Europe, octobre 2014.
11 Selon l’art. 1 CDE, toute personne de moins de 18 ans est juridiquement définie comme un enfant.
12 Les demandes multiples devraient être motivées suffisamment pour permettre à l’autorité de pouvoir statuer sans entendre préalablement le requérant (ATAF 2014/39, consid. 5.5).
13 Le canton compétent est celui qui l’était déjà lors de la procédure d’asile précédente.
14 Directive du SEM III.5, ch. 5.1.2.1.
15 ATAF 2014/39, consid. 4.3 s.
16 Système d’information central sur la migration dans les domaines de l’asile et des étrangers (en allemand : ZEMIS).
17 Directive du SEM III.5, ch. 5.1.2.1.
18 Voir message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, 4049.
19 Voir à ce sujet ATAF 2014/39, consid. 7.
20 P. ex. sur la base des art. 42 à 43 LEtr ou de l’art. 8 CEDH (ATAF 2013/37, consid. 4.4).
21 Il s’agit ainsi d’éviter que les procédures d’asile soient retardées ou que des renvois envisagés soient différés (ATF 128 II 200, consid. 2.1).
22 Caroni Martina et al., Migrationsrecht, 3e éd., Berne 2014, p. 232.
23 Voir www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/asylgesuch/asylgesuch_im_inland.html (consulté le 31 juillet 2015).
24 SEM, Commentaire sur la statistique en matière d’asile 2014, p. 14.
25 ATF 132 IV 29, consid. 3.3, avec renvoi à TF, 6S. 737/1998 du 17 mars 1999, traité dans ASYL 1999/2, p. 22.
26 Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein, Prise de position du HCR sur l’impunité de l’entrée irrégulière de réfugiés, mai 2013 ; voir aussi p. ex. Conclusions du Comité exécutif du HCR nos 44, 46 et 58.
27 Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein, Prise de position du HCR sur l’impunité de l’entrée irrégulière de réfugiés, mai 2013.
28 ATF 132 IV 29, consid. 3 ss.
29 Le TAF (p. ex. dans son arrêt D-6502/2010 du 16 septembre 2010) ne voit aucun problème, à notre avis de manière choquante, à ce que des personnes se trouvant déjà hors de la zone de transit y soient renvoyées pour suivre la procédure à l’aéroport. Le refus (provisoire) d’entrée étant nécessaire dans le cadre de la procédure à l’aéroport (art. 22 al. 2 LAsi), une « annulation » de l’entrée est nécessaire pour pouvoir mener la procédure à bien. Le refus d’entrée au sens de l’art. 13 CFS ne peut être prononcé que préalablement à l’entrée sur le territoire (voir art. 13 par. 4 CFS selon lequel les autorités veillent à ce qu’un ressortissant « ne pénètre pas » sur le territoire). Le CFS ne prévoit pas la possibilité de refuser l’entrée ultérieurement. Le renvoi d’une personne vers la zone de transit après son entrée dans le pays – c’est-à-dire après son passage au poste-frontière – exige une décision de renvoi. La pratique qui consiste à attribuer une personne à un hébergement dans un aéroport sans décision formelle est ainsi contraire au droit Schengen.
30 Cedh, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique du 12 octobre 2006, no 13178/03 et Amuur c. France du 25 juin 1996, no 19776/92 ; voir aussi Trechsel Stefan, Die Unterbringung von Asylsuchenden zwischen Freiheitsbeschränkung und Freiheitsentzug, in : ASYL 2014/3, p. 3 ss.
31 Voir JICRA 1997/19.
32 ATAF 2010/1, consid. 2.2.3.
33 La désignation d’une personne de confiance n’est qu’une mesure de remplacement lorsqu’une tutelle ou une curatelle selon le Code Civil ne peut pas être ordonnée à temps. Pour l’accompagnement et la représentation en droit d’asile, il serait préférable de nommer un représentant légal en raison des connaissances spécialisées d’une telle personne. Voir la prise de position de l’OSAR sur la restructuration du droit d’asile, 20 novembre 2014.
34 Le maintien d’une personne à l’aéroport pour l’examen de sa procédure d’asile doit être juridiquement qualifié de privation de liberté. La décision de refus (provisoire) d’entrée est donc constitutive d’une décision de privation de liberté, voir à ce sujet la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cedh ; Trechsel Stefan, Die Unterbringung von Asylsuchenden zwischen Freiheitsbeschränkung und Freiheitsentzug, in : ASYL 2014/3, p. 3 ss.
35 RO 2012 5359.
36 Voir à ce sujet aussi la prise de position de l’OSAR sur les modifications des lois sur l’asile et sur les étrangers, 4 mars 2009.
37 Voir le rapport du Projet E.T. – Entering the territory, Exploring avenues for protected entry in Europe, mars 2012.
38 TAF, E-6862/2013 du 31 décembre 2013, consid. 3.4. ; voir aussi ATAF 2015/5.
39 Directive du SEM 322.126 sur les demandes de visa pour des motifs humanitaires, 25 février 2014.
40 Disponible sous : www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/einreise/visumantragsformular.html (consulté le 31 juillet 2015).
41 Manuel des visas I et Complément SEM, 6e éd., 2 février 2015, p. 155.
42 TAF, E-6862/2013 du 31 décembre 2013, consid. 4.4.
43 Chancellerie fédérale, Explications du Conseil fédéral relatives à la votation populaire du 9 juin 2013, p. 23.
44 FF 2010 4035, 4048. Voir aussi sur ce point Stünzi Robin, Les mesures dissuasives et leurs limites : données empiriques et réflexions au sujet du nouvel art. 3 al. 3 LAsi et de la suppression des demandes d’asile en ambassade, in : ASYL 2014/4, p. 26 ss.
45 Voir TAF, D-5645/2014 du 22 janvier 2015 ; E-6587/2014 du 15 janvier 2015 ; E-5528/2014 du 13 novembre 2014.
46 TAF, E-6056/2014 du 20 février 2014 ; voir aussi Frehner Sarah ; Nufer Seraina, Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des Asylrechts 2014-2015, in : Achermann Alberto et al. (édit.), Annuaire du droit de la migration 2014/2015, Berne 2015, p. 241 ss.
47 Solidarité sans frontières, Factsheet Demandes d’asile à l’ambassade – Demandes d’autorisation d’entrée depuis l’étranger, octobre 2012.
48 Manuel Asile et retour du SEM, Article C1, Les centres d’enregistrement et de procédure, p. 4.
49 Actuellement, il s’agit notamment d’AOZ et ORS, chargés de l’encadrement des requérants d’asile et du fonctionnement des centres, ainsi que Securitas.
50 Art. 2 de l’ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile (RS 142.311.23).
51 Segessenmann Thomas, Rechtsschutz in den Aussenstellen der Empfangs- und Verfahrenszentren des Bundes, in : ASYL 2015/1, p. 14 ss.
52 Voir aussi Trechsel Stefan, Die Unterbringung von Asylsuchenden zwischen Freiheitsbeschränkung und Freiheitsentzug, in : ASYL 2014/3, p. 3 ss.
53 Voir Ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile.
54 Sur la protection juridique dans les CEP, voir TF, 2A.151/2001 du 9 avril 2002, publié en partie dans ASYL 2002/2, p. 21 ss.
55 Voir aussi la prise de position de l’OSAR du 19 mars 2013, p. 15 ss.
56 Communiqué de presse du SEM du 28 mars 2014.
57 En outre, les questions d’une limitation de durée – qui se trouvait à l’al. 5 – et de l’urgence de la mesure ont fait l’objet d’intenses discussions au Conseil des Etats (BO 2012 CE 852 ss) et au Conseil national (BO 2012 CN 1657 ss). Une expertise non officielle de l’OFJ sur le projet d’art. 112b LAsi a finalement convaincu les Chambres d’accepter la disposition (voir l’intervention de la Conseillère aux Etats Egerszegi-Obrist, BO 2012 CE 853).
58 Au moment de la mise sous presse du présent manuel, seul le premier rapport d’évaluation intermédiaire publié en février 2015 était disponible. Il devait servir en particulier à informer les Chambres fédérales dans le cadre du processus parlementaire (voir le communiqué du SEM du 16 février 2015 auquel a été joint un résumé des résultats intermédiaires avec les rapports intermédiaires rendus dans le cadre des quatre mandats).
59 Voir message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l’asile (Restructuration du domaine de l’asile), FF 2014 7771, ainsi que les délibérations parlementaires relatives à la restructuration du domaine de l’asile (objet parlementaire 14.063).
60 FF 2014 7049, RO 2015 2047.
61 La prorogation a été décidée sous réserve d’une modification législative entrant en vigueur plus tôt, car, dans cette hypothèse, les mesures d’urgence perdraient leur validité au profit des nouvelles dispositions, voir al. 3 de la disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2014, FF 2014 7049, RO 2015 1849.
62 Voir message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l’asile (Restructuration du domaine de l’asile), FF 2014 7771. Voir aussi les débats parlementaires concernant la prolongation de la phase de test dans BO 2014 CN 1039 ss et BO 2014 CE 758 ss.
63 A ce sujet, voir aussi SEM, Evaluation de la phase de test. Résumé des résultats intermédiaires, février 2015, p. 3.
64 Voir ce qualificatif de « point clé » dans le communiqué du 30 avril 2015 de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats dans la perspective d’une entrée en matière du parlement sur la modification proposée.
65 Concernant cette disposition combinée avec le bref délai de recours dans la procédure testée, la question s’est posée de savoir comment le droit à un recours effectif peut être réellement garanti si le représentant légal révoque son mandat pendant ce délai. Voir p. ex. la prise de position de l’OSAR de novembre 2014 sur la restructuration (commentaire de l’art. 102h P-LAsi) et Frei Nula ; Gordzielik Teresia, Schnell, aber fair ? – Kritischer Kommentar zum Entwurf einer « Testphasenverordnung », in : ASYL 2013/2, p. 21.
66 Voir TAF, E-1917/2014 du 20 mai 2014.
67 La « notification » que l’art. 13 OTest prévoit d’adresser « au prestataire chargé de fournir la représentation juridique » lorsqu’un représentant légal a été désigné au requérant d’asile n’a pas d’effets juridiques pour ce dernier, car la décision ne passe dans son domaine de responsabilité qu’au moment de la notification au représentant légal (ou au requérant lui-même).
68 A ce sujet, voir aussi TAF, D-2172/2014 du 1er mai 2014.
69 A ce sujet, voir le rapport intermédiaire du 1er décembre 2014 rendu dans le cadre du mandat no 4, p. 14, disponible sous : www.sem.admin.ch/dam/data/bfm/aktuell/news/2015/2015-02-16/eval-zwber4-f.pdf (consulté le 31 juillet 2015). Sur la pratique, voir aussi Frehner/ Nufer, in : Achermann et al. (édit.), op. cit., note 46, p. 241 ss.
70 Pour des questions pratiques, nous ne parlons ici que des CEP ; la même règle s’applique cependant par analogie après 140 jours dans un centre spécifique et après 60 jours dans un logement à l’aéroport.
71 Cedh, Agraw et Mengesha Kimfe c. Suisse du 29 juillet 2010, nos 24404/05 et 3295/06 : violation de l’art. 8 CEDH.
72 ATAF 2008/47, consid. 4.1.
73 Depuis le 1er juillet 2015, une personne de confiance doit dans tous les cas être désignée au moment déjà de l’audition sommaire et ce pas uniquement dans les cas Dublin (voir ATAF 2011/23, consid. 5.4). L’audition sommaire se déroulant généralement dans un CEP, la personne de confiance change après l’attribution à un canton. La question se pose de savoir si un tel changement est toujours compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant eu égard au rôle important tenu par la personne de confiance dans la procédure. En principe, il y a toujours lieu de désigner immédiatement un curateur ou un tuteur conformément aux dispositions du CC.
74 Diverses dénominations coexistent dans la loi (p. ex. audition sur les données personnelles). Nous utilisons dans le présent manuel celle d’audition sommaire, la plus courante dans la pratique (en allemand : Befragung zur Person – BzP). Dans l’OTest, la notion de « premier entretien » est employée.
75 TAF, E-4172/2014 du 18 août 2014.
76 Cette différence est faite parce que les auteurs de persécution liée au genre sont pour la plupart de sexe masculin, raison pour laquelle une équipe de même sexe telle que prévue par la loi n’est pas toujours opportune.
77 Manuel Asile et retour du SEM, Article C6, Audition sur les données personnelles, ch. 2.1, p. 5 s.
78 Le TAF (ATAF 2009/51) a confirmé la jurisprudence de la CRA (JICRA 2003/17) selon laquelle l’allégation d’un viol seulement au stade du recours ne plaide pas pour sa non vraisemblance.
79 Voir les expériences au Service ambulatoire de la CRS pour victimes de la torture et de la guerre de même que la jurisprudence du TAF (ATAF 2009/51). Voir aussi le Comité de l’ONU contre la torture qui se montre plus large en cas d’inepties ou d’allégations tardives si le recourant a manifestement été victime de torture (De Weck Fanny, Die Praxis des Ausschusses der Vereinten Nationen gegen die Folter, in : ASYL 2011/2, p. 9, avec renvoi à CAT, C.T. et K.M. c. Suède du 22 novembre 2007, no 279/2005, par. 7.6). Voir encore le protocole d’Istanbul et ses lignes directrices sur l’approche des victimes de la torture (UNHCHR, Manual on Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, Professional Training Series No.8/ Rev.1, New York/Genève 2004).
80 Manuel Asile et retour du SEM, Article H2, Voies de droit extraordinaires (y.c. frais de procédure), ch. 2.4.
81 L’absence d’i nvocation de tels faits ne peut pas être reproché à l’i ntéressé, voir p. ex. ATAF 2007/31, consid. 5.1.
82 Voir à ce sujet l’édition précédente du présent manuel, p. 121 ss.
83 Voir la définition correspondante de l’« identité » à l’art. 1a let. a OA 1.
84 Voir ATAF 2011/27, consid. 4 (empreintes digitales), JICRA 2000/8, consid. 5 ss (absence injustifiée à l’audition) et JICRA 2003/22, consid. 4 (non-respect d’une convocation) ; voir aussi les exemples dans l’édition précédente du présent manuel, p. 125 s. Parmi les exemples donnés, certains sont sans violation grave et coupable de l’obligation de collaborer. Aucune violation n’est constatée si le requérant d’asile ne participe pas à l’audition menée dans une langue qu’il ne comprend pas suffisamment bien (voir déjà JICRA 1993/36, consid. 3 s).
85 Au sujet de la tromperie sur l’identité, voir ATAF 2013/10, consid. 9.1. Le Tribunal précise que l’autorité doit être convaincue du fait et qu’il ne suffit pas qu’il soit hautement probable. Concernant l’obligation de preuve de manière générale dans ces cas, voir déjà JICRA 2005/16, consid. 2.3.
86 Voir sur le rôle de la ROE et sur la signification de ses objections : TAF, E-3637/2006 du juin 2008, consid. 4.
87 Gattiker Mario, La procédure d’asile et de renvoi, Berne 1999, p. 26.
88 Voir Cedh, M.A. c. Suisse du 18 novembre 2014, no 52589/13, par. 59 ; voir aussi le commentaire de Romer Adriana sur ce sujet, in : ASYL 2015/1, p. 28 s.
89 JICRA 1996/13.
90 Concernant l’audition sommaire : art. 19 al. 2 OA 1 ; concernant l’audition sur les motifs d’asile : art. 29 al. 1bis LAsi.
91 Manuel Asile et retour du SEM, Article B2, Langues officielles, p. 4.
92 JICRA 1993/36, consid. 3 et 4.
93 Les observations faites pas les ROE ne sont prises en considération que de manière limitée. Le TAF a p. ex. estimé dans un arrêt D-3753/2014 du 18 mai 2015 (consid. 4.2.1), que les critiques formulées par un ROE ne pouvaient pas être entièrement convaincantes, du fait que ce dernier ne maîtrisait pas la langue du requérant.
94 P. ex. un proverbe ou une expression toute faite peut perdre de son sens par sa traduction littérale, voire ne pas être compris correctement. De même, des gestes peuvent avoir divers sens. Si l’auditeur ne les comprend pas, il peut se les faire expliquer par l’interprète.
95 TAF, E-953/2014 du 6 mars 2014, consid. 5.1 ss.